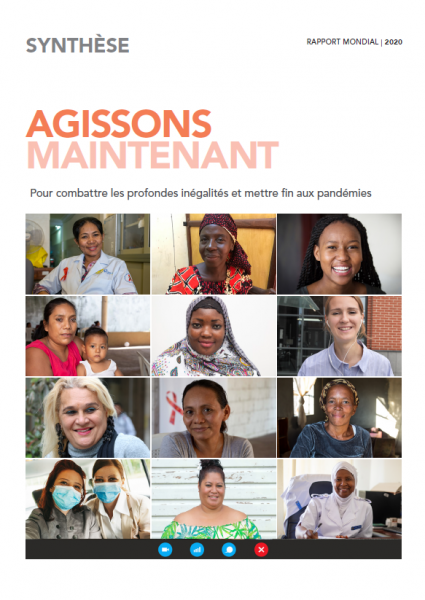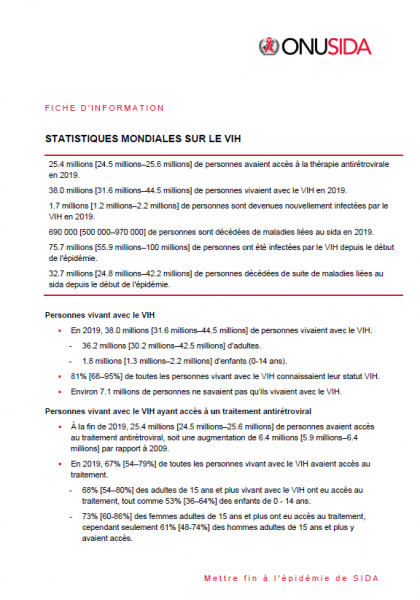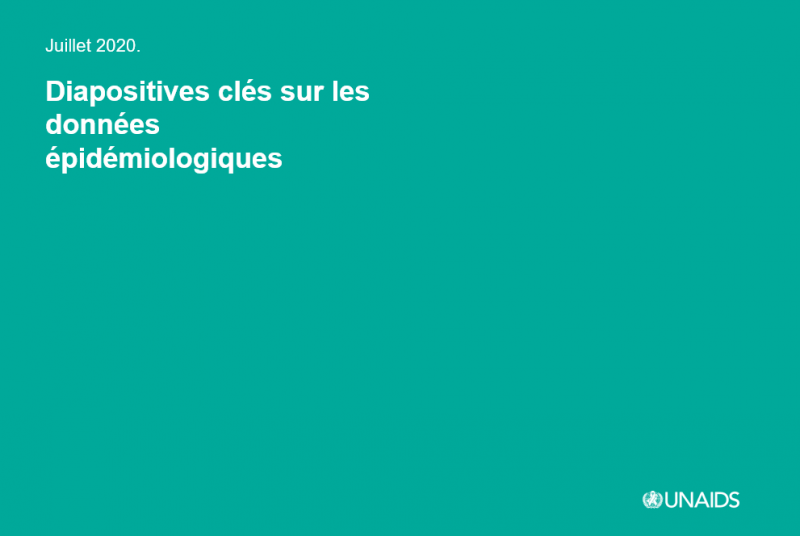Des représentants de plus de 300 villes se sont réunis lors de la Global Fast-Track Cities Conference on Urban HIV, Tuberculosis, and Viral Hepatitis
LONDRES, ROYAUME-UNI (9 septembre 2019) – Le maire de Londres, Sadiq Khan, a accueilli aujourd’hui des personnalités internationales et des élus lors de la conférence inaugurale Fast-Track Cities 2019 (Les villes s'engagent). Cet évènement rassemble plus de 300 villes et municipalités en vue de fixer les priorités dans leur riposte au VIH, à la tuberculose et à l’hépatite virale en milieu urbain. Au cours de son allocution, M. Khan a cité le problème des inégalités en matière de santé dans le monde, ainsi que la nécessité de mettre fin aux stigmatisations liées au VIH. Il a également rappelé le projet ambitieux de voir Londres exempte de nouvelles infections, de décès et de stigmatisations liés au VIH d’ici 2030.
« Je suis honoré de voir réunies aujourd’hui à Londres des personnalités de différentes villes du monde entier et du domaine de la santé. Le premier rassemblement international du réseau Les villes s’engagent est à marquer d’une pierre blanche dans notre lutte contre le VIH et les inégalités en matière de santé », a déclaré M. Khan. « Je suis fier du travail accompli à Londres pour lutter contre le VIH et les inégalités. Je me réjouis déjà des partages de connaissances et d’expériences à venir. Toutefois, malgré nos progrès, il reste toujours fort à faire au vu du nombre encore trop important de nouvelles contaminations. Afin de véritablement mettre un terme à tous les nouveaux cas de VIH à Londres, il est grand temps que le gouvernement rende la PrEP disponible via le NHS aux personnes qui en ont besoin. Finis la valse-hésitation et l’enchaînement de projets pilotes. Nous savons que cela fonctionne, enraye l’épidémie et économise de l’argent à long terme. »
Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines où le risque de contracter le VIH, la tuberculose et l’hépatite est beaucoup plus élevé à cause des dynamiques propres aux villes, comme le comportement social, les migrations, le chômage, mais aussi les inégalités sociales et économiques. Cependant, les villes et les municipalités disposent aussi de richesses intrinsèques pour accélérer les ripostes sanitaires et prendre des actions de transformation afin d’assurer que toutes et tous disposent d’un accès équitable aux services de santé.
« Nous constatons qu’il est essentiel de supprimer les inégalités, les déséquilibres dans les rapports de force, la marginalisation et les discriminations afin d’apporter une riposte efficace au VIH », a expliqué Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l’ONUSIDA, l'un des quatre partenaires clés de l’initiative Les villes s’engagent. « Les villes doivent utiliser leurs avantages pour encourager les innovations, la transformation sociale et la création de sociétés équitables, inclusives, réactives, résilientes et durables », a-t-elle ajouté.
Organisée par l’International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC) en collaboration avec le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et d’autres partenaires, la conférence Fast-Track Cities 2019 se déroule du 9 au 11 septembre 2019 au Barbican Centre. Elle a pour objectif de mettre en avant les résultats atteints au sein du réseau Les villes s’engagent, d’aborder les questions transversales auxquelles sont confrontés les acteurs locaux et de partager de bonnes pratiques pour accélérer la riposte au sida en milieu urbain, ainsi qu’aux maladies infectieuses liées comme la tuberculose et l’hépatite virale. Le programme de la conférence comporte des plénières, des tables rondes et des analyses présentées par les représentants des 300 villes que compte le réseau.
« Les inégalités en matière de santé empêchent les personnes vivant avec le VIH, la tuberculose et l’hépatite virale, notamment au sein des communautés ethniques minoritaires et privées de droits, d’accéder aux services nécessaires pour vivre plus longtemps et en bonne santé », a expliqué D. José M. Zuniga, Président/CEO de l’International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), l'un des partenaires clés de l’initiative Les villes s’engagent et organisateur de la conférence. « Nous sommes rassemblés à Londres à cause de son volontarisme politique, de son leadership en matière de santé publique, de l’aide qu’elle apporte aux prestataires de soins et de services, mais aussi de son engagement envers les communautés touchées. Cette volonté marquée a permis à la ville de dépasser les objectifs du programme sur le VIH de l’initiative Les villes s’engagent. Nous sommes ici pour braquer les projecteurs sur les efforts faits par Londres en vue de réduire et d’éliminer les inégalités en matière de santé qui vont à l’encontre des principes de la justice sociale. »
La capitale britannique avait déjà atteint les objectifs 90-90-90 de l’ONUSIDA au moment de rejoindre l’initiative Les villes s’engagent en janvier 2018. Ces objectifs sont définis comme suit : 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique vis-à-vis du VIH, 90 % de ces personnes ont accès à un traitement contre le VIH et que 90 % des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. Dans sa stratégie « London Getting to Zero », FTC London, un groupe d’acteurs de l’agglomération pilotant l’engagement de Londres pour Les villes s’engagent, met l’accent sur des programmes de proximité destinés à la communauté BAME (black, Asian and minority ethnic - communauté noire, asiatique et minorité ethnique).
La conférence Fast-Track Cities 2019 s’est ouverte officiellement avec une table ronde sur les inégalités en matière de santé réunissant des personnalités de haut niveau, dont les élus suivants :
- Kostas Bakoyannis (maire, Athènes, Grèce)
- Josefina Belmonte (maire, Quezon City, Philippines)
- Winston Ennis (adjoint au maire, Kingston, Jamaïque)
- Simone Kukenheim (adjointe au maire, Amsterdam, Pays-Bas)
- Fernando Medina (maire, Lisbonne, Portugal)
- Svante Myrick (maire, Ithaca, NY, USA)
- Robb Pitts (président, Fulton County, Atlanta, GA, USA)
- Mykola Povoroznyk, (premier adjoint, Kiev, Ukraine)
- Gennadiy Trukhanov (maire, Odessa, Ukraine)
Outre D. Zuniga de l’IAPAC et Mme Carlsson de l’ONUSIDA, ce panel se composait également de responsables internationaux de la santé publique, notamment :
- Amb. Deborah Birx (coordonnatrice de la lutte mondiale contre le sida pour le gouvernement américain, PEPFAR)
- Cary James (PDG, World Hepatitis Alliance)
- Suvanand Sahu (directeur général adjoint, Stop TB Partnership)
- Maimunah Mohd Sharif (directeur exécutif, ONU-Habitat)
- Trevor Stratton (membre du conseil d’administration, GNP+)
- Marijke Wijnroks (chef du personnel, Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme)
Henry Bonsu, présentateur résidant au Royaume-Uni et ancien journaliste pour la BBC, a assuré la modération de cette réunion.
Les cartes de presse pour la conférence Fast-Track Cities 2019 sont disponibles en contactant le directeur de la communication de l’IAPAC, Zack Pesavento, à l’adresse zpesavento@iapac.org.
Le programme de la conférence est disponible sur : https://www.iapac.org/conferences/fast-track-cities/#program
À propos de l’International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC)
Forte de plus de 30 000 membres dans le monde entier, l’IAPAC est la première association de cliniciens et de professionnels affiliés de la santé unis dans le but de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d’ici 2030. Veuillez consulter le site de l’association pour en savoir plus sur l’IAPAC et nos activités à l’international : https://www.iapac.org/
À propos de l’initiative Les villes s’engagent
Le partenariat international Les villes s’engagent regroupe près de 300 villes et municipalités, l’International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et la Ville de Paris. Tous collaborent pour en finir avec l’épidémie de sida, de tuberculose et d’hépatite virale d’ici à 2030. Cette initiative a été lancée au cours de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2014 à Paris. Veuillez consulter le site suivant pour en savoir plus : https://www.iapac.org/fast-track-cities/about-fast-track/
ONUSIDA
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour mettre un terme à l’épidémie de sida à l’horizon 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.