

Press Release
Des dirigeant-e-s du monde entier s’unissent pour réclamer un vaccin universel contre le COVID-19
14 mai 2020 14 mai 2020Plus de 140 dirigeant-e-s et expert-e-s du monde entier, dont le Président de l’Afrique du Sud et Président de l’Union africaine, Cyril Ramaphosa, le Premier Ministre du Pakistan, Imran Khan, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall et le Président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ont signé une lettre ouverte appelant tous les gouvernements à s’unir en faveur d’un vaccin universel contre le COVID-19. Cet appel a été lancé quelques jours seulement avant la réunion virtuelle des ministres de la Santé à l’occasion de l’Assemblée mondiale de la santé, qui se tiendra le 18 mai.
Dans cette lettre, qui constitue la prise de la position politique la plus ambitieuse à ce jour sur un vaccin contre le COVID-19, les dirigeant-e-s exigent que tous les vaccins, traitements et tests soient produits en masse, libres de brevet, distribués sur un pied d’égalité et mis gratuitement à la disposition de toute la population, et ce dans tous les pays.
Parmi les autres signataires figurent l’ancienne Présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, l’ancien Premier Ministre du Royaume-Uni, Gordon Brown, l’ancien Président du Mexique, Ernesto Zedillo, ainsi que l’ancienne administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement et ancienne Première Ministre de la Nouvelle-Zélande, Helen Clark.
Ces personnalités se joignent à d’éminent-e-s économistes, défenseur-e-s de la santé et autres dignitaires, comme Mary Robinson, présidente du groupe des « Global Elders » et ancienne Présidente de l’Irlande, Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel, Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine, John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, et Dainius Pūras, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.
« À l’heure actuelle, des milliards de personnes attendent un vaccin, qui est notre plus grand espoir de mettre fin à cette pandémie », a déclaré Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud. « En tant que pays d’Afrique, nous sommes déterminés à faire en sorte que le vaccin contre le COVID-19 soit mis au point et distribué rapidement, exempt de brevets et gratuit pour tou-te-s. Toutes les avancées scientifiques doivent être partagées entre les gouvernements. Personne ne doit se voir relégué au dernier rang de la file d’attente pour le vaccin du fait de son lieu de résidence ou de ses revenus ».
« Il nous faut travailler ensemble pour vaincre ce virus. Nous devons mettre en commun toutes les connaissances, l’expérience et les ressources à notre disposition pour le bien de l’humanité toute entière », a déclaré Imran Khan, Premier Ministre du Pakistan. « Les dirigeant-e-s du monde ne sauraient trouver le repos tant que chaque individu, dans chaque pays, n’est pas en mesure de bénéficier rapidement et gratuitement d’un vaccin ».
Cette lettre, coordonnée par ONUSIDA et Oxfam, met en garde contre le fait que le monde ne peut se permettre d’ériger des barrières (comme les monopoles et la concurrence) faisant obstacle à la nécessité universelle de sauver des vies.
« Nous sommes confronté-e-s à une crise sans précédent qui exige une réponse sans précédent », a déclaré l’ancienne Présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. « En tirant des leçons de la lutte contre le virus Ebola, les gouvernements doivent lever tous les obstacles à la mise au point et au déploiement rapide des vaccins et des traitements. Aucun intérêt n’est plus grand que le besoin universel de sauver des vies. »
Les dirigeant-e-s ont noté que des progrès sont faits et qu’une coopération multilatérale s’est instaurée entre de nombreux pays et organisations internationales en matière de recherche et de développement, de financement et d’accès. Citons notamment les 8 milliards de dollars US recueillis par l’Union européenne en promesses de dons, à l’occasion de son appel international lancé le 4 mai.
Toutefois, alors que de nombreux pays et entreprises avancent à un rythme sans précédent vers la mise au point d’un vaccin efficace, les dirigeant-e-s demandent des engagements concrets pour faire en sorte que ce futur vaccin soit abordable et disponible pour tou-te-s dans les plus brefs délais. Ces engagements sont les suivants :
- Une mise en commun obligatoire au niveau mondial des brevets et le partage de la totalité des connaissances, des données et des technologies en relation avec le COVID-19, afin de garantir que tout pays puisse produire ou acheter à un prix abordable des doses de vaccins, des traitements et des tests.
- La mise en place rapide d’un plan mondial de fabrication et de distribution équitable de tous les vaccins, traitements et tests, entièrement financé par les pays riches et garantissant des « prix coûtants réels » en toute transparence ainsi qu’un approvisionnement fondé sur les besoins, plutôt que sur la capacité à payer.
- Cela impliquerait de prendre des mesures urgentes pour accroître considérablement les capacités de fabrication afin de produire les vaccins en quantité suffisante, ainsi que de former et recruter des millions de professionnel-le-s de la santé pour les distribuer.
- La garantie que les vaccins, les traitements et les tests du COVID-19 seront mis gratuitement à la disposition de toute la population, partout dans le monde, en accordant la priorité aux travailleurs/ses les plus exposé-e-s, aux personnes vulnérables et aux pays pauvres qui ont des capacités moindres pour sauver des vies.
« Face à cette crise, nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n’était. La santé de chacun-e d’entre nous dépend de celle de tou-te-s les autres », a déclaré Helen Clark, ancienne Première Ministre de Nouvelle-Zélande. « Le vaccin contre le COVID-19 ne doit appartenir à personne et doit être gratuit pour tout le monde. Sur le plan diplomatique, les formules creuses ne suffisent pas : nous avons besoin de garanties juridiques, et ce sans attendre ».
« Les solutions du marché ne sont pas appropriées pour lutter contre une pandémie », a déclaré Nelson Barbosa, ancien ministre des Finances du Brésil. « Un système de santé publique, comprenant une vaccination et une prise en charge gratuites dès qu’elles sont disponibles, est essentiel pour faire face au problème, comme le montre l’expérience brésilienne en matière de licences obligatoires pour les médicaments antirétroviraux dans le cas du VIH ».
Ensemble pour un vaccin universel contre le COVID-19 — lettre ouverte et liste complète de signataires.
Contact
UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott
tel. +41 79 514 68 96
bartonknotts@unaids.org
Oxfam
Anna Ratcliff
tel. +44 7796 993288
anna.ratcliff@oxfam.org
Oxfam
Annie Theriault
tel. +51 936 307 990
annie.theriault@oxfam.org


Press Release
Le coût de l'inaction : la perturbation des services liée à la COVID-19 pourrait entraîner des centaines de milliers de décès supplémentaires dus au VIH
11 mai 2020 11 mai 2020Les progrès réalisés en matière de prévention de la transmission mère-enfant du VIH pourraient être remis en cause, du fait de l’augmentation de 104 % des nouvelles infections par le VIH chez les enfants.
GENÈVE, 11 mai 2020 - Un groupe de modélisation convoqué par l'Organisation mondiale de la Santé et l'ONUSIDA a estimé que si des efforts ne sont pas déployés pour atténuer et surmonter les effets de la perturbation des services de santé et de l’approvisionnement en fournitures sanitaires pendant la pandémie de COVID-19, une interruption de six mois d’un traitement antirétroviral pourrait entraîner plus de 500 000 décès supplémentaires dus à des maladies liées au sida, y compris la tuberculose, en Afrique subsaharienne, en 2020-2021. Selon les estimations, en 2018, 470 000 décès dus à des maladies liées au sida avaient été enregistrés dans la région.
Il existe différentes raisons susceptibles d’entraîner une interruption des services. Cet exercice de modélisation montre clairement que les communautés et les partenaires doivent agir dès maintenant car l'impact d'une interruption de six mois d’un traitement antirétroviral pourrait effectivement provoquer un retour en arrière à l’année 2008 au cours de laquelle plus de 950 000 décès liés au sida ont été enregistrés dans la région. Par ailleurs, un grand nombre de décès continuerait à être observés du fait de cette interruption, et ce pendant au moins les cinq années suivantes, avec un nombre annuel moyen plus important de décès s’élevant à 40 % au cours des cinq prochaines années. En outre, l'interruption des services liés au VIH pourrait également avoir un certain impact sur l'incidence du VIH au cours de l'année prochaine.
« La terrible perspective de voir un demi-million de personnes supplémentaires en Afrique mourir de maladies liées au sida équivaut à un retour en arrière dans l'histoire », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.
« Nous devons interpréter ceci comme un signal d’alarme à l’intention des pays afin qu'ils définissent des moyens de maintenir l’ensemble des services de santé vitaux. Concernant le VIH, certains pays prennent déjà des mesures importantes, par exemple en veillant à ce que les patients puissent retirer, aux points de dépôt, de grandes quantités de médicaments et d'autres produits essentiels, notamment des kits d'autodépistage, ce qui permet de réduire la pression exercée sur les services et personnels de santé. Nous devons également faire en sorte que l'offre mondiale de tests et de traitements continue d'affluer vers les pays qui en ont besoin », a ajouté le Dr Tedros.
En Afrique subsaharienne, on estime que 25,7 millions de personnes vivaient avec le VIH et que 16,4 millions (64 %) étaient sous traitement antirétroviral en 2018. Ces personnes risquent aujourd'hui de voir leur traitement interrompu car les services de lutte contre le VIH sont fermés ou dans l’incapacité de fournir des traitements antirétroviraux en raison des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ou tout simplement car les services sont submergés du fait des besoins concurrents en appui à la riposte à la COVID-19.
« La pandémie de COVID-19 ne doit pas être une excuse pour détourner les investissements de la lutte contre le VIH », a déclaré Mme Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l'ONUSIDA. « Ces acquis remportés de haute lutte contre le sida risquent d’être sacrifiés au profit de la lutte contre la COVID-19, mais le droit à la santé signifie qu'aucune maladie ne doit être combattue aux dépens d’une autre ».
Lorsque le traitement est observé, la charge virale du VIH baisse à un niveau indétectable, ce qui permet de maintenir les personnes atteintes en bonne santé et d’empêcher la transmission du virus. Lorsqu'une personne n’est pas en mesure de prendre régulièrement un traitement antirétroviral, la charge virale augmente, ce qui a une incidence sur la santé de la personne et peut au bout du compte entraîner la mort. Des interruptions de traitement relativement courtes peuvent aussi avoir un impact négatif majeur sur la santé d'une personne et sur la possibilité de transmission du VIH.
Dans le cadre de cette recherche, cinq équipes de spécialistes de la modélisation ont été réunis, et différents modèles mathématiques ont été utilisés pour analyser les effets de diverses perturbations possibles des services de dépistage, de prévention et de traitement du VIH causées par la COVID-19.
Chaque modèle a examiné l'impact potentiel d'une interruption de traitement d’une durée de trois ou six mois sur la mortalité due au sida et l'incidence du VIH en Afrique subsaharienne. Dans le scénario d’une interruption de six mois, les estimations du nombre de décès supplémentaires liés au sida qui seraient enregistrés en une année allaient de 471 000 à 673 000, par conséquent, de toute évidence, le monde n’atteindra pas la cible mondiale d’ici à 2020, consistant à parvenir à moins de 500 000 décès liés au sida à l’échelle mondiale
Des interruptions plus courtes, de trois mois, auraient un impact réduit mais toutefois significatif sur les décès dus au VIH. Des interruptions plus sporadiques de l'approvisionnement en traitements antirétroviraux entraîneraient une observation sporadique du traitement, et ainsi une propagation de la résistance aux médicaments contre le VIH, avec des conséquences à long terme concernant les futurs succès en matière de traitement dans la région.
Des services perturbés pourraient également inverser la tendance eu égard aux progrès accomplis en matière de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Depuis 2010, les nouvelles infections par le VIH chez les enfants en Afrique subsaharienne ont diminué de 43 %, passant de 250 000 en 2010 à 140 000 en 2018, grâce à la forte couverture par les services de lutte contre le VIH pour les mères et leurs enfants dans la région. Une diminution de la fourniture de ces services du fait de la COVID-19 pendant six mois pourrait entraîner une augmentation considérable des nouvelles infections par le VIH chez les enfants, jusqu'à 37 % au Mozambique, 78 % au Malawi, 78 % au Zimbabwe et 104 % en Ouganda.
Parmi les autres incidences significatives de la pandémie de COVID-19 sur la lutte contre le sida en Afrique subsaharienne susceptibles d’entraîner un taux de mortalité plus élevé, figurent notamment la baisse de la qualité des soins cliniques en raison de la surcharge de la capacité des établissements de santé et de la suspension des tests de dépistage de la charge virale, la réduction des services de conseils fournis en matière d’observation des traitements et les modifications des schémas thérapeutiques. Chaque modèle a également pris en compte la mesure dans laquelle une interruption des services de prévention, notamment la suspension de la circoncision masculine médicale volontaire, l'interruption de la disponibilité de préservatifs et la suspension des tests de dépistage du VIH, aurait un impact sur l'incidence du VIH dans la région.
Les résultats des travaux de recherche soulignent la nécessité de déployer des efforts urgents pour garantir la continuité des services de prévention et de traitement du VIH afin d'éviter une augmentation des décès dus au VIH et de prévenir une incidence accrue du VIH pendant la pandémie de COVID-19. Il sera important que les pays accordent la priorité au renforcement des chaînes d'approvisionnement, qu’ils veillent à ce que les personnes déjà sous traitement puissent continuer à en bénéficier, notamment grâce à l’adoption ou au renforcement de politiques telles que la délivrance sur plusieurs mois d’antirétroviraux afin de réduire les exigences en matière d'accès aux établissements de soins de santé, réduisant ainsi la charge qui pèse sur des systèmes de santé submergés.
« Chaque décès est une tragédie », a ajouté Mme Byanyima. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup de jeunes, mourir inutilement. Je prie instamment les gouvernements de veiller à ce que chaque homme, femme ou enfant vivant avec le VIH reçoive régulièrement un approvisionnement en traitements antirétroviraux, lesquels sont salvateurs », a déclaré Mme Byanyima.
Sources :
Jewell B, Mudimu E, Stover J, et al for the HIV Modelling consortium, Potential effects of disruption to HIV programmes in sub-Saharan Africa caused by COVID-19: results from multiple models. Pre-print, https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12279914.v1, https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12279932.v1.
Alexandra B. Hogan, Britta Jewell, Ellie Sherrard-Smith et al. The potential impact of the COVID-19 epidemic on HIV, TB and malaria in low- and middle-income countries. Imperial College London (01-05-2020). doi: https://doi.org/10.25561/78670.
ONUSIDA
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida ». L'ONUSIDA conjugue les efforts de 11 institutions des Nations Unies — le HCR, l'UNICEF, le PAM, le PNUD, l'UNFPA, l'UNODC, ONU Femmes, l'OIT, l'UNESCO, l'OMS et la Banque mondiale. Il collabore étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour mettre un terme à l'épidémie de sida à l'horizon 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.
OMS
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est l’autorité directrice dans le domaine de la santé publique au niveau mondial dans le cadre du système des Nations Unies. Fondée en 1948, l’OMS compte 194 États Membres dans six Régions et plus de 150 bureaux, et fait en sorte de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables. Notre objectif pour 2019-2023 est de faire en sorte qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient de la couverture sanitaire universelle, qu’un milliard de personnes supplémentaires soient protégées face aux situations d’urgence sanitaire et qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être.
Contact
UNAIDS Mediatel. tel. +41 22 791 4237
communications@unaids.org
WHO Media
Tarik Jašarević
tel. tel. +41 79 367 6214
jasarevict@who.int
WHO Media
Sarah Russell
tel. tel. +41 79 598 6823
russellsa@who.int

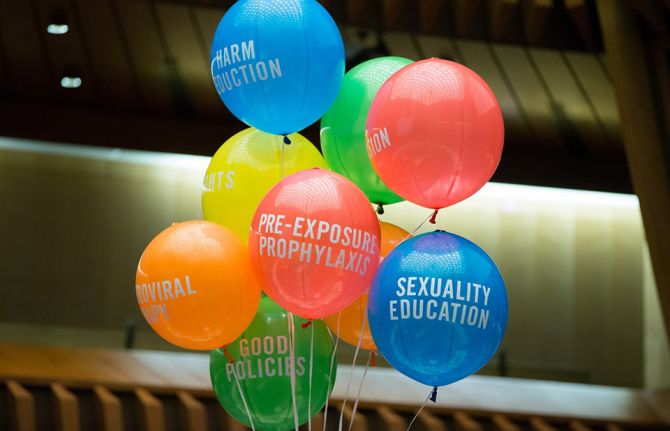
Press Release
L’ONUSIDA enjoint aux gouvernements de ne pas perdre de vue la prévention du VIH au cours de la pandémie de COVID-19
06 mai 2020 06 mai 2020Systèmes de santé débordés, confinements, pertes de revenus, moins d'emplois... tout cela pourrait engendrer une augmentation des rapports sexuels non protégés, de la violence et de l’exploitation sexuelles, des relations sexuelles rémunérées et du commerce du sexe, entraînant ainsi une recrudescence des nouvelles infections au VIH
GENÈVE, le 6 mai 2020—Malgré les progrès faits dans le domaine de la prévention du VIH dans le monde, avec un recul de 40% des nouvelles infections depuis le pic de 1997, ces avancées chèrement acquises sont menacées par la pandémie de COVID-19 qui s’abat actuellement sur la planète.
À l’heure de l’épidémie de coronavirus, l’ONUSIDA enjoint aux gouvernements de ne pas faiblir dans leurs efforts de prévention du VIH et de garantir que les populations continuent d’avoir accès aux services nécessaires pour éviter toute infection, discrimination et violence, mais aussi pour être en mesure de jouir de leur santé sexuelle et de la reproduction ainsi que des droits afférents.
« Tous les pays et toutes les communautés pratiquement sans exception sont touchés par la COVID-19, mais l’épidémie mondiale de VIH n’a pas disparu pour autant », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Des personnes continuent d’avoir des rapports sexuels. Des personnes continuent de consommer des drogues. Au cours de la pandémie de COVID-19, chacune et chacun doit avoir à sa disposition les outils nécessaires pour assurer sa protection et se protéger du VIH. Les droits humains forment une pierre angulaire de la prévention du VIH et doivent également l’être pour la riposte à la COVID-19. »
L’ONUSIDA et des partenaires de la Global HIV Prevention Coalition viennent de publier trois nouveaux documents relatifs à la prévention du VIH. Ils sont dédiés aux manières de maintenir les services de prévention du VIH et de leur donner la priorité à l’heure de la COVID-19. Ces documents se penchent sur les mesures essentielles pour garder en vie et en bonne santé les populations les plus vulnérables. Il s’agit notamment de mesures nécessaires pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des enfants et de lutter contre elle, mais aussi de mesures permettant de garantir la disponibilité de l’approvisionnement en produits de première nécessité et d’assurer la subsistance des plus démunis à travers le monde.
Ces documents expliquent que la palette d’options de prévention du VIH n’a pas perdu de sa pertinence : préservatifs masculins et féminins, lubrifiants, aiguilles et seringues stériles ainsi que thérapies de substitution aux opiacés destinées aux personnes consommant des drogues injectables, prophylaxie pré- et post-exposition, ainsi que le traitement en tant que forme de prévention. Il faut néanmoins trouver des solutions innovantes pour apporter des produits de prévention du VIH aux personnes qui en ont besoin : distribution en quantité suffisante pour plusieurs mois, permettre aux centres de distribution de rester ouverts au cours des confinements, mais aussi protéger les points de distribution au sein des communautés, etc.
L’ONUSIDA s’inquiète du fait que l’épidémie de COVID-19 puisse augmenter la vulnérabilité face au VIH, en plus d’entraver les services de prévention et de traitement afférents. La perte à grande échelle de revenus et d'emplois pourrait se traduire par une augmentation des relations sexuelles rémunérées, du commerce du sexe et de l’exploitation sexuelle. Cela exposera des personnes à un risque accru de contracter le VIH sauf si elles disposent des moyens de se protéger.
À l’instar des produits de prévention du VIH, il est essentiel de maintenir la fourniture de services et de programmes de prévention du VIH, de prévention de la violence basée sur le genre, ainsi que de promotion de la santé et des droits de la reproduction et sexuels en tant que services fondamentaux. Les services de test et de conseil, le dépistage et le traitement d’infections sexuellement transmissibles, la continuité de l’accès aux services de santé de la reproduction et sexuelle, les services de proximité fournis par la communauté ou des pairs, les services d’assistance psychosociale, les centres d’accueil destinés aux populations clé et vulnérables, l’éducation sexuelle complète et la protection contre la violence sexuelle sont vitaux pour maintenir la riposte de la prévention du VIH. Les confinements imposés au cours de la riposte à la COVID-19 ont provoqué une augmentation alarmante des cas signalés de violence familiale et exercée par un partenaire intime à l’égard des femmes, mais aussi des violences à l’extérieur du foyer, ce qui demande de renforcer de toute urgence les services de prévention, de protection et de soutien liés à la violence sexuelle et basée sur le genre.
Alors que l’éloignement physique et les confinements interdisent à présent la fourniture de services en face à face, l’ONUSIDA appelle à lancer urgemment des solutions innovantes pour permettre d’y accéder. Les dangers liés aux réunions présentielles peuvent être réduits en utilisant des systèmes de prise de rendez-vous qui évitent toute concentration de personnes dans un établissement. Il est aussi possible d’organiser des réunions et des formations en ligne, quant aux lignes d’assistance téléphonique et aux services par SMS, ils ont aussi leur mot à dire pour protéger les populations du nouveau coronavirus tout en garantissant qu’elles puissent obtenir l’aide dont elles ont besoin pour éviter une infection au VIH. L’autodépistage du VIH est une méthode plus sure pour effectuer un test tout en réduisant les contacts avec d’autres personnes et en délestant les établissements de santé.
Les organisations et les réseaux communautaires sont depuis longtemps un pivot de la riposte au sida. Ils sont essentiels pour sensibiliser, informer, balayer les idées reçues et lutter contre les fausses informations, mais aussi pour fournir des services aux populations marginalisées et vulnérables. Aujourd’hui plus que jamais, il faut soutenir les acteurs communautaires dans leurs efforts pour innover, fournir des services et être reconnus en tant que prestataires essentiels aussi bien au sein de la riposte au VIH qu’au cours de la riposte à la COVID-19.
Quarante années de lutte contre le VIH nous ont fourni des enseignements précieux, notamment que la pandémie de COVID-19 n’affectera pas tout le monde de la même manière et que les plus défavorisés, y compris les populations clés, seront les plus touchés. Dans ces trois nouveaux documents, l’ONUSIDA enjoint aux gouvernements d'adopter une approche respectant les droits humains et de prioriser les besoins des populations les plus marginalisées au cours de l’épidémie de COVID-19, ce qui nécessite notamment de continuer à assurer les services fondamentaux de prévention du VIH.
Contact
UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott
tel. +41 79 514 6896
bartonknotts@unaids.org
UNAIDS Media
tel. +41 22 791 4237
communications@unaids.org


Press Release
Vives inquiétudes de l’ONUSIDA et de MPact devant la stigmatisation et les abus que subissent les personnes LGBTI pendant l’épidémie de COVID-19
27 avril 2020 27 avril 2020
L’ONUSIDA et MPact appellent les gouvernements et les partenaires à protéger, soutenir et respecter les droits humains des personnes LGBTI au cours de la riposte à la COVID-19
GENÈVE, le 27 avril 2020—L’ONUSIDA et MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights sont alarmés d’apprendre que des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées) sont visées spécifiquement dans des groupes, accusées, victimes d’abus, incarcérées et stigmatisées à la suite d’allégations les faisant passer pour des vecteurs de maladie au cours de la pandémie de COVID-19. L’ONUSIDA et MPact sont ainsi extrêmement préoccupés par le fait que ces actes discriminatoires aggravent les difficultés que rencontrent déjà les personnes LGBTI pour faire valoir leurs droits, notamment pour accéder à des services de santé sûrs et de qualité.
« Le VIH nous a appris que la violence, les agressions et la discrimination ne servent qu’à marginaliser davantage les personnes les plus défavorisées », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima. « Tout le monde, indépendamment de son orientation sexuelle, de son identité ou expression de genre, a droit à la santé et à la sécurité, sans exception. Le respect et la dignité sont nécessaires aujourd’hui plus que jamais. »
Au Belize, des informations détaillées dénoncent les exactions de la police dont a été victime un homme gay. Ce dernier a été arrêté, humilié et battu pour n’avoir pas respecté le couvre-feu instauré pour freiner la propagation du coronavirus. Cet homme de 25 ans vivait avec le VIH et on pense qu’il est mort des complications des blessures infligées par la police.
« Nous avons reçu des rapports indiquant que des gouvernements et des leaders religieux dans certains pays font de fausses déclarations et répandent des informations erronées sur la COVID-19 qui incitent à la violence et à la discrimination envers les personnes LGBTI », explique George Ayala, Directeur exécutif du MPact. « Des descentes de police prennent pour cible des organisations et des domiciles, des personnes LGBTI sont battues et les arrestations et menaces de reconduite à la frontière pour les demandeur(se)s d’asile LGBTI augmentent. »
En Ouganda, 20 membres de la communauté LGBTI ont été récemment arrêtés au cours d’une razzia visant un refuge. Les autorités de police ont justifié cette action en les accusant de ne pas respecter les mesures de distanciation sociale. Aux Philippines, trois personnes LGBTI se trouvaient parmi un groupe qui a été humilié publiquement pour les punir de ne pas avoir respecté le couvre-feu. Après que des scènes de l’incident sont devenues virales sur Internet, le capitaine de police a été forcé de présenter des excuses pour avoir ciblé distinctement les personnes LGBTI du groupe et pour leur avoir ordonné de danser et de s’embrasser.
« L'utilisation gouvernementale des technologies en ligne et les smartphones pour surveiller les déplacements de la population pendant le confinement ou le couvre-feu inquiète de plus en plus pour ce qui est de la protection de la vie privée et de la confidentialité », ajoute M. Ayala. « Les hommes gays et les personnes anti conformistes au genre sont souvent les premières cibles et parmi les populations les plus touchées par un renforcement des mesures de police et de surveillance. »
Pour certaines personnes LGBTI, le confinement volontaire et la distanciation sociale peuvent être des expériences particulièrement difficiles, voire dangereuses. Beaucoup d’entre elles sont victimes de violences ou de mauvais traitements alors qu’elles sont cloîtrées avec des membres de leur famille qui ne les acceptent pas. Les personnes LGBTI peuvent également souffrir de la violence exercée par un partenaire intime en restant chez elles sans avoir la possibilité de signaler ces abus à la police par peur des conséquences. Le confinement peut aussi exacerber des difficultés psychologiques existantes qui sont monnaie courante parmi la communauté LGBTI, y compris la solitude, la dépression, l’angoisse et les tendances suicidaires.
La pandémie de COVID-19 laisse de nombreux hommes gays et femmes transgenres sans outils adaptés pour prendre en main leur santé sexuelle et leurs droits. Les hommes gays représentent près de 20 % des nouvelles infections au VIH et présentent 22 fois plus de risques d’infection par rapport au reste de la population masculine. Le risque d’infection au VIH des femmes transgenres est 12 fois plus élevé que pour la population générale.
Les mesures appelant à rester chez soi, en particulier lorsqu’elles ne tolèrent pas d’exceptions, aggravent les difficultés que ces groupes rencontrent déjà pour accéder à la thérapie antirétrovirale, à la prévention du VIH et aux services de réassignation sexuelle, y compris les thérapies hormonales. C’est particulièrement vrai pour les personnes LGBTI pauvres, au chômage, sans domicile ou dans une situation de logement précaire.
L’ONUSIDA et MPact enjoignent aux pays de :
- Dénoncer les fausses informations qui prennent pour bouc émissaire, diffament ou font porter la responsabilité de la propagation de la COVID-19 d’une tout autre manière aux personnes LGBTI.
- Arrêter les razzias visant les organisations, les refuges et les espaces dirigés par la communauté LGBTI, ainsi que de cesser d’arrêter des personnes à cause de leur orientation sexuelle, de leur identité ou expression de genre.
- Garantir que toutes les mesures de protection de la santé publique ne sont pas disproportionnées, sont étayées par des données probantes et respectent les droits humains.
- Empêcher l'État de surveiller les personnes LGBTI via les technologies de communication individuelle.
- Investir dans la riposte à la COVID-19 tout en préservant les fonds et les programmes de santé sexuelle/sur le VIH qui sont inclusifs et prennent en compte les besoins des personnes LGBTI.
- Garantir l’accès ininterrompu à un soutien médical vital, y compris à la réduction des risques, aux préservatifs et aux lubrifiants, à la prophylaxie pré-exposition, à la thérapie antirétrovirale, aux hormonothérapies substitutives et aux services de santé mentale destinés aux personnes LGBTI.
- Proposer des options souples pour fournir les services, depuis la délivrance d’ordonnances pour plusieurs mois de traitement jusqu’aux livraisons dans la communauté, les consultations en ligne et les services d'assistance.
- Penser à désigner des organisations de services dirigées par la communauté en tant que prestataires essentielles, de sorte qu'elles puissent fournir en toute sécurité des services fondamentaux en sachant s’adapter.
- Inclure les personnes LGBTI dans les programmes nationaux de protection sociale, y compris les aides liées à la perte de revenus.
- Améliorer l’accès à un hébergement d’urgence adapté pour les personnes LGBTI sans domicile et récemment expulsées.
- Impliquer les personnes LGBTI dans la planification de la santé publique et la communication concernant la COVID-19.
- Mettre en place une surveillance de la sécurité et une protection contre le piratage informatique au cours des réunions en ligne.
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous mobiliser et faire groupe pour protéger et promouvoir les droits humains et à la santé des personnes LGBTI du monde entier.
MPact
MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights a vu le jour en 2006 à l’initiative d’un groupe de militants préoccupés par les disparités liées au VIH ainsi que par la stigmatisation, la discrimination, les violences et la criminalisation dont sont victimes les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans toutes les régions du monde. MPact est aujourd’hui un réseau bien ancré au niveau international qui s’engage à lutter pour garantir un accès équitable aux services du VIH à tous les hommes gays tout en assurant la promotion des droits humains et du droit à la santé. L'organisation entretient des liens directs avec près de 150 organisations de la communauté dans 62 pays et des milliers d’autres utilisent ses différentes plateformes sur les réseaux sociaux pour alimenter leur lutte. MPact accomplit sa mission en : assurant une veille des gouvernements, des financeurs et autres décisionnaires ; renforçant les capacités des organisations de la communauté et les prestataires de santé ; apportant son soutien à la multiplication de réseaux dirigés par des hommes gays ; menant et mandatant des recherches ; et en facilitant l’échange d’informations entre les régions.
Contact
UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott
tel. +41 79 514 68 96
bartonknotts@unaids.org
MPact, Oakland, USA
Greg Tartaglione
gtartaglione@mpactglobal.org
Ressources

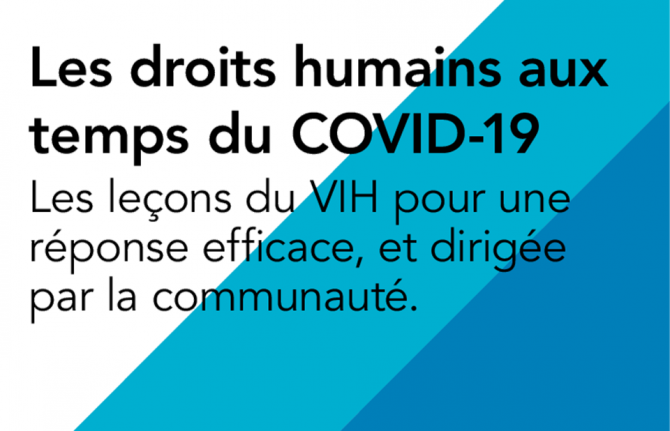
Press Release
Épidémie de COVID-19 : l’ONUSIDA demande une stratégie prenant en compte les droits humains et mettant l’accent sur les communautés
20 mars 2020 20 mars 2020GENÈVE, le 20 mars 2020—L’ONUSIDA appelle les pays à adopter une approche basée sur les droits de l’homme pour lutter contre l’épidémie mondiale de COVID-19. Cette stratégie doit mettre l’accent sur les communautés et respecter les droits et la dignité de toute personne. L’ONUSIDA a rédigé un nouveau guide qui s’inspire des leçons tirées de la riposte à l’épidémie du VIH. Ce document vise à aider les gouvernements, les communautés et d’autres acteurs à élaborer et mettre en place des mesures pour contenir la pandémie : Rights in the time of COVID-19: lessons from HIV for an effective, community-led response.
Ce nouveau guide de l’ONUSIDA se fonde sur la législation et les obligations internationales en matière de droits humains. Il souligne un principe important : la riposte à une épidémie ne consiste pas à trouver un équilibre entre la santé publique et les droits humains, mais elle nécessite que nous les respections pour réussir efficacement. Ce document a été élaboré par un groupe d'expertes et d’experts internationaux issus de communautés, du domaine de la santé publique, du monde universitaire, ainsi que des Nations Unies.
« Toute riposte réussie à une épidémie mondiale puise toujours ses racines dans le respect des droits humains et le leadership des communautés », a déclaré Winnie Byanyima, la Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Les pays qui réussissent le mieux à réduire l’impact du VIH sont ceux qui ont adopté des stratégies encourageant les communautés à faire un dépistage ou un test et, le cas échéant, à se soigner, à se protéger et à protéger les autres de la contamination au virus. »
Ce guide fournit des informations importantes tirées de la riposte au sida. Elles sont indispensables pour assurer une approche efficace des urgences sanitaires basée sur les droits de l'homme : lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes des individus et des communautés affectés, prioriser les mesures envers les populations les plus vulnérables, supprimer les obstacles aux droits humains, instaurer la confiance entre les communautés et les autorités sanitaires, ainsi que protéger le personnel médical en première ligne.
Comme l’indique ce document, les épidémies ont tendance à révéler et à exacerber les inégalités sociales existantes en se faisant souvent particulièrement sentir parmi les groupes marginalisés et vulnérables. Il faut supprimer les barrières financières et d’autre nature qui empêchent les personnes d’obtenir l’assistance médicale et les conseils nécessaires, que ce soit pour eux ou pour améliorer la santé publique au sens large.
Ce guide met aussi en garde contre les restrictions généralisées obligatoires des déplacements et les sanctions pénales envers les personnes touchées par une épidémie comme celle de COVID-19. De telles mesures ont tendance à toucher de manière disproportionnée les groupes les plus vulnérables et à freiner davantage l'accès à la santé. Les restrictions imposées doivent respecter les droits humains et être nécessaires, raisonnables, étayées par des données probantes et pour une durée limitée. Encourager la population à se protéger et à protéger les autres par des mesures volontaires permet d'optimiser l'impact.
« La situation est grave et difficile pour tout le monde, » a dit Mme Byanyima. « Pour la surmonter, nous devons puiser dans l’expérience précieuse tirée de ripostes à d’autres épidémies mondiales comme le VIH, mais aussi l'enraciner dans les droits humains, impliquer les communautés et n’oublier personne. »




Press Release
L’ONUSIDA et les Volontaires des Nations Unies renforcent leur collaboration
09 mars 2020 09 mars 2020GENÈVE, le 9 mars 2020—L’ONUSIDA et le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) ont signé un mémorandum d’accord afin d’intensifier la collaboration entre les deux organisations. Ce nouveau document définit l’avenir de leur coopération en vue de promouvoir le volontariat et d’attirer des Volontaires des Nations Unies pour aider les personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus.
« Les volontaires jouent un rôle irremplaçable dans la riposte au VIH depuis le tout début de l’épidémie », explique Tim Martineau, Directeur exécutif adjoint par intérim de l’ONUSIDA chargé de la gestion et de la gouvernance. « L’ONUSIDA reconnaît ainsi leur importance et leur engagement, et continuera de soutenir leur contribution aux efforts internationaux pour mettre fin au sida. »
Au cours de dix dernières années, 97 Volontaires des Nations Unies ont travaillé pour l’ONUSIDA dans 36 pays afin de mettre un terme aux nouvelles infections, de garantir l’accès de chaque personne vivant avec le VIH à un traitement, de défendre et de promouvoir les droits humains et de générer des données pour aider la prise de décisions.
« Le VIH n’est pas qu’un problème de santé. C’est un frein au développement et à la justice sociale qui touche de nombreux Objectifs de développement durable », continue Olivier Adam, le Coordinateur exécutif du programme VNU. « Et c’est là où le programme VNU entre en jeu. Nos volontaires jouissent de conditions exceptionnelles pour entrer en contact avec les populations et pour respecter les objectifs du plan 2030 en le mettant en œuvre au niveau des communautés, national, régional et international. »
Tobias Volz, Volontaire international de l’ONU, a rejoint en 2018 le bureau pays de l’ONUSIDA pour le Népal, le Bhoutan et le Bangladesh. Il a aidé à élaborer et à mettre en place l’initiative Live2Luv menée par des jeunes sur les médias sociaux, une plateforme permettant aux jeunes Népalais et Népalaises d’exprimer leurs inquiétudes, de poser des questions et de briser les tabous entourant la santé de la reproduction et sexuelle.
« Au Népal, Live2Luv souhaite créer un environnement où la jeunesse népalaise peut poser ouvertement ses questions sur le sexe, la sexualité et la contraception, mais aussi recevoir les bonnes réponses », expliquer M. Volz. « Les ados ont besoin d’une éducation sexuelle complète adaptée à leur âge. Cette initiative de jeunes prévoit que des jeunes éduquent et apportent des connaissances à leurs pairs et les inspirent. »
Tian Liang, également Volontaire de l’ONU, a occupé jusqu’à récemment un poste de responsable de la communication au sein du bureau chinois de l’ONUSIDA. « Le programme VNU a été une opportunité extraordinaire d’utiliser mes compétences professionnelles pour sensibiliser le grand public au thème de la riposte au sida, tout en éliminant les idées fausses et les préjugés au sein de la société », indique M. Liang.
Volontaires des Nations Unies
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) contribue à soutenir la paix et le développement à travers le monde par le biais du volontariat. Nous travaillons en collaboration avec des partenaires pour intégrer des Volontaires des Nations Unies qui partagent une solide qualification et une forte motivation. Nous les encadrons sérieusement dans les programmes de développement et assurons la promotion de la valeur du volontariat ainsi que sa reconnaissance mondiale. www.unv.org


Press Release
Quarante ans après le début de l’épidémie du VIH, le sida demeure la première cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer—L’ONUSIDA appelle à prendre des mesures draconiennes
05 mars 2020 05 mars 2020Les discriminations et la violence basées sur le genre, les inégalités au niveau de l’éducation et le manque d’émancipation économique et de protection des droits et de la santé de la reproduction et sexuelle sont des entraves au progrès de la riposte
GENÈVE/JOHANNESBURG, le 5 mars 2020—À quelques jours de la Journée internationale des femmes, l’ONUSIDA a présenté un nouveau rapport montrant que les fortes inégalités entre les hommes et les femmes continuent d’être la cause de la plus grande vulnérabilité de la population féminine face au VIH. We’ve got the power appelle les gouvernements à s’engager davantage pour l’autonomisation et l’émancipation des femmes et des filles, ainsi que pour le respect de leurs droits de l’homme.
« L’épidémie du VIH nous renvoie aux inégalités et aux injustices auxquelles sont confrontées les femmes et les filles ainsi qu’aux disparités au niveau des droits et des services qui exacerbent l’épidémie », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA Winnie Byanyima. « C’est inacceptable, cela peut être évité et cela doit finir. »
Il y a 25 ans, des gouvernements prenaient une décision historique en adoptant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing. Cette feuille de route visionnaire était la plus complète en vue de faire respecter les droits de l’homme des femmes et des filles, ainsi que pour parvenir à l’égalité des sexes dans le monde.
Des progrès ont été réalisés dans des domaines clés. Davantage de filles sont scolarisées et l’écart au niveau du taux de scolarisation en école primaire des garçons et des filles se résorbe dans le monde entier. Dans certains pays, un nombre croissant de femmes sont impliquées dans la vie politique et d’autres gouvernements protègent dorénavant les droits des femmes dans leur législation. Le traitement du VIH s’est également démocratisé, si bien qu’à la mi-2019, plus de 24 millions de personnes vivant avec le VIH suivaient un traitement, dont plus de 13 millions de femmes de 15 ans et plus.
Le rapport montre cependant que de nombreuses promesses visant à améliorer le sort des femmes et des filles dans le monde n’ont pas été tenues. Près de 40 ans après le début de la riposte, le sida demeure une des principales causes de mortalité chez les femmes de 15 à 49 ans et près de 6 000 jeunes femmes de 15 à 24 ans sont contaminées par le virus chaque semaine.
We’ve got the power met en avant certains aspects à aborder en priorité, dont l’éradication de la violence à l’égard des femmes. Dans les régions à haute prévalence du VIH, il est prouvé que les violences exercées par un partenaire intime augmentent de 50 % le risque de contamination chez les femmes. La séropositivité est aussi parfois un élément déclencheur de violences. Les femmes vivant avec le VIH signalent régulièrement des violences de la part de leur partenaire intime, de membres de leur famille ou de leur communauté, ainsi qu’au sein de services de santé.
Le rapport souligne que hors de l’Afrique subsaharienne, la plupart des femmes exposées au VIH appartiennent aux communautés marginalisées, comme les travailleuses du sexe, les consommatrices de drogues injectables, les femmes transgenres et incarcérées. Toutefois, les inégalités entre les genres, la stigmatisation et la discrimination, la criminalisation, les violences et d’autres violations des droits de l’homme continuent de les empêcher d’accéder aux services dont elles ont besoin. Il faut réformer la législation afin de mettre un terme à la pénalisation et aux pratiques coercitives reposant sur la sexualité, l’activité sexuelle, le statut sérologique et le genre des individus.
Pour que la riposte au sida atteigne son efficacité maximale, les lois et les services doivent répondre aux désirs et aux besoins des femmes et des filles. Cela passe par des stratégies destinées aux adolescentes et des systèmes d’assistance intracommunautaires, ainsi que par l’intégration des questions de la non-violence, du genre et des droits dans une éducation sexuelle complète. Des données montrent qu’en 2019, les adolescent(e)s de moins de 18 ans avaient besoin de l’autorisation de leurs parents ou de leur tuteur dans 105 pays sur 142 afin de faire un test du VIH, et, dans 86 pays sur 138, ils avaient besoin de leur accord pour accéder au traitement et aux soins liés au VIH.
Des études menées de 2013 à 2018 révèlent également que le faible niveau de connaissances sur la prévention du VIH reste inquiétant, en particulier chez les femmes et les filles. En Afrique subsaharienne, la région la plus touchée par le VIH, 7 jeunes femmes sur 10 ne disposaient pas de connaissances complètes sur le VIH. À l’opposé, les pays faisant des efforts réels pour élargir les programmes de prévention du VIH affichent des résultats impressionnants. Par exemple, les nouvelles infections chez les femmes et les filles au Lesotho ont reculé de 41 % entre 2010 et 2018 après l’introduction d’une offre complète de programmes de prévention du VIH.
De manière générale, l’accès à l’éducation reste encore très inégal. Des études montrent qu’assurer la scolarisation des filles peut avoir un effet préventif contre le VIH. En étendant l’éducation secondaire obligatoire, le Botswana a remarqué que chaque année de scolarisation supplémentaire à partir de 9 ans baissait de 12 % le risque d’infection au VIH chez les filles. Toutefois, dans le monde, près d’une adolescente sur trois issue d’une famille parmi les plus pauvres n’a jamais été à l’école.
L’autonomie économique des femmes est essentielle en elle-même et représente un élément important de la riposte au sida. Les femmes continuent cependant d’avoir moins de chances de participer à l’économie que les hommes et d’endosser la grande partie du travail non payé que sont les tâches ménagères et les soins apportés à la famille. Seuls 88 pays sur 190 ont des lois exigeant un salaire égal pour un travail de valeur égale. Pour que la riposte au VIH progresse, il est indispensable de garantir une protection juridique pour mettre un terme à la discrimination liée au genre et que les femmes jouissent de l’égalité devant la loi.
« Les femmes et les adolescentes sont en train de revendiquer leurs droits », a déclaré Mme Byanyima. « Les gouvernements doivent utiliser ces revendications pour fournir des ressources et des services protégeant leurs droits, mais aussi pour apporter une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs attentes. »
Le rapport souligne plusieurs approches. Par exemple investir dans des programmes et des réglementations liés au VIH qui encouragent véritablement l’égalité des sexes ; investir dans l’éducation, y compris dans une éducation sexuelle complète, ainsi que dans l’autonomisation économique des femmes et des filles ; mettre en place une législation qui garantit l’égalité des droits de toutes les femmes et de toutes les filles, dont des mesures pour mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination, à la violence et à la criminalisation envers les femmes et les filles ; fournir des soins complets et des traitements dans la dignité ; encourager la participation des femmes dans toutes les décisions touchant aux programmes liés au VIH ; favoriser le leadership et l’implication des femmes et des jeunes dans la prise de décisions à tous les niveaux de la riposte au sida.
Contact
UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott
tel. +41 79 514 6896
bartonknotts@unaids.org
UNAIDS Media
tel. +41 22 791 4237
communications@unaids.org


Press Release
L’ONUSIDA appelle à mettre un terme à la discrimination envers les femmes et les filles
01 mars 2020 01 mars 2020GENÈVE, le 1er mars 2020—Chaque année, le 1er mars, nous célébrons la Journée zéro discrimination. En 2020, l’ONUSIDA appelle à mettre un terme à la discrimination envers les femmes et les filles, et à œuvrer pour l’égalité des droits, de traitement et des chances.
Malgré des progrès, en 2020, des pratiques coercitives, des législations discriminatoires, la violence basée sur le genre et les violations des droits humains continuent de peser lourdement sur la vie de femmes et de filles dans le monde entier. L’ONUSIDA attire l'attention sur sept domaines nécessitant des changements rapides. Il s’agit entre autres de fournir des soins sans stigmatisation ni barrière, de garantir la justice économique, d’assurer la gratuité de l’éducation primaire et secondaire, ainsi que de mettre un terme à la violence basée sur le genre.
« Le féminisme, les droits humains et l’absence de discriminations sont des valeurs profondément ancrées à travers le monde », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima. « Elles sont l’expression de notre humanité, de notre reconnaissance que je suis parce que tu es. Elles sont par ailleurs essentielles pour vaincre le sida. »
Dans le monde, un tiers au moins des femmes et des filles a été victime de violences dans leur vie. Au Kenya, 32 % des femmes âgées de 18 à 24 ans ont indiqué avoir subi des abus sexuels au cours de leur enfance. En outre, seuls 88 pays sur 190 disposent de lois sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Même si certains pays ont déjà réalisé des progrès en faveur de l’égalité des sexes, les discriminations envers les femmes et les filles restent d’actualité partout dans le monde. Près d’une adolescente sur trois âgée de 10 à 19 ans et issue d’une famille parmi les plus pauvres n’a jamais été à l’école.
De nombreux pays disposent encore de lois discriminant les femmes et les filles. Quant aux lois défendant les droits fondamentaux des femmes et les protégeant des préjudices et des inégalités de traitement, elles sont loin d’être la norme. Couplées à d’autres formes de discrimination liée aux revenus, à l’origine ethnique, au handicap, à l’orientation ou à l’identité sexuelle, ces violations touchent les femmes et les filles d’une manière disproportionnée.
« Nous devons transformer nos sociétés pour qu’il n’y ait pas de citoyennes et de citoyens de seconde classe, » a continué Mme Byanyima. « Nous devons éradiquer la violence, les inégalités et l’insécurité basées sur le genre et garantir que les femmes et les filles disposent du même accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi que les hommes et les garçons. »
Les inégalités entre les genres affectent également les communautés et l’économie. Les discriminations à l’égard des femmes et des filles dans le système éducatif et sur le marché du travail sont source d’insécurité économique et sociale. Leur sous-représentation en politique présente le risque de ne pas entendre leurs besoins. En 2019, les femmes occupaient moins d’un quart des sièges dans les parlements.
À ces inégalités viennent s’ajouter les soins aux proches et les tâches ménagères non rémunérées, les inégalités au niveau des droits à la propriété et à la succession, ainsi qu’une autonomie financière restreinte. On estime que les femmes effectuent les trois-quarts des tâches dans le foyer. Un travail qui n’est pas rémunéré.
Les gouvernements ont déjà pris de nombreux engagements par le passé pour mettre un terme à la violence et à la discrimination envers les femmes et les filles, mais des centaines de millions d’entre elles continuent d’être la cible de discrimination, d’abus et de violences. Les femmes et les filles le payent au prix fort, tout comme leur famille, les communautés, les sociétés et le développement économique.
Il est essentiel de garantir la protection des droits des femmes, de mettre un terme à la discrimination envers les femmes et les filles, ainsi que de supprimer les lois discriminatoires si nous voulons parvenir aux Objectifs de développement durable, et, ainsi, à l’égalité et à la justice pour toutes et pour tous.
Contact
UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott
tel. +41 22 791 1697
bartonknotts@unaids.org
UNAIDS Media
tel. +41 22 791 4237
communications@unaids.org

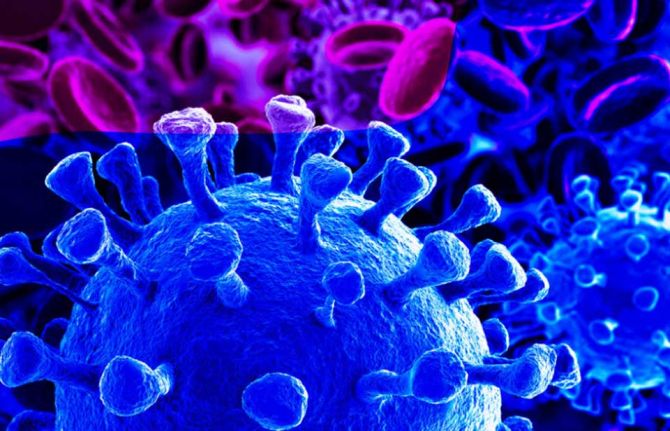
Press Release
Épidémie de COVID-19 : collaboration de l’ONUSIDA et de la Chine afin de garantir la continuité du traitement des personnes vivant avec le VIH
19 février 2020 19 février 2020GENÈVE, le 19 février 2020—Une enquête menée auprès de personnes vivant avec le VIH révèle que l’épidémie actuelle de coronavirus dit COVID-19 a un impact considérable sur la vie des personnes séropositives en Chine.
Cette enquête montre que près d’un tiers d'entre elles (32,6%) craint de ne plus avoir de médicaments d’ici quelques jours à cause de l’état d’urgence et des restrictions de déplacement dans certaines régions de Chine. La moitié d’entre elles (48,6%) indique ne pas savoir où obtenir le prochain renouvellement de leur thérapie antirétrovirale. Cependant, le gouvernement et des partenaires communautaires ont lancé un partenariat étroit afin de garantir la continuité de l’accès à ce traitement indispensable à l’heure où le pays lutte pour juguler le COVID-19.
Ainsi, le Chinese National Center for AIDS/STD Control and Prevention a chargé des administrations locales de permettre aux personnes vivant avec le VIH d'obtenir leurs médicaments même hors de leur lieu de résidence habituel. Le centre a également publié et diffusé une liste des cliniques fournissant une thérapie antirétrovirale. Le bureau pays de l’ONUSIDA en Chine, quant à lui, travaille avec BaiHuaLin, une alliance de personnes vivant avec le VIH, ainsi qu’avec d’autres partenaires communautaires afin d’établir de toute urgence un lien avec les personnes séropositives qui risquent de manquer de médicaments dans les 10 à 14 jours prochains et de leur apporter l’assistance nécessaire. L’ONUSIDA va également donner des équipements de protection individuelle à des organisations de la société civile apportant de l’aide aux personnes vivant avec le VIH, aux hôpitaux, etc. L’objectif consiste à améliorer la qualité des soins fournis aux personnes dans les établissements de santé et d’empêcher que les personnes vivant avec le VIH ne contractent le COVID-19.
« Les personnes vivant avec le VIH doivent continuer à obtenir les médicaments dont elles ont besoin pour rester en vie », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Je salue les efforts du Chinese National Center for AIDS/STD Control and Prevention pour aider les personnes vivant avec le VIH et touchées par l’état d’urgence à obtenir leurs médicaments. Nous devons garantir que quiconque ayant besoin d’un traitement au VIH y ait accès, peu importe où il ou elle se trouve. »
L’épidémie du COVID-19 en Chine a déclenché une riposte sans pareil, mais les hôpitaux et le personnel médical sont maintenant débordés par les soins à apporter aux victimes du coronavirus. L’état d’urgence a en outre été déclaré dans certaines villes. Cela signifie pour les personnes séropositives originaires d’une autre localité, qui se trouvent néanmoins dans ces zones qu’elles ne peuvent plus rentrer chez elles et accéder aux services liés au VIH, y compris leur traitement, fournis par leur prestataire de santé habituel.
Alors que la grande majorité des personnes interrogées (82 %) déclare avoir reçu les informations nécessaires pour évaluer leurs propres risques et prendre des mesures préventives contre le COVID-19, la plupart (près de 90 %) souhaitent davantage d’informations sur les mesures de protection spécifiques destinées aux personnes vivant avec le VIH. À l’image du reste de la population, 60 % d'entre elles indiquent avoir manqué d’équipement de protection individuel et domestique, comme des masques, du savon et du désinfectant, de l’alcool médical ou des gants. Près d’un tiers indique avoir peur et avoir besoin d’un soutien psychologique au cours de l’épidémie de COVID-19.
« Nous devons savoir combien de personnes vivant avec le VIH ont contracté le COVID-19, si elles sont davantage exposées à un risque de contamination et, en cas de contamination au coronavirus, si leur résistance est réduite. Au stade actuel de l’épidémie, il reste encore de nombreuses inconnues. Nous devons combler ces lacunes, et ce, sans perdre une seconde », a ajouté Mme Byanyima.
Cette enquête a été élaborée et menée conjointement par l’ONUSIDA et BaiHuaLin, une alliance de personnes vivant avec le VIH avec le soutien du Chinese National Center for AIDS/STD Control and Prevention. Pour cette étude, l’ONUSIDA a mobilisé l’aide des communautés et a attiré l'attention sur Internet afin d’obtenir autant de réponses que possible. Plus de 1 000 personnes vivant avec le VIH y ont participé. Les réponses ont été recueillies du 5 au 10 février 2020. Il est prévu qu’une étude complémentaire détaillée soit réalisée en partenariat avec la faculté de médecine de l’université de Zhongshan. Elle portera sur les besoins des communautés et se penchera sur les problèmes lié au système de santé avec un impact direct sur les services de lutte contre le VIH.
Region/country




Press Release
L'ONUSIDA et l'AIEA scellent une alliance solide pour lutter contre le cancer du col de l'utérus et le VIH, deux maladies étroitement liées
07 février 2020 07 février 2020GENÈVE, le 7 février 2020—L'ONUSIDA et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) joignent leurs forces pour renforcer l'action contre le cancer du col de l'utérus et le VIH. Les deux organisations ont signé au siège autrichien de l'AIEA à Vienne un mémorandum d'accord venant clôturer un évènement organisé au cours de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Dans ce document, elles promettent de renforcer et d'élargir les services destinés aux adolescentes et aux femmes touchées par ces deux maladies.
Le cancer du col de l'utérus et le VIH sont en effet étroitement liés. D'une part, cette forme de cancer est la plus répandue chez les femmes vivant avec le VIH, qui ont quasiment cinq fois plus de risques de le développer et, d'autre part, les femmes infectées avec certains types de papillomavirus humain sont deux fois plus exposées à un risque d’infection au VIH.
« Aujourd'hui, 90 % des filles vivant dans des pays à revenu élevé ont accès à un vaccin contre le papillomavirus humain alors qu'elles ne sont que 10 % dans les pays à revenu intermédiaire et faible. Pourquoi une telle injustice ? », s'indigne Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « À l'instar du VIH, le cancer du col de l'utérus se nourrit des inégalités de santé, entre les sexes et socioéconomiques touchant les femmes et les filles dans le monde entier. Il faut démocratiser et intégrer les services. Il s'agit d'investir dans les vies des femmes et des filles, et de respecter leur droit à la santé. »
En 2018, près de 311 000 femmes sont mortes du cancer du col de l'utérus, 85 % d'entre elles dans les pays à revenu intermédiaire et faible où les programmes de vaccination, de dépistage et de traitement sont limités. Renforcer les actions dans ces pays permettrait de réduire considérablement le taux de mortalité élevé du cancer du col de l'utérus dans le monde.
Près de 70 % des femmes développant un tel cancer ont besoin d'une radiothérapie pour le traiter efficacement. Cependant, l'AIEA estime qu'un tiers des pays à revenu intermédiaire et faible ne proposent pas de services de radiothérapie adaptés aux besoins des patientes. En Afrique, 28 pays ne disposent même pas d'unité de radiothérapie. Un aspect du travail de l'AIEA consiste à aider les pays à utiliser la médecine nucléaire et la radiothérapie pour traiter le cancer du col de l'utérus et d'autres formes de cancer.
« Le cancer du col de l'utérus fait partie des cancers les plus faciles à traiter et soigner lorsque l'on habite à Vienne, Buenos Aires, Rome ou Paris », a déclaré Rafael Mariano Grossi, Directeur général de l'AIEA. « Si vous avez la malchance de vivre dans un pays disposant d'un accès limité à la radiothérapie, il peut alors être fatal. » Et d'ajouter que le partenariat avec l'ONUSIDA est très important pour maximiser les efforts fondamentaux visant à aider les pays à lutter contre le cancer.
Ce nouvel accord entre l'ONUSIDA et l'AIEA consiste entre autres en un partenariat pour soutenir les stratégies et programmes nationaux de développement de plans de travail intégrés pour le VIH et le cancer du col de l'utérus. De plus, les deux organisations vont mobiliser des ressources pour élargir les services de prévention, de diagnostic et de traitement, former les professionnels de santé et faire prendre conscience du lien existant entre VIH et cancer du col de l'utérus.
