

Feature Story
Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis vraiment
31 mars 2021
31 mars 2021 31 mars 2021La nuit précédant le début du tournage, la productrice, Swati Bhattacharya, a discuté de longues heures avec l'une des actrices pour s’assurer que cette dernière comprenait bien l’esprit de son film.
« À cause de la COVID-19, je ne pouvais pas être présente, donc nous avons parlé au téléphone. Je lui ai expliqué que son personnage devait avoir peur face à la situation avant de l’accepter, et ce, sans prononcer un mot », explique Mme Bhattacharya.
Le film, « The Mirror », montre un jeune garçon qui fait la tête et ne veut pas jouer avec les autres enfants lors de la fête indienne des cerfs-volants. Sa mère l’y encourage, mais il s'échappe discrètement et descend. Il se drape dans un châle de femme et sourit en voyant son reflet dans le miroir.
Un peu plus tard, sa mère et sa grand-mère le surprennent en train de danser dans cette tenue. La musique s’arrête et les deux femmes dévisagent le garçon en silence. De longues secondes passent, puis les femmes se mettent à danser avec lui.
« Comme vous pouvez le voir, le scénario joue sur plusieurs tableaux », explique Mme Bhattacharya. « L’important est d’accepter les enfants tels qu’ils sont et, dans la situation du film, de les aider à avoir confiance en eux. » Elle indique ici que 98 % des personnes transgenres en Inde quittent leur famille ou sont chassés de chez elles. Beaucoup se retrouvent alors à vivre dans la rue, sans le sou ni éducation ou formation, et survivent du commerce du sexe.
« La visibilité est aussi un thème important », continue cette directrice publicitaire expérimentée. « Soit on déteste le corps dans lequel on vit, soit on hait la société dans laquelle on vit. » Son ambition était de saisir le moment crucial où l’on reconnaît qui l’on est vraiment. Souvent, poursuit-elle, nous considérons les enfants comme notre projet et nous voulons qu’ils soient extravertis, studieux et obéissants, mais on s’empêche ainsi de les voir tels qu’ils sont et de voir la manière dont ils veulent grandir.
« Je désirais montrer comment elles (les personnes transgenres) voient ce qu’elles souhaitent voir et non la manière dont les gens les voient », dit Mme Bhattacharya.
Et d’ajouter en citant une formule bien connue : « Il est plus facile d’accepter un enfant que de réparer un adulte brisé. »
Selon elle, la plupart des adultes ont été brutalisés et meurtris d’une manière ou d’une autre, mais les personnes transgenres dans son pays et dans le monde entier tout particulièrement sont exposées à de nombreux risques : elles vivent dans la rue, sont victimes de violences sexuelles ou souffrent de problèmes psychologiques.
Des statistiques révèlent que les jeunes transgenres ont beaucoup plus de risque de faire une tentative de suicide que les adolescents et adolescentes dont l’identité sexuée correspond à celle indiquée sur leur certificat de naissance. Par ailleurs, les personnes transgenres sont confrontées à la discrimination et, dans certains pays, aux arrestations. Et les femmes transgenres font partie des populations les plus touchées par le VIH avec un taux de contamination atteignant les 40 % dans certains cas.
Mme Bhattacharya est bien trop consciente de la réalité effroyable des chiffres. L'une de ses campagnes publicitaires précédentes visait à remettre en question l’exclusion enracinée dans la tradition. Son équipe a choisi une cérémonie réservée traditionnellement aux femmes mariées et l’a ouverte à toutes les femmes.
« En tant que publicitaire, je me suis rendu compte que nous avions une vision stéréotypée de la femme idéale alors qu’en fait les femmes sont très différentes », souligne-t-elle. Et de dire en riant s’être rendu compte que, pendant des années, elle n’avait jamais pensé à des consommatrices comme elle. Ce constat l’a motivée à en savoir plus sur les femmes et à entendre leurs histoires.
La campagne Sindoor Khela a non seulement remporté un écho favorable et des récompenses, mais elle lui a ouvert les yeux sur la diversité et sur les nombreuses polarités. « Femmes mariées ou non mariées, avec ou sans enfants, divorcées ou veuves, etc., » explique Mme Bhattacharya.
Elle souhaitait rassembler ces groupes et montrer que la communauté des femmes est une ressource non exploitée. Son film, The Mirror, y fait allusion.
« D’une certaine manière, la mère veut faire changer les choses, elle prend la décision d’accepter son fils et de marquer le moment en dansant avec lui », indique Mme Bhattacharya. « Le film a une forte connotation féministe, car les deux femmes peuvent protéger comme un manteau ou mettre en lumière comme deux projecteurs si vous préférez. »
Pour Jas Pham, une femme transgenre de Bangkok en Thaïlande, cette vidéo a touché une corde sensible. « J’ai littéralement fondu en larmes devant la vidéo qui m’a rappelé mon enfance », raconte-t-elle.
Elle explique s’être concentrée sur l’enfant avant de réfléchir au rôle du miroir. « Sa fonction consiste à renvoyer une image. On se voit comme on est et sans jugement », indique-t-elle avant d’ajouter que c’est un message fort à destination des familles d’enfants transgenres et de genre fluide du monde entier en faveur de la reconnaissance et de l’acceptation.
Cole Young, un homme transgenre américain, déclare que les parents n’acceptent pas toujours leurs enfants en faisant preuve d’autant d’ouverture d’esprit et d’acceptation, mais il aime l’ambiance positive et joyeuse du film. « Nous connaissons les mauvaises réactions pour les avoir vécues nous-mêmes, donc nous n’avons pas besoin de rouvrir des blessures chez les personnes trans. »
Jas et M. Young travaillent pour l’Asia Pacific Transgender Network, une organisation non gouvernementale militant pour les droits des personnes transgenres et de genre fluide. Tous deux sont d’avis que même si le film a été tourné en Inde, son message est universel.
Keem Love Black, une femme transgenre ougandaise, déclare que le film l’a beaucoup touchée, car elle a vécu des moments similaires au même âge que le garçon et continue d’en vivre aujourd’hui. « J’ai tout le temps des expériences de « miroir », surtout quand je sors », explique-t-elle.
Mme Black dirige Trans Positives Uganda, une organisation communautaire qui s’occupe des travailleuses du sexe et des réfugiées transgenres qui vivent avec le VIH. Elle utilise les médias sociaux pour sensibiliser sur des questions concernant la population LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée), car rares sont les personnes à oser les aborder ouvertement. L’homosexualité étant criminalisée en Ouganda, Mme Black est constamment confrontée à l’homophobie et à la transphobie dont sont victimes ses pairs et la communauté, y compris dans les établissements de santé. À propos du film, elle dit que « nous devrions saisir toutes les opportunités qui s’offrent à nous pour être visibles. »
L’ONUSIDA a choisi la Journée internationale de la visibilité transgenre pour lancer le film The Mirror. La diversité des genres n’est pas un choix de style de vie, mais un droit inhérent à toutes les personnes. Les stéréotypes de genre, en particulier concernant la population LGBTI, s’accompagnent de stigmatisation et de discrimination. Cela est d’autant plus marqué chez les enfants, les adolescentes et les adolescents que la diversité n’est pas une notion bien comprise. En outre, la société exerce une pression énorme pour que les enfants respectent les normes attribuées à leur genre.
Kanykei (qui préfère ne pas donner son nom de famille) est l'une des rares personnes ouvertement transgenres à Bishkek, la capitale du Kirghizstan. Elle se souvient avoir porté des écharpes quand elle était petite, un peu comme le garçon dans le film. Mais sa famille n’a pas pris ça au sérieux. Aussi loin qu’elle puisse se souvenir, avant même de comprendre la différence entre les garçons et les filles, elle s’est sentie être une fille. « Les gens rigolent quand un jeune enfant joue, mais le regard de la famille et de la société change au fur et à mesure des années », explique-t-elle.
Elle a ainsi dû changer son comportement et se comporter comme un homme. Avant le décès de sa grand-mère, il y a cinq ans, elle a commencé à réfléchir à une transition, mais elle n’a pas réussi à lui dire la vérité. « Je portais à chaque instant ce conflit sur mon identité de genre jusqu’au jour où j'ai décidé de faire ma transition et de vivre comme je me sens », finit-elle.
Pour Ariadne Ribeiro, une Brésilienne transgenre, ses moments de « miroir » se produisaient quand elle cherchait qui elle était vraiment. Mais cela lui faisait aussi peur. « J’avais toujours très peur que les gens me voient dans le miroir comme je me voyais moi-même et que l’on découvre mon secret. Je n’étais pas prête », explique-t-elle. « J’ai l’impression que la vidéo montre une réalité plus proche de l’idéal de l’acceptation, une chose que je n’ai jamais vécue en 40 ans. »
Militante de longue date de la cause transgenre et aujourd’hui conseillère de soutien aux communautés pour l’ONUSIDA, Mme Ribeiro déclare que les choses changent, mais que cela nécessite un engagement plus profond.
C’est exactement l’objectif que souhaite atteindre Mme Bhattacharya avec son film. Elle est convaincue que le travail crée une dynamique et que les efforts sont récompensés. Elle souligne aussi le fait que les « souffrances qui s’intensifient » au cours des années et qu’ont vécues beaucoup de ses proches de genre fluide sont bien réelles. « Mon objectif consiste à ouvrir les portes et à inviter les gens à poursuivre la discussion. »
Cliquez ici pour voir le film. Pour joindre la campagne #Seemeasiam à ce sujet #TransDayOfVisibility #TDOV2021.
Related




Feature Story
« Quelqu’un doit faire le premier pas » : une militante transgenre haïtienne donne espoir et un visage à sa communauté
09 novembre 2020
09 novembre 2020 09 novembre 2020Le premier refuge pour personnes transgenres a ouvert ses portes la semaine dernière en Haïti. Le ruban rouge marquant l’inauguration de Kay Trans Ayiti a été coupé sous les vivats d’un groupe de militant-es et d’habitant-es. Le groupe s’est ensuite relayé pour prendre des photos entre les ballons rose et bleu accrochés à la véranda et flottant au vent.
Ce moment de triomphe a une période difficile en toile de fond. La fondatrice du refuge, Yaisah Val, est intarissable lorsqu’on lui demande comment les personnes transgenres en Haïti traversent la pandémie de COVID-19. « Lorsque le reste de la population s’enrhume, la communauté trans attrape une pneumonie. Ajoutez-y maintenant la faim, la pauvreté et les faibles ressources en Haïti, nous sommes toujours en marge de la société », explique-t-elle.
À plusieurs niveaux, Mme Val n’est pas aussi ostracisée que les personnes qu’elle aide. La première femme publiquement transgenre en Haïti se définit comme mère de deux enfants et épouse. Cette diplômée d’éducation et de psychologie clinique a travaillé en tant qu’enseignante et conseillère d’éducation avant de se consacrer à plein-temps à la mobilisation et à la lutte pour sa communauté et de devenir une porte-parole de l’identité de genre. Elle a été facilement acceptée en tant que femme au cours de ses années « de clandestinité ».
Née aux États-Unis d’Amérique de parents haïtiens, elle a grandi dans un environnement familial stable, a eu des enseignant-es qui l’ont soutenue, ainsi qu’une grand-mère qui l’aimait follement.
« Si tu deviens une fillette, tu seras la meilleure fillette, car tu seras la mienne », lui a déclaré un jour sa grand-mère alors qu’elle était encore un garçon prénommé Junior.
Mais elle demeure une exception. Selon le United Caribbean Trans Network, dans la région, les personnes transgenres sont beaucoup moins susceptibles de jouir du soutien de leur famille, de terminer leur éducation secondaire et de trouver un emploi. Elles ont plus de chance d’être sans abri, de vendre des prestations sexuelles pour survivre et d’être confrontées à des situations de violence extrême. Tous ces facteurs augmentent le risque d’infection au VIH au sein de la communauté. Une étude récente révèle que la prévalence du VIH parmi les femmes transgenres en Haïti est de 27,6 %, soit 14 fois plus que pour l’ensemble de la population.
Même si Mme Val a eu une vie « privilégiée » pendant 47 ans, cela n’a pas été un long fleuve tranquille.
Elle a su vers deux ou trois ans qu’elle était une fille. Ses proches n’arrêtaient pas de la corriger pour qu’elle se comporte comme un garçon : « Il faut endurcir ce gamin. On ne peut pas le laisser continuer comme ça. » À sept ans, elle est admise au Washington Children’s Hospital après s’être mutilé les organes génitaux. La puberté a « été l’horreur,... une période pleine de confusion et de haine tournée vers moi-même. »
Il y a 20 ans environ, elle s'autorise à devenir elle-même pendant le Carnaval haïtien. Elle tresse ses cheveux, enfile une robe et monte avec ses amis dans un tap-tap, un taxi collectif, bruyant et bigarré. Un homme flirte avec elle. Il lui dit qu’elle est jolie et lui tient la porte. Elle a l’impression d’être Cendrillon.
« Ce garçon a fini par découvrir qui j’étais et a été à deux doigts de me tabasser à mort », se souvient Mme Val. « Que tu viennes des classes aisées, moyennes ou de la rue, tant que tu es trans, cela ne fait aucune différence. Une fois que cela se sait, tout respect disparaît... tu n’es plus que ce truc. Ce simple mot te prive de toute humanité dans le regard des autres. »
Sa transition a été une libération. « Je vivais et j’étais vue comme la personne que j’étais et que j’ai toujours été. » Mais son identité était un secret difficile à porter par peur des violences ou de l’exclusion. Ses anciens partenaires n’ont su qu’elle était transgenre que des années plus tard lorsqu’elle l’a rendu public. Elle n’a révélé son secret qu’à l’homme qui allait devenir son mari au bout d’un an de vie commune et à quelques jours de leur mariage.
« Je ne conseille à personne de faire comme moi », souligne inlassablement Mme Val à l’attention des personnes transgenres cachant leur identité sexuelle à leur partenaire intime. « Cela peut être violent. Cela peut être dangereux. »
Dans son cas, cela a fonctionné. Son partenaire a décidé qu’elle était la même personne qu’il connaissait et qu’il aimait. Il y a trois ans, l’histoire s’est répétée lorsqu’elle a avoué la vérité à ses enfants.
« Cela m’a juste surpris », raconte son fils, Cedrick. « Cela a été un choc, mais positif. Mes parents avaient commencé doucement à préparer le terrain pendant quelques années, donc j’ai compris la situation. Et depuis, notre relation mère-fils dans son ensemble est passée à l’étape supérieure pour nous deux. Toutes les pièces du puzzle ont trouvé leur place. Maintenant, tout est logique, comme ses souvenirs d’enfance. »
Son coming-out auprès des êtres qui lui étaient les plus chers a ouvert grand la voie au militantisme. En 2016, Mme Val est devenue la première personne dans l’histoire d’Haïti à s’identifier publiquement en tant que personne transgenre. Elle est une partenaire essentielle de l’ONUSIDA en Haïti et des organisations lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) de l’île. L’année dernière, elle a participé à des discussions au niveau national sur les droits de la communauté LGBTI. Avec son mari, elle a commencé à accueillir des sans-abris transgenres. Cela a marqué le début du processus qui a débouché sur l’ouverture de Kay Trans Ayiti, ce refuge qui accueille aujourd’hui 10 personnes transgenres. Une campagne de financement participatif est en cours pour lancer un programme de soutien psychosocial, de conseil juridique pour le traitement hormonal substitutif et de formation professionnelle. L'une de leurs initiatives pour l’emploi concerne un stand de nourriture. Certain-es des résident-es vivent avec le VIH. Tous-tes reçoivent de l’aide pour respecter leur traitement antirétroviral.
Mme Val sait pour l’avoir vécu qu’accéder en tant que femme transgenre à des soins de santé sexuelle et reproductive peut être une expérience traumatisante. Elle se souvient de sa visite de contrôle chez un gynécologue en Haïti pour sa vaginoplastie. Le docteur n’a pas compris ce que signifiait « transgenre ». À la fin de la visite, le gynécologue a appelé des collègues pour venir voir.
« J’étais une chaîne YouTube, une page Google,... mais pas du tout un être humain. J’étais bouleversée. Je pleurais. C’est bien pour cela que les personnes transgenres n’accèdent pas aux soins de santé ! Nous avons beaucoup d’hommes trans qui ont des problèmes gynécologiques et qui préfèrent préparer des traitements à base d’herbes plutôt que d’aller chez le médecin », raconte Mme Val.
Son groupe, Action Communautaire pour l’intégration des Femmes Vulnérables en Haïti ou ACIFVH, travaille avec deux établissements spécialisés dans le VIH afin de sensibiliser le personnel dispensant des soins. Combattre l’ignorance et le conservatisme n’est pas chose aisée. Même à l’issue de formations, des médecins et des infirmières des deux sexes ont essayé d’imposer leurs opinions religieuses aux intervenant-es.
« J’ai eu de la chance de ne pas avoir été écrasée par la transphobie et la discrimination », se rend compte Mme Val. « Imaginez si je n’avais pas eu une grand-mère qui m’a soutenue, une éducation et des portes qui se sont ouvertes. Je n’aurais jamais pu être la personne que vous avez devant vous aujourd’hui. »
« Si vous jetez une graine sur du béton, elle ne va pas pousser. Être trans n’est pas le problème. Le problème, c'est la réaction des gens : jeter à la rue les personnes trans, ne pas leur offrir de travail, ne pas les accueillir dans les écoles. Nous avons besoin d’une place dans la société. C’est dur. Cela va prendre du temps. Mais quelqu’un doit faire le premier pas. »
Notre action
Region/country
Related


Feature Story
Venir en aide aux professionnel-les du sexe transgenres au Guyana et au Suriname à l’heure de la COVID-19
02 juin 2020
02 juin 2020 02 juin 2020Twinkle Paule, militante transgenre du Guyana, a émigré aux États-Unis d’Amérique il y a deux ans. Alors que la crise de la COVID-19 s’aggravait, elle a pensé à ses « sœurs » restées au pays ainsi qu’au Suriname voisin. Pour beaucoup d’entre elles, le seul moyen de subsistance est le commerce du sexe, mais Twinkle Paule savait que le couvre-feu allait leur couper les vivres. Elle craignait également que certaines aient des problèmes avec la loi si elles se sentaient contraintes à travailler la nuit.
Ses peurs ont été confirmées après avoir pris contact avec des personnes sur place. Elle a fait personnellement un don, mais elle était consciente que c’était loin de suffire.
« Ayant arpenté les mêmes rues, je savais que nous devions créer une mobilisation pour venir en aide à notre communauté. Je sais ce que c’est que d’être enfermée chez soi et de devoir de l’argent à un propriétaire... que d’être mise à la rue parce que l’on ne peut pas payer son loyer », déclare Mme Paule.
Elle a collaboré alors avec deux militantes new-yorkaises, Cora Colt et Ceyenne Doroshow, les fondatrices de la Gays and Lesbians in a Transgender Society (GLITS Inc), afin de lancer une campagne d’appel aux dons sur GoFundMe. Depuis son lancement le 12 mai, elles ont déjà reçu suffisamment de dons pour payer un mois de loyer à six professionnelles du sexe transgenres. L’argent a été envoyé à Guyana Trans United (GTU), l’organisation pour laquelle Mme Paule a travaillé en tant qu’éducatrice lorsqu’elle a arrêté le commerce du sexe en 2015.
Le fait que Mme Paule puisse aujourd’hui s'appuyer sur sa notoriété pour mobiliser une aide d’urgence constitue en soi une réussite phénoménale. Au moment où elle a émigré, elle pensait sérieusement au suicide. La charge émotionnelle liée à l’exclusion et à l’injustice pesait lourdement sur ses épaules.
Depuis que sa demande d’asile a été acceptée, elle étudie à plein temps la communication au Borough of Manhattan Community College. Elle a terminé ses études secondaires l’année dernière, ce qu’elle n’avait pas pu faire au Guyana. En parallèle de ses études, elle a travaillé sur le terrain pour le GMHC (Gay Men’s Health Crisis).
Et c’est tout naturellement qu’elle s’est glissée dans la peau d’une militante pour demander l’année dernière à la mairie de supprimer la loi § 240.37 du Code pénal de l’État de New York relative au racolage qui est utilisée pour cibler les femmes transgenres. Elle a immédiatement reconnu que ce paragraphe est issu de la même tradition que les lois sur le vagabondage dont elle a souffert au début au Guyana avant de lutter contre elles.
Mme Paule est tout à fait consciente que son émigration a changé ses perspectives du tout au tout.
« Mon expérience illustre combien le fait de donner à quelqu’un les possibilités et les bons outils fait la différence pour prendre d’autres décisions dans sa vie. J’ai pris conscience que ce qui me manquait, c’était des ressources adaptées et l'accès à un environnement sans craindre la discrimination et la violence. Je ne dis pas que tout est parfait ici, mais mon quotidien n’est plus marqué par le même niveau d’injustice. J’ai pu accéder à un traitement hormonal. Et pour moi, le plus important est d’avoir pu retourner à l’école », raconte-t-elle.
Sa mère est morte lorsqu’elle était encore enfant, puis son père a fondé une nouvelle famille. Des proches se sont alors occupés de l’élever. L’argent manquait parfois pour assurer son éducation. Certains week-ends, elle nettoyait une église pour gagner un peu d’argent.
Mais la pauvreté n’était pas le seul problème. Elle se souvient s’être sentie très tôt différente. Elle n’avait pas de mot pour qualifier ce qu’elle ressentait, mais elle a su d’instinct que ce ne serait pas accepté. À l’école, elle a tout fait pour ne pas se faire remarquer. Un jour, son cœur s’est arrêté lorsqu’un camarade de classe lui a dit qu’elle s’exprimait comme un « antiman », un terme péjoratif utilisé au Guyana pour les personnes gays.
Pendant des années, elle a entendu à plusieurs reprises des adultes de son entourage être d’accord pour dire qu’il faudrait la mettre à la porte si jamais elle était gay. C’est ce qui arrive alors qu’elle a 16 ans, lorsqu’un membre de sa famille la voit « danser comme une fille » à une fête. La voilà sans domicile.
Mme Paule se réfugie auprès d’autres femmes transgenres et, comme elles, a recours au commerce du sexe pour survivre. L’émergence d’un mouvement régional s’intéressant aux besoins des communautés vulnérables et marginalisées change alors sa vie. La nouvelle association Guyana Sex Work Coalition lui apporte des informations sur les rapports sexuels à moindre risque et lui permet d’accéder à des solutions en ce sens. Lorsque certaines femmes dans sa situation commencent à se rendre à des conférences, elles découvrent qu’il existe un mot pour décrire leur expérience. Elles n’étaient pas « antimen ». Elles étaient transgenres.
Mais la vie sur le trottoir était brutale. Si l’une d’entre elles se faisait dévaliser ou violer, elle n’avait pas la possibilité de le signaler à la police.
« La police vous dit en face : « Qu’est-ce que tu fais ici alors que tu sais que la prostitution et la sodomie vont à l’encontre de la loi » », se souvient-elle.
Elle explique que, parfois, des officiers de police véreux les menaçaient de poursuites pour pouvoir leur extorquer de l’argent.
Une fois, dans un commissariat, la police l’a incarcérée avec d’autres femmes transgenres au milieu d'hommes et a lancé des préservatifs dans la cellule, donnant ainsi le feu vert aux autres détenus. Elle était adolescente à cette époque.
Un autre jour, elle a accompagné une amie au commissariat pour déposer plainte pour violence intrafamiliale. Un policier a renversé la situation en lui déclarant : « Vous pratiquez la sodomie. Je vous boucle. »
En 2014, un groupe d’entre elles a été arrêté pour commerce du sexe au Suriname. Parmi les exactions subies, un gardien de prison les a forcées à se déshabiller et à s’accroupir devant leur cellule en présence d’autres détenus.
Il y a sept ans, une de ses amies a été assassinée, et son corps jeté derrière une église. Le crime n’a donné lieu à aucune enquête.
Un enchaînement de traumatismes qui laisse des cicatrices.
La peur est toujours présente, même lorsque tout est calme. Est-ce que je vais me faire jeter du taxi ? Des gens vont-ils m’insulter dans la rue ? Vais-je avoir des problèmes à cause de ce que je porte ?
« Les filles ont l’impression que c’est leur faute », explique Mme Paule. « Même en ce qui me concerne, j’avais l’impression que les gens avaient le droit de me maltraiter, car mon comportement ne respectait pas les conventions sociales. »
Lorsqu’elle a commencé à militer, elle ne sentait toujours pas complètement elle-même. Elle tente de se suicider et commence à boire ou à fumer un joint avant d’aller travailler. Il y a deux ans, elle était à la dérive. Aujourd’hui, elle est une force vive au service de sa communauté.
Mme Paule attribue au travail d’organisations comme la Society against Sexual Orientation Discrimination et GTU le mérite de faire avancer le débat concernant l’inclusion au Guyana.
« La sécurité et l’égalité sont deux choses qui manquent encore à ma communauté », insiste-t-elle. « Nous avons besoin que le gouvernement affirme : « Nous devons protéger ces personnes ». La communauté transgenre n’a pas de travail, nous arrêtons notre scolarité à cause du harcèlement et nous sommes victimes de brutalités policières. Tout cela ne va pas. Nous avons besoin que nos élu-es s’engagent vraiment. »
Notre action
Related



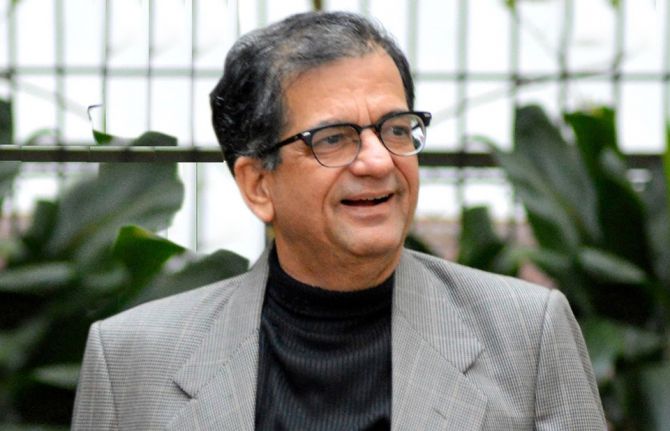
Feature Story
Reconnaître l’action des personnes transgenres
14 mai 2020
14 mai 2020 14 mai 2020En temps normal, l’Humsafar Trust n’apporte pas d’aide humanitaire, mais la COVID-19 a changé la donne.
Quelques jours après l’entrée en vigueur des mesures de confinement en Inde, les équipes de l’Humsafar Trust ont commencé à recevoir des appels désespérés de personnes qui n’avaient nulle part où aller et aucun revenu, explique Vivek Anand, le directeur exécutif de cette organisation non gouvernementale indienne de Mumbai qui soutient la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée (LGBTI). L’équipe s’est alors réunie de toute urgence pour décider de la marche à suivre. « Après avoir cherché pendant longtemps à évaluer les besoins d’une manière ou d’une autre, nous sommes tombés d’accord sur une chose : commencer par fournir une aide alimentaire », continue-t-il.
Les membres de l’ONG ont mis de l’argent en commun pour acheter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité.
Ils se sont ensuite rendus au sein de leurs communautés et ont annoncé que l’Humsafar Trust avait lancé un fonds d’urgence pour la COVID-19. En trois jours, plus de 700 personnes ont demandé de l’aide. « Grâce aux dons venant de communautés, d’alliés, d’entreprises et de certains organismes donateurs, nous avons aidé plus de 2 000 personnes en leur fournissant de la nourriture, un accès à des soins médicaux, comme des antirétroviraux, une aide financière et en leur permettant de faire une demande d’aide au gouvernement », indique fièrement M. Anand alors que son climatiseur souffle des vagues d’air frais à travers le petit bureau à son domicile.
Il a l’impression que la riposte à la pandémie oublie la communauté LGBTI. « La situation socioéconomique de 70 % des membres de notre communauté est précaire sans aucune épargne », poursuit-il.
L’Humsafar Trust dédie son action en particulier aux personnes transgenres, qui, selon M. Anand, sont les plus touchées. « Non seulement elles disposent en temps normal de faibles revenus pour assurer leur subsistance, mais beaucoup d’entre elles n’ont pas de papiers d’identité, si bien qu’elles n’existent pas aux yeux des autorités qui distribuent des aides », continue M. Anand.
Le confinement est source de difficultés financières et se traduit également par du stress psychologique. M. Anand raconte qu’un des membres de son équipe transgenre au sein de l’Humsafar Trust ne peut pas dire son nom lors des actions sur le terrain, car elle vit avec ses parents qui considèrent qu’elle est un garçon. D’autres sont soumis à des pressions pour se marier, ou encore sont victimes de mauvais traitements et de violences.
Debout devant un magasin de légumes afin que son téléphone capte mieux, Shreya Reddy déclare avoir toujours voulu être femme. Elle n’a jamais renoncé malgré le fait d’être née garçon et d’être la cible constante de brimades et de moqueries. À 13 ans, elle fugue pour rejoindre une communauté hijra composée en majorité de personnes transgenres. Quatre ans plus tard, elle commence sa transition sexuelle grâce à l’argent qu’elle gagne en tant que professionnelle du sexe. Plus tard, continue Mme Reddy, elle se rend compte qu’elle doit étudier si elle veut s’en sortir. Son diplôme de travailleuse sociale et son expérience la mènent à l’Humsafar Trust où elle devient éducatrice et travailleuse de proximité auprès des personnes dans sa situation. La COVID-19 a eu un impact sur sa vie à plusieurs titres.
« C’était horrible, je ne pouvais plus obtenir mes hormones, j’ai perdu du poids et je saignais », explique-t-elle avant d’ajouter que le confinement empêche de faire les visites de contrôle régulières chez les gynécologues. « Et ma communauté n’arrive pas à comprendre toutes les règles et le jargon scientifique. Pour faire simple, beaucoup de personnes comme moi rencontrent d’énormes difficultés que ce soit pour payer leur loyer ou acheter le strict minimum », dit Mme Reddy.
Et d’ajouter en parlant de plus en plus vite : « ces personnes n’ont pas reçu une grande éducation, elles ont peur et la méfiance règne. »
L’état de santé de Mme Reddy s’est amélioré depuis et elle indique s’impliquer totalement dans son action sur le terrain. Une femme transgenre de sa communauté lui a dit après avoir perdu tous ses revenus : « mieux vaut mourir. » « Je m’émancipe en parlant aux gens », déclare-t-elle. « Nous sommes toutes et tous si vulnérables et, comme nous sommes une population à faible revenu, nous avons besoin d’aide. »
Le rapport Vulnerability amplified: the impact of the COVID-19 pandemic on LGBTIQ people publié récemment par OutRight Action International révèle que les répercussions du virus et des mesures de confinement sont amplifiées chez les personnes LGBTI dans le monde par rapport au reste de la population. Jessica Stern, la directrice exécutive d’OutRight, a déclaré : « Pour nous, la situation est grave. Je crains la mort de nombreux membres de la communauté LGBTI parce que nous affrontons davantage de vulnérabilité. »
Montrant derrière elle les vendeuses et vendeurs sur le marché, Mme Reddy raconte : « Je les aide aussi à comprendre comment utiliser les masques et les désinfectants. J’aide tout le monde, mais j’ai peur de l’avenir. »
M. Anand abonde en son sens. Il doit prolonger le fonds d’urgence jusqu’au mois d'août.
« Chaque jour apporte un nouveau défi », soupire-t-il. Toutes ses équipes qui sillonnent habituellement les rues ne peuvent pas travailler en ligne. En plus, il souligne qu’un nombre croissant de personnes choisit la clandestinité, ce qui ne facilite pas la prise de contact.
Se souvenant de sa jeunesse, il explique qu’il s’est assumé sur le tard. « Je ne connaissais personne qui était gay », se rappelle-t-il. Lorsque sa relation secrète a pris fin au bout de neuf ans, il n’avait personne à qui parler. Il s’est alors senti seul et abandonné. « À partir de cet instant, l’Humsafar Trust est devenu ma maison et ma famille. » Il ajoute qu’il ne souhaite juger personne au cours de cette période difficile et il répète que son devoir consiste en priorité à aider les autres.
Mais ce qu’il veut vraiment, c’est que l’action de la communauté transgenre dans la riposte à la COVID-19 ne reste pas dans l’ombre. « Il faut lui donner une voix, la rendre visible et lui accorder la place qui lui revient », conclut-il.



