
Feature Story
Un forum tente d'impliquer les hommes et les garçons dans la réalisation de l'objectif de l'égalité entre les sexes
31 mars 2009
31 mars 2009 31 mars 2009
(de gauche) M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA et la Ministre des Politiques de la Femme du Brésil, Mme Nilcéa Freire a la cérémonie d'ouverture du symposium mondial sur l'implication des hommes, 30 mars 2009.
Credit: UNAIDS/D.Ramalho
Un symposium mondial sur l'implication des hommes et des garçons dans la réalisation de l'objectif de l'égalité entre les sexes se déroule cette semaine à Rio de Janeiro (Brésil).
Dans un discours prononcé hier soir lors de la cérémonie d'ouverture, M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA, a parlé de la nécessité de « travailler ensemble sur le long terme pour mettre fin à l'acceptation sociale de la violence à l'encontre des femmes et à l'inégalité entre les sexes qui sous-tend une telle violence ».
« Nous devons engager le débat avec les hommes et les garçons afin de sensibiliser ceux-ci à l'idée d'une “nouvelle masculinité” », a poursuivi M. Sidibé.
Le discours d'ouverture a été prononcé par la Ministre des Politiques de la Femme du Brésil, Mme Nilcéa Freire. D'autres intervenants se sont succédés lors de la cérémonie d'ouverture, à savoir : Mme Inés Alberdi, Directrice exécutive de l'UNIFEM, Mme Purnima Mane, Directrice exécutive de l'UNFPA, M. Paul Hunt, Ambassadeur du Canada au Brésil, Mme Peju Olukoya, Coordonnatrice du Département Genre et santé de la femme de l'Organisation mondiale de la Santé, et Mme Kim Bolduc, Représentante résidente du PNUD et Coordonnatrice résidente des Nations Unies.
La conférence abordera trois thèmes majeurs : « Les hommes et la violence », « Les hommes et la santé » et « Les hommes et la dispensation de soins ».
Hier, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA, s'est joint à Mme Nilcéa Freire, Ministre des Politiques de la Femme, pour l'inauguration du premier centre axé sur la réhabilitation des hommes violents à l'égard des femmes au Brésil. Situé à Nova Iguaçu, une commune de l'agglomération de Rio de Janeiro, le centre mettra l'accent sur des programmes d'éducation visant à mettre un terme à la violence domestique. Dix autres centres de ce type sont prévus dans le pays.
Sexospécificité et VIH
Nous devons travailler ensemble sur le long terme pour mettre fin à l'acceptation sociale de la violence à l'encontre des femmes et à l'inégalité entre les sexes qui sous-tend une telle violence.
M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA
La sexospécificité comprend les croyances, les attentes, les coutumes et les pratiques largement répandues dans une société et qui définissent les attributs « masculins » et « féminins » ainsi que les comportements, les rôles et les responsabilités propres aux hommes et aux femmes. Vu que la sexospécificité se construit de manière relationnelle, un sexe étant défini par rapport à l'autre, les organisateurs du symposium de Rio pensent que la réalisation de l'objectif de l'égalité entre les sexes doit impliquer à la fois les hommes et les femmes. Le travail avec les hommes, considéré comme un élément fondamental, doit être effectué conjointement avec le travail d'émancipation des femmes et des filles, et non pas à part.
Dans de nombreuses sociétés, les normes sexospécifiques imposent une infériorité de la femme dans son foyer, sur son lieu de travail et dans la négociation des rapports sexuels. Dans certaines sociétés, le concept de masculinité peut renforcer l'idée selon laquelle un homme doit rechercher des partenaires sexuels multiples ou prendre des risques. Ces normes vont à l'encontre des messages de prévention du VIH qui encouragent les mesures de protection et la fidélité. Certaines notions liées à la masculinité conduisent également à une certaine tolérance de la violence à l'égard des femmes ou à l'homophobie. Le rejet des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes causé par l'homophobie peut à son tour inciter ceux-ci à dissimuler leur comportement sexuel et les dissuader de bénéficier de services liés au VIH.
Violence et VIH
Selon un rapport établi en 2006 par le Secrétaire général des Nations Unies, une femme sur trois au moins dans le monde a été battue, contrainte d'avoir des rapports sexuels ou maltraitée dans sa vie, l'auteur des sévices étant généralement un proche.
Dans le contexte du VIH, la violence physique ou sexuelle exercée par les hommes sur les femmes, qu'elle soit réelle ou qu'elle reste à l'état de menaces, accroît la vulnérabilité des femmes au VIH, en rendant difficile, voire impossible, toute négociation de rapports sexuels protégés ou de l'usage du préservatif. Elle peut également empêcher celles-ci d'accéder à des services de prévention, de prise en charge et de traitement du VIH. La crainte d'être battues ou abandonnées suite à la découverte d'une séropositivité peut en outre dissuader les femmes de pratiquer un dépistage du VIH.
Aller de l'avant
Le symposium organisé cette semaine comprend des sessions de débats avec des personnes représentant des mouvements des droits des femmes et d'autres mouvements pour la justice sociale. Il comprend également des ateliers de développement des compétences, visant d'une part à renforcer les capacités des participants à concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un plaidoyer pour un changement dans les comportements et des stratégies de mobilisation des communautés, et d'autre part, à travailler avec des jeunes enfants et des adolescents pour atteindre l'objectif de l'égalité entre les sexes.
Les participants espèrent lancer un « appel à l'action » afin que les gouvernements mettent en oeuvre des politiques impliquant les hommes et les garçons dans la réalisation de l'objectif de l'égalité entre les sexes.
Le symposium sur L'implication des hommes et des garçons dans la réalisation de l'objectif de l'égalité entre les sexes associera des présentations des meilleures pratiques, des ateliers de développement des compétences et des débats entre des représentants d'organisations non gouvernementales, des décideurs politiques et des chercheurs. Il durera jusqu'au 3 avril.
Right Hand Content
Coparrainants:
Partenaires:
Coalition mondiale sur les femmes et le sida (en anglais)
UNIFEM Sexospécificité et sida
Discours:
Lire le discours du Michel Sidibé lors de la cérémonie d’ouverture du symposium mondial sur l'implication des hommes et des garçons dans la réalisation de l'objectif de l'égalité entre les sexes (30 mars 2009) (en anglais)
Reportages:
Liens externes:
Impliquer les hommes et les garçons dans l'objectif de l'égalité entre les sexes (en anglais)
MenEngage (en anglais)

Feature Story
Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA rencontre des membres du Gouvernement et de la société civile au Brésil
30 mars 2009
30 mars 2009 30 mars 2009
UNAIDS Executive Director Michel Sidibé greets Minister of Health of Brazil, Mr José Gomes Temporão.
Credit: UNAIDS/M. Silva
La réunion prochaine du G20 à Londres, la crise financière mondiale et l'accès universel font partie des principaux sujets abordés par M. Michel Sidibé et ses interlocuteurs du Gouvernement brésilien, à l'occasion de la première visite de M. Sidibé au Brésil en tant que Directeur exécutif de l'ONUSIDA.
M. Sidibé a rencontré le Ministre des Affaires Etrangères, M. Celso Amorim, le Ministre de la Santé, M. José Gomes Temporão, le Ministre des Droits de l'Homme, M. Paulo Vanucchi, et la Ministre de la Condition Féminine, Mme Nilcéa Freire.
Une réunion a également eu lieu entre M. Sidibé et le Groupe parlementaire sur le VIH/sida, le Groupe citoyen LGBTT (lesbiennes, gays, personnes bisexuelles, transsexuelles et travesties) et la Commission des droits de l'homme. Le forum, qui s'est tenu au Congrès national dans la capitale Brasília, a été l'occasion d'un échange animé d'idées et de points de vue sur un ensemble de questions fondamentales liées aux efforts du Brésil dans les domaines de la riposte à l'épidémie de VIH et du traitement des droits de l'homme. Ces questions ont été également abordées lors des entretiens que M. Sidibé a pu avoir avec le Président du Congrès et le Président du Sénat.
La société civile fait part des problèmes et des obstacles rencontrés dans la riposte aux diverses épidémies

UNAIDS Executive Director Michel Sidibé meets representatives of group Arco-Iris.
Photo: ONUSIDA/D. Ramalho
Les deux réunions distinctes avec des groupes de la société civile, qui se sont déroulées à Rio de Janeiro, ont fourni à M. Sidibé une vue d'ensemble des problèmes auxquels plusieurs populations affectées par le VIH doivent faire face, notamment les professionnel(le)s du sexe, les personnes transsexuelles, les adolescents homosexuels et les peuples indigènes de la région de l'Amazone.
Les dix représentants de l'Association brésilienne interdisciplinaire sur le sida (ABIA) ont informé M. Sidibé des difficultés à riposter aux multiples aspects des épidémies au Brésil.
La prévention du VIH a été présentée par plusieurs participants comme un problème à traiter d'urgence. Dans ce domaine, l'insuffisance des ressources permettant d'atteindre les groupes plus exposés au risque de contamination par le VIH est perçue comme le plus gros obstacle à la prévention des nouvelles infections.
Avec le Grupo Arco-Íris (Groupe arc-en-ciel), M. Sidibé a pu entendre les avis de plusieurs représentants de divers groupes LGBTT (lesbiennes, gays, personnes bisexuelles, transsexuelles et travesties). Ceux-ci ont exposé leurs inquiétudes et les problèmes auxquels les personnes LGBTT sont confrontées au Brésil.
Grupo Arco-Íris milite pour une modification de la loi par le sénat fédéral, afin que tout acte homophobe soit considéré comme une infraction criminelle. A ce jour, le groupe a recueilli la signature de plus 40 000 personnes soutenant cette modification de la loi. Le groupe a également lancé une campagne de prévention du VIH intitulée « entre garotos » (entre garçons) et destinée aux adolescents homosexuels âgés de 16 à 22 ans. Cette campagne prend la forme de publicités et d'affichages ciblés dans les cafés, les bars, les boîtes de nuit et autres lieux populaires auprès des jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
M. Sidibé a promis son soutien à la communauté LGBTT et encouragé les membres de cette communauté à mobiliser et à mettre en commun les efforts qui permettront de réaliser l'accès universel aux services liés au VIH au Brésil.
Right Hand Content
Multimédia:
Reportages:
L’organisation Viva Cazuza offre un foyer aux enfants brésiliens vivant avec le VIH (27 mars 2009)
La tuberculose, le VIH, l'accès universel et les droits de l'homme à l'ordre du jour de la visite du Directeur exécutif de l'ONUSIDA au Brésil (24 mars 2009)
Liens externes:
Related

Feature Story
L’organisation Viva Cazuza offre un foyer aux enfants brésiliens vivant avec le VIH
27 mars 2009
27 mars 2009 27 mars 2009
M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a profité de sa visite officielle au Brésil pour se rendre à la résidence de la ‘Sociedade Viva Cazuza’ le 26 mars, à Rio de Janeiro.
Photo: ONUSIDA/D. Ramalho
L’organisation Viva Cazuza travaille depuis près de deux décennies à Rio de Janeiro pour offrir aux enfants et aux jeunes rendus orphelins vivant avec le VIH un refuge, un traitement antirétroviral et un accès à des programmes leur permettant de prendre confiance en eux et de renforcer leurs compétences en matière de leadership.
L’organisation a été créée en 1990 en mémoire de Cazuza, star brésilienne du rock, qui est décédé d’une maladie liée au sida cette année-là. C’est une organisation à but non lucratif qui fournit un foyer à 20 enfants et adolescents âgés de 2 à 16 ans vivant avec le VIH. Bon nombre des résidents ont été abandonnés à la naissance ou laissés aux soins de l’organisation à un âge plus tardif.

M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a profité de sa visite officielle au Brésil pour se rendre à la résidence de la ‘Sociedade Viva Cazuza’ le 26 mars, à Rio de Janeiro.
Photo: ONUSIDA/D. Ramalho
La mère de Cazuza, Maria Lucia da Silva Araujo, a créé l’organisation avec l’appui des amis du musicien et de groupes d’artistes et de philanthropes plus larges. Depuis sa création, Viva Cazuza a aidé plus de 80 enfants.
M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a profité de sa visite officielle au Brésil pour se rendre à la résidence de la ‘Sociedade Viva Cazuza’ le 26 mars.
Pendant sa visite du foyer, M. Sidibé a été impressionné par la passion et l’engagement affichés par Maria Lucia da Silva Araujo pour aider les enfants vivant avec le VIH et plaider en faveur d’une plus large sensibilisation à la prévention. Il a déclaré que son travail « était plus qu’une simple aide, mais qu’il recréait la vie » pour les résidents.

Viva Cazuza a été créée par Maria Lucia da Silva Araujo (centre) en mémoire de son fils Cazuza, star brésilienne du rock, qui est décédé d’une maladie liée au sida en 1980.
Photo: ONUSIDA/D. Ramalho
Bon nombre des enfants plus âgés participent à des groupes de prévention du VIH et d’éducation sexuelle pour les pairs. Leonardo, quinze ans, est membre d’un groupe qui se réunit chaque mois pour parler de prévention. Il cherche par le dialogue à briser les préjugés dans lesquels la stigmatisation et la discrimination trouvent leurs racines.
Outre la fourniture d’une aide aux enfants et aux adolescents, l’organisation Viva Cazuza propose aussi un appui au traitement du VIH pour les adultes vivant dans le quartier voisin. Chaque mercredi, plus de 100 personnes s’arrêtent à la résidence pour recevoir leurs médicaments antirétroviraux et, si elles ont besoin de soutien, pour bavarder avec un conseiller.
Pour Viva Cazuza, la prochaine étape sera d’aider ses jeunes résidents en pleine croissance à se préparer à leur vie d’adulte et à leur indépendance prochaine. Leur donner les moyens grâce à un ensemble de compétences les aidera à garantir la pérennisation de leur santé et de leur bien-être lorsqu’ils auront quitté la résidence, y compris une bonne gestion de leur traitement.
Right Hand Content
Reportages:
La tuberculose, le VIH, l'accès universel et les droits de l'homme à l'ordre du jour de la visite du Directeur exécutif de l'ONUSIDA au Brésil (24 mars 2009)
L’héritage d’une star du rock aide des enfants vivant avec le VIH (1 mars 2007)
Multimédia:
Voir la galerie photos
Voir la vidéo: Un foyer aux enfants brésiliens vivant avec le VIH

Feature Story
Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA rencontre les directeurs des programmes antituberculeux et la société civile
26 mars 2009
26 mars 2009 26 mars 2009
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a rencontré les directeurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et les représentants de la société civile lors du 3ème Forum des membres du Partenariat Halte à la tuberculose à Rio de Janeiro, Brésil, le 24 mars 2009.
Credit:UNAIDS/D. Ramalho
M. Michel Sidibé, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a rencontré les directeurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et les représentants de la société civile lors du 3ème Forum des membres du Partenariat Halte à la tuberculose pour entendre leurs opinions sur les façons d’améliorer la riposte conjointe à la tuberculose et au VIH.
En faisant part de son expérience de la lutte contre la co-infection tuberculose et VIH en Zambie, un participant a exhorté M. Sidibé à utiliser sa position afin de mobiliser plus de leadership pour affronter les épidémies jumelles de tuberculose et de VIH et de rapprocher davantage les mouvements contre la tuberculose et le sida. Il a souligné que les épidémies de tuberculose et de VIH ne peuvent plus être abordées isolément. Pour illustrer ce point, un participant du Malawi a donné un exemple simple de la manière dont, jusqu’à récemment, le mouvement contre la tuberculose était rarement visible lors des conférences internationales sur le sida, et vice-versa. Ce point a été mis en évidence lorsqu’un participant de l’Inde a demandé « Si le virus et la bactérie travaillent si bien ensemble, comment se fait-il que nous ne puissions en faire de même ? »
Si le virus et la bactérie travaillent si bien ensemble, comment se fait-il que nous ne puissions en faire de même ? It is not acceptable that people living with HIV die from TB.
Un participant de l’Inde
Les participants ont convenu que la tuberculose sapait les succès récents réalisés par la riposte au VIH, réitérant les conclusions du rapport de l’OMS sur La lutte mondiale contre la tuberculose qui a révélé que l’impact de la tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH était beaucoup plus important qu’on ne l’avait compris jusqu’ici, du fait des meilleures données en provenance des pays.
Un dépistage accru de la tuberculose pour les personnes vivant avec le VIH – par le biais de services tuberculose/VIH pleinement intégrés – serait une étape importante et essentielle pour réduire le fardeau de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. Parmi les points supplémentaires soulevés par le groupe figurent une augmentation du financement, un personnel mieux formé et la recherche pour permettre un meilleur dépistage et une meilleure prévention de la tuberculose pour les personnes vivant avec le VIH, et davantage d’initiatives de plaidoyer et de sensibilisation du public sur la co-infection tuberculose et VIH.
M. Sidibé a demandé aux directeurs des programmes antituberculeux et à la société civile œuvrant dans le domaine de la tuberculose de collaborer plus étroitement avec leurs pairs dans la riposte au VIH pour mieux « atteindre les personnes jusque dans leurs communautés ». Il a terminé cette première conversation avec les directeurs de programmes et la société civile en déclarant « Il n’est pas acceptable que les personnes vivant avec le VIH meurent de la tuberculose » – un message-clé qu’il a répété tout au long des trois jours du Forum des membres du Partenariat Halte à la tuberculose.
Right Hand Content
Coparrainants:
Lutte contre la tuberculose à l’OMS
Partenaires:
Partenariat Halte à la tuberculose (en anglais)
Multimédia:
Reportages:
Elargissement et intensification nécessaires du dépistage intégré de la tuberculose et du VIH pour lutter contre des épidémies liées (24 mars 2009)
Centre de presse:
Les décès par tuberculose liés au VIH en hausse (24 mars 2009)
Allocution du Directeur exécutif de l’ONUSIDA lors de la séance de clôture du 3ème Forum des membres du Partenariat Halte à la tuberculose (pdf, 77 Kb) (en anglais)
External Liens externes
Page du Forum sur la tuberculose (en anglais)
Viva Cazuza
Symposium mondial sur l’implication des hommes

Feature Story
Des salons de coiffure et des salons de beauté favorisent l’éducation sur le VIH au Guyana
26 mars 2009
26 mars 2009 26 mars 2009Ce reportage a été initialement publié sur UNFPA.org

Dans le salon Kevin’s Reflections, les clients ont la possibilité de parler du VIH.
Photo: Carina Wint
Les salons de coiffure de Georgetown, au Guyana, sont des lieux où courent les bavardages. On y évoque les dernières modes, les événements communautaires, ses voisins, et, maintenant, les moyens de protéger les jeunes contre le sida. Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en collaboration avec le Secrétariat de l’ONUSIDA, a constaté que les salons de coiffure et les salons de beauté constituaient des lieux d’échange, et il les met actuellement à contribution pour diffuser des informations sur la prévention du VIH.
Le projet consiste à former du personnel de salon à répondre à des questions simples liées au VIH, à distribuer du matériel d’information et des préservatifs masculins et féminins aux clients, et même à fournir des services de conseil et de test sur place. Résultat, au Guyana, les jeunes ont accès à des informations et à des ressources qu’ils ne peuvent pas se procurer facilement dans d’autres lieux de leur communauté. Cela a son importance, car les niveaux de prévalence de leur petit pays (751 223 habitants) comptent parmi les plus élevés de la région : environ 1,6% pour les femmes enceintes, selon l’ONUSIDA. Chez les professionnel(le)s du sexe, la prévalence atteint 26,6%.

Dans certains salons de coiffure, il est possible de se procurer des préservatifs masculins et féminins.
Photo: Carina Wint
Juanita Huburn, une cliente de DJ’s Magic Fingers, un salon de coiffure qui participe au programme, qualifie la société guyanienne de « fermée » quand il s’agit des questions liées à la sexualité. « On ne parle pas de sexe. On nous dit seulement qu’il ne faudrait pas avoir de rapports sexuels, mais ce n’est pas réaliste », affirme-t-elle.
Les magasins et les salons ont été choisis en fonction de leur emplacement : centres commerciaux, parcs, lieux en vogue ou communautés à revenu faible. Les propriétaires qui ont accueilli le projet ont bénéficié d’une publicité supplémentaire pour leur petite entreprise ainsi que d’avantages, tels que l’accès à des supports promotionnels. « Les magasins ont été informés de la promotion que le projet assurerait à leur société et des avantages financiers qu’ils tireraient de leur participation », déclare Patrice La Fleur, attaché de liaison de l’UNFPA au Guyana. « Le plus important, c’est qu’ils mettent à disposition des lieux sûrs pour aborder la sexualité et la prévention du VIH. »
Les magasins ont été informés de la promotion que le projet assurerait à leur société et des avantages financiers qu’ils tireraient de leur participation. Le plus important, c’est qu’ils mettent à disposition des lieux sûrs pour aborder la sexualité et la prévention du VIH.
Patrice La Fleur, attaché de liaison de l’UNFPA au Guyana
Une fois que les lieux d’activité ont été sélectionnés, deux employés de chaque magasin ont reçu une formation sur les moyens de prévention et l’éducation de base sur le VIH. Ils ont également appris à effectuer un suivi adéquat du projet et ont été initiés à des pratiques sûres dans le cadre de leur propre activité (par exemple : garantir la stérilité des instruments employés pour les coupes de cheveux, des rasoirs, des aiguilles pour la couture et le tissage, du matériel de manucure et de pédicure, et de l’équipement nécessaire au tatouage et au piercing).
En plus de dispenser une formation aux participants sur la santé sexuelle et reproductive et les questions sexospécifiques, le projet vise à développer des compétences psychosociales, telles que la communication, les relations saines et le leadership. « Des participants ont fait part des progrès individuels qu’ils ont accomplis dans leurs relations avec leurs amis, leur famille et leurs clients », affirme Babsie Giddings, administratrice de programme de l’UNFPA, qui suit le projet.

Le salon de coiffure DJ’s Magic Fingers est un autre lieu de sensibilisation à la prévention du VIH.
Photo: Carina Wint
Depuis que le programme a été mis en place, les entreprises font état d’une augmentation constante de la clientèle, et de nouveaux magasins ont souscrit au projet. « Les affaires ont augmenté d’environ 5% depuis que nous avons adhéré au programme », déclare Kevin John, propriétaire du salon de coiffure Kevin’s Reflections. À son avis, cela peut venir en partie du fait que les gens savent que le matériel de son salon est désinfecté. Actuellement, plus de 7 000 préservatifs masculins et 400 préservatifs féminins sont distribués chaque mois sur demande dans les magasins et les salons.
Des travaux portant sur le projet ont été entrepris l’année dernière grâce aux efforts du Groupe thématique des Nations Unies, et ils ont été entièrement financés par l’ONUSIDA. Une ONG locale, Youth Challenge Guyana, collabore également au projet.
L’UNFPA apporte un soutien permanent, par une supervision et un suivi réguliers des salons de coiffure et salons de beauté participants. Le projet vise à offrir à quelque 2 000 jeunes un accès à des informations, des techniques, des services et du matériel, qu’ils peuvent utiliser pour protéger leur santé.
Right Hand Content
Coparrainants:
Reportages:
Les préservatifs et la prévention du VIH. (19 mars 2009)
Contrer les violences faites aux femmes : une tâche essentielle pour la toute nouvelle Coalition caribéenne sur les femmes, les filles et le sida (6 mars 2009)
La région Caraïbes doit cibler davantage sa prévention pour que sa riposte au VIH soit plus efficace (22 décembre 2008)
Publications:
Keeping Score II : Un rapport d’activité en vue de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui aux Caraïbes (pdf, 2,87 Mb) (en anglais)

Feature Story
L’ONUDC et l’Iran signent des accords visant à réduire la vulnérabilité des femmes et des réfugiés afghans face aux drogues et au VIH
24 mars 2009
24 mars 2009 24 mars 2009Cet article a été initialement publié sur UNODC.org

Des femmes d'Iran. Photo: ONUSIDA/P. Virot
Le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Antonio Maria Costa, et le Secrétaire général adjoint du service de lutte contre les drogues de la République islamique d’Iran, Taha Taheri, ont signé, le 19 mars, deux projets visant à fournir des services de prévention et de soins en matière de VIH aux réfugiés afghans et aux consommatrices de drogues injectables en Iran. Ces projets seront lancés grâce au financement du gouvernement des Pays-Bas.
Le but du premier projet est de soutenir les efforts nationaux visant à fournir des services complets de prévention et de soins en matière de VIH aux réfugiés afghans qui se trouvent en Iran et qui consomment des drogues injectables. Il s’agit d’un volet d’un projet sous-régional ciblant les réfugiés afghans pharmacodépendants qui se trouvent au Pakistan ainsi que ceux qui sont revenus en Afghanistan. Dans le cadre de cette initiative, l’ONUDC, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’ONUSIDA et l’Organisation internationale pour les Migrations, contribuera à fournir des services complets de prévention, de traitement, de soins et d’appui dans le domaine du VIH aux réfugiés afghans. Les gouvernements d’Afghanistan et du Pakistan participeront également à ce projet de trois ans.
Les drogues aggravent les difficultés auxquelles font face les réfugiés afghans, elles ne les résolvent pas. Il faut que nous allions au-devant de ce groupe vulnérable et que nous réduisions sa vulnérabilité face à l’abus des drogues et à la propagation du VIH/sida due à la consommation de drogues injectables.
Antonio Maria Costa, Directeur exécutif, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
Selon les dernières données en date, le nombre de réfugiés afghans en Iran s’élève à 900 000, alors qu’il avait atteint un pic de 2 millions en 2002-2003. Les réfugiés afghans représentent la population de réfugiés la plus importante du monde. « Les drogues aggravent les difficultés auxquelles font face les réfugiés afghans, elles ne les résolvent pas. Il faut que nous allions au-devant de ce groupe vulnérable et que nous réduisions sa vulnérabilité face à l’abus des drogues et à la propagation du VIH/sida due à la consommation de drogues injectables », a déclaré M. Costa. Il a été établi qu’il s’agissait d’un groupe à haut risque, pourtant loin de bénéficier pleinement des services complets de prévention, de traitement, de soins et d’appui en matière de VIH que l’Iran fournit à grande échelle aux consommateurs de drogues injectables et qui comprennent notamment le traitement de remplacement des opioïdes.
Le second projet cible un autre groupe vulnérable : les femmes iraniennes pharmacodépendantes et/ou touchées par le VIH. Le but de ce projet est d’améliorer l’accès à des services de qualité adaptés aux besoins spécifiques de ces femmes, notamment en milieu carcéral. Il viendra en complément des ressources importantes que le gouvernement d’Iran alloue déjà à la prévention et au traitement en matière de VIH ainsi que des mesures de réduction de la demande de drogues.
« Ces accords montrent une fois de plus qu’en matière de drogues, l’ONUDC adopte une démarche en faveur de la santé, et ils attestent d’un renforcement de notre partenariat avec la République islamique d’Iran », a affirmé M. Costa. « L’ONUDC est reconnaissant aux Pays-Bas de leur aide financière. » M. Costa a exhorté d’autres partenaires de financement à faire de même pour réduire la vulnérabilité des femmes et des réfugiés afghans face aux drogues et au VIH en Iran. « Il s’agit là d’un aspect humanitaire et souvent négligé de la lutte contre les drogues », a affirmé le directeur de l’ONUDC.
Right Hand Content
Coparrainants:
Centre de presse:
Le Haut Commissaire préconise de mettre l’accent sur les droits de l’homme et la réduction des risques dans la politique internationale en matière de stupéfiants (10 mars 2009) (10 March 2009) (en anglais)
Reportages:
OPINION : Le silence sur la réduction des risques n'est pas acceptable (11 mars 2009)
Consommation de drogues injectables : entretien avec le Chef de l'équipe Prévention, soins et appui de l'ONUSIDA (11 mars 2009)
51ème session de la Commission des stupéfiants (11 mars 2008)
Consommation de drogues injectables : une prévention ciblée du VIH est efficace (11 mai 2007)
Discours:
« Pourquoi nous avons besoin de la réduction des risques pour atteindre les objectifs de l’accès universel », discours de Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, à la Conférence des donateurs sur la réduction des risques, Amsterdam (28 January 2009) (pdf, 100 Kb) (en anglais)
Publications:
Collection Meilleures Pratiques : Sites à niveau élevé de couverture – Prévention du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables dans les pays en transition et en développement – Études de cas (pdf, 1,57 Mb)
Rapport d’activité de l’Iran, UNGASS 2008 ( en | Persian ) (pdf, 531 Kb | 2,59 Mb )
Related

Feature Story
Elargissement et intensification nécessaires du dépistage intégré de la tuberculose et du VIH pour lutter contre des épidémies liées
24 mars 2009
24 mars 2009 24 mars 2009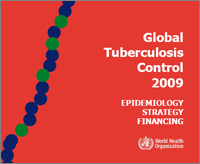
Bien que presque toujours évitable et soignable, la tuberculose est l’une des principales causes de décès parmi les personnes vivant avec le VIH à travers le monde. Sur les 33 millions de personnes qui vivent avec le virus, 20 % seulement connaissent leur statut sérologique et une infime fraction d’entre elles (2 % en 2007) ont fait l’objet d’un dépistage de la tuberculose, selon le rapport annuel de l’Organisation mondiale de la Santé sur la lutte mondiale contre la tuberculose présenté aujourd’hui.
Le VIH renforce considérablement l’épidémie de tuberculose en Afrique subsaharienne où jusqu’à 80 % des patients tuberculeux sont co-infectés par le VIH, selon le rapport. Infection respiratoire qui se propage comme un simple rhume, la tuberculose sollicite un système immunitaire déjà affaibli par le VIH.
« Nous devons empêcher que les personnes qui vivent avec le VIH décèdent de la tuberculose » a déclaré M. Michel Sidibe, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « L’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en rapport avec le VIH doit inclure la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Lorsque l’on combine les services de lutte contre le VIH et la tuberculose, des vies sont sauvées ».
"Nous devons empêcher que les personnes qui vivent avec le VIH décèdent de la tuberculose. L’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en rapport avec le VIH doit inclure la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Lorsque l’on combine les services de lutte contre le VIH et la tuberculose, des vies sont sauvées."
M. Michel Sidibe, Directeur exécutif de l’ONUSIDA
Le rapport Lutte mondiale contre le tuberculose 2009 présente une évaluation actualisée de l’épidémie de tuberculose et les progrès accomplis dans la lutte contre la maladie. Il indique qu’au niveau mondial, 16 % seulement des patients tuberculeux connaissent leur statut sérologique VIH, de sorte que la majorité des patients tuberculeux séropositifs au VIH ne savent pas qu’ils vivent avec le virus et n’ont pas accès au traitement du VIH.
Des progrès ont cependant été enregistrés dans ce domaine et l’on dénombre de plus de plus de patients traités pour la tuberculose qui font l’objet d’un dépistage du VIH, en particulier en Afrique. En 2004, 4 % seulement des patients tuberculeux de cette région avaient été soumis à un test de dépistage du VIH, mais en 2007, ce taux est passé à 37 % et dans certains pays (Kenya, Lesotho, Malawi, Rwanda et Swaziland) plus de 70 % des patients tuberculeux connaissent leur statut sérologique VIH.
Grâce à une augmentation des tests VIH chez les patients tuberculeux, un nombre croissant de personnes reçoivent des traitements appropriés, mais ce nombre ne représente cependant qu’une petite partie de ceux qui en ont besoin. En 2007, 200 000 patients tuberculeux séropositifs au VIH ont suivi un traitement au co-trimoxazole pour prévenir les infections opportunistes et 100 000 étaient sous traitement antirétroviral.
Des services intégrés de lutte contre la tuberculose et le VIH sont nécessaires
Pendant de longues années, les efforts engagés pour s’attaquer à la tuberculose et au VIH ont pour la plupart été menés séparément malgré un chevauchement épidémiologique entre les deux maladies. Une collaboration plus étroite entre les programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH conduira à une prévention et des traitements plus efficaces de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH et à des gains significatifs en termes de santé publique.
La publication du rapport aujourd’hui coïncide avec la journée mondiale de lutte contre la tuberculose et avec le 3ème Forum des membres du Partenariat Halte à la tuberculose qui réunit 1 500 personnes à Rio.
Elargissement et intensification nécessaires du dépistage intégré de la tubercul
Coparrainants:
Organisation mondiale de la Santé (en anglais)
Partenaires:
Partenariat Halte à la tuberculose
Reportages:
ICASA 2008: La collaboration en matière de tuberculose et de VIH est essentielle (3 dec 2008)
Premier Forum mondial des Leaders sur le VIH et la tuberculose (9 juin 2008)
Journée mondiale contre la tuberculose 2007 (23 mars 2007)
Entretien avec l’Envoyé spécial de l’ONU pour la lutte contre la tuberculose (21 mars 2007)
Centre de presse:
Les décès par tuberculose liés au VIH en hausse (24 mars 2009)
Liens externes:
3ème Forum des membres du Partenariat Halte à la tuberculose, Rio de Janeiro, Brésil, 23 - 25 mars 2009 (en anglais)
Publications:

Feature Story
La tuberculose, le VIH, l'accès universel et les droits de l'homme à l'ordre du jour de la visite du Directeur exécutif de l'ONUSIDA au Brésil
23 mars 2009
23 mars 2009 23 mars 2009
(from left) Executive Director, UNAIDS Michel Sidibé and Director, Stop TB Department WHO, Dr Mario Raviglione during the press conference launch of Global TB Control 2009, 24 March 2009.
Credit: UNAIDS/D. Ramalho
M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA, se trouve cette semaine au Brésil, afin de sensibiliser davantage au lien entre épidémies de VIH et de tuberculose, à l'accès universel aux services de prise en charge du VIH, et à la nécessité de s'atteler au problème de la stigmatisation et de la discrimination dans la riposte au sida au Brésil.
Plus tôt dans la journée à Rio de Janeiro, M. Sidibé a participé au lancement international du rapport annuel de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la lutte contre la tuberculose.
Bien que la tuberculose soit une maladie qu'il est possible de prévenir et de soigner, elle constitue néanmoins une des premières causes de mortalité parmi les personnes vivant avec le VIH à l'échelle mondiale. Sur les 33 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 20% seulement connaissent leur état sérologique et seule une très faible part de cette population, 2% en 2007, a subi un test de dépistage de la tuberculose selon le Rapport mondial 2009 sur la lutte contre la tuberculose.
"L'accès universel à la prévention, aux traitements et à la prise en charge médico-sociale du VIH doit également intégrer la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. La prise en charge combinée du VIH et de la tuberculose permet de sauver des vies."
M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA
« Nous devons faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH ne meurent plus de la tuberculose », a déclaré M. Sidibé. « L'accès universel à la prévention, aux traitements et à la prise en charge médico-sociale du VIH doit également intégrer la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. La prise en charge combinée du VIH et de la tuberculose permet de sauver des vies.»
Plusieurs personnalités étaient également présentes aux côtés du Directeur exécutif de l'ONUSIDA pour le lancement du rapport : le Dr Michel Kazatchkine, Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, M. Mr Hiroki Nakatani, Sous-Directeur général du Département VIH/sida, tuberculose, paludisme et maladies tropicales négligées de l'OMS, le Dr Mario Raviglione, Directeur du Département Halte à la tuberculose, et le Dr Marcos Espinal, Secrétaire exécutif du Partenariat Halte à la tuberculose.
Le lancement du rapport fait partie des manifestations organisées à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, qui a lieu pendant le 3e Forum du Partenariat Halte à la tuberculose, lequel s'est ouvert le 23 mars à Rio de Janeiro. M. Sidibé prononcera un discours lors de la clôture du forum le 25 mars.
En début de semaine, M. Sidibé se rendra à Brasília, où il rencontrera des hauts responsables du Gouvernement brésilien, notamment le groupe parlementaire sur le VIH au Congrès national et les ministres des affaires étrangères, des politiques de la femme, de la santé et des droits de l'homme.
Afin d'amplifier le message de l'ONUSIDA visant à soutenir les personnes affectées par le VIH et à contrer les lois faisant obstacle à la riposte au sida, M. Sidibé rencontrera plusieurs acteurs de la société civile agissant dans les domaines de la sensibilisation au problème du VIH, de la protection des droits de l'homme, de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, en particulier à l'égard des personnes plus vulnérables vis-à-vis du VIH. Une rencontre réunira des délégués nationaux de groupes représentant des personnes vivant avec le VIH, des jeunes, des femmes, des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles, afin de débattre de ces questions dans le contexte à la fois local et national.
A Rio de Janeiro, des visites sont prévues à des organisations qui assurent des services essentiels auprès des enfants et des jeunes. L'une de ces organisations, la Sociedade Viva Cazuza, est une organisation à but non lucratif qui apporte un soutien aux enfants, aux jeunes et aux adultes qui vivent avec le VIH, en assurant tout un éventail de services qui vont du conseil et du test VIH à l'administration de traitements antirétroviraux, sous l'égide du système de soins de santé de la ville de Rio de Janeiro. Au-delà du soutien matériel, la Sociedade Viva Cazuza propose également un site web par l'intermédiaire duquel les gens peuvent poser leurs questions concernant le VIH ou tout autre problème de santé sexuelle à des experts.
En Amérique latine, le Brésil a la plus importante épidémie de VIH et abrite plus de 40% des personnes (730 000) vivant avec le virus sur le continent, suivi par le Mexique qui compte 200 000 personnes séropositives. Le pays récolte cependant les fruits de sa volonté résolue d'assurer un accès aux services de prévention et de traitement du VIH, ce qui a permis de stabiliser l'épidémie et de diminuer de moitié le taux de mortalité due au sida entre 1996 et 2002.
Le 30 mars, M. Sidibé se joindra à Mme Nilcéa Freire, Ministre des Politiques de la Femme, pour l'inauguration du premier centre axé sur la réhabilitation des hommes violents à l'égard des femmes. Situé à Nova Iguaçu, une commune de l'agglomération de Rio de Janeiro, le centre mettra l'accent sur des programmes d'éducation visant à mettre un terme à la violence domestique. Dix autres centres de ce type sont prévus dans le pays.
M. Sidibé terminera sa visite officielle en fin de journée par un discours aux délégués réunis pour l'ouverture du Symposium mondial sur l'implication des hommes et des garçons dans l'égalité entre les sexes.
Il s'agit de la première visite officielle de Michel Sidibé au Brésil depuis sa nomination au poste de Directeur exécutif de l'ONUSIDA.
La tuberculose, le VIH, l'accès universel et les droits de l'homme à l'ordre du
Coparrainants:
Partnaires:
Multimédia:
Reportages:
Elargissement et intensification nécessaires du dépistage intégré de la tuberculose et du VIH pour lutter contre des épidémies liées (24 mars 2009)
Centre de presse:
Les décès par tuberculose liés au VIH en hausse (24 mars 2009)
Liens externes:
La page du Forum sur la tuberculose (en anglais)
Viva Cazuza (en portugais)
Symposium mondial sur l'implication des hommes dans l'égalité des sexes (en anglais)

Feature Story
‘Swing’ et ‘Sisters’: activités de proximité parmi la communauté engagée dans le commerce du sexe en Thaïlande
19 mars 2009
19 mars 2009 19 mars 2009
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA a visité les deux organisations cette semaine afin de mieux comprendre comment elles effectuent leurs activités de proximité parmi la communauté engagée dans le commerce du sexe à Pattaya.
Photo: ONUSIDA/Vinai Dithajohn
Cheminant dans la foule, Surang Janyan salue de la main son amie Gop, qui est l’une des nombreuses personnes qu’elle croisera ce soir le long de la Walking Street de Pattaya – une longue rue qui longe l’un des quartiers chauds de la Thaïlande.
Surang Janyam est la Fondatrice et Directrice de Swing, une petite association qui apporte son appui aux professionnel(le)s du sexe en Thaïlande. Elle se rend régulièrement chez Gop vers minuit pour s’assurer qu’elle ou ses employé(e)s n’ont besoin de rien. Gop est propriétaire de l’un des bars les plus populaires de Pattaya, le ‘Wild West Boys’, où se rendent les hommes pour assister au spectacle et pour passer un peu de temps avec les professionnels du sexe qui y travaillent, au bar ou en privé pour fournir des services sexuels.
Près de 70 professionnels du sexe travaillent pour Gop, et Surang connaît bien un grand nombre d’entre eux. « Les membres de Swing viennent nous parler et nous donner des préservatifs, » explique Gop. « Et ils expliquent aux garçons comment les utiliser correctement. » Les membres et bénévoles de Swing distribuent plusieurs milliers de préservatifs chaque mois et fournissent des renseignements sur le VIH et sur la manière de se protéger du virus.
Le VIH parmi les professionnel(le)s du sexe et l’accès aux services constituent l’un des grands défis de la riposte au sida en Thaïlande. Il est extrêmement important que les professionnel(le)s du sexe aient accès aux services de prévention et de traitement du VIH sans avoir à craindre la discrimination.
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA
« Le VIH parmi les professionnel(le)s du sexe et l’accès aux services constituent l’un des grands défis de la riposte au sida en Thaïlande, » explique Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Il est extrêmement important que les professionnel(le)s du sexe aient accès aux services de prévention et de traitement du VIH sans avoir à craindre la discrimination. »
Swing travaille avec un grand nombre de bars et surtout de propriétaires de bars. « Il est important de gagner la confiance des propriétaires de bars pour avoir accès aux professionnel(le)s du sexe eux/elles-mêmes, » précise Patrick Brenny, Coordonnateur de l’ONUSIDA en Thaïlande. « Le faible niveau – environ 28% – des connaissances relatives au VIH parmi les professionnel(le)s du sexe en Thaïlande est préoccupant et il est important de pouvoir leur apporter les compétences nécessaires pour qu’ils/elles puissent se protéger ainsi que leurs clients. »
Plus loin dans la rue, Surang rencontre une autre de ses amies, Nueng, qui travaille pour Sisters, le premier service de conseil en Thaïlande dédié exclusivement à la communauté transsexuelle. Pendant la haute saison, Pattaya reçoit quelque 1000 personnes transsexuelles.
« Nous avons créé le centre en 2005 pour obtenir l’appui du public et une meilleure acceptation de la communauté transsexuelle à Pattaya, » déclare Nueng, qui est responsable des activités de proximité de Sisters. « Avant la création de notre centre, la communauté transsexuelle n’avait aucun lieu où se réunir et ne savait à qui s’adresser pour obtenir conseil et soutien. Il y avait des services pour les professionnel(le)s du sexe hommes et femmes, mais rien pour les personnes transsexuelles, nous étions isolées et les gens ne nous comprenaient pas. »
Pattaya est devenu le lieu favori de permission des soldats américains durant la guerre du Viet Nam et est depuis lors une des points chauds du tourisme sexuel qui attire des milliers de visiteurs chaque année.
Sisters, comme Swing, dispose d’un centre d’accueil à Pattaya, qui offre des services médicaux, le conseil, l’acquisition de compétences ainsi que des activités sociales comme le maquillage, le sport et la cuisine.
Nueng est elle-même transsexuelle et comprend donc bien la stigmatisation et la discrimination auxquelles sont confrontées les professionnelles du sexe transsexuelles.
« Nous rencontrons bien des problèmes en raison de notre transsexualité, » explique-t-elle. « Si nous tentons d’accéder aux services de santé, le personnel est souvent bien peu aimable avec nous et nous traite injustement. C’est pourquoi nous essayons d’offrir un soutien à nos sœurs transsexuelles et de mieux sensibiliser la communauté afin que les gens nous acceptent mieux. »
Nueng porte un T-shirt que le groupe a fait imprimer, afin les membres de l’association soient facilement reconnues lorsqu’elles travaillent. Les T-shirts sont rose vif et portent les mots ‘Sisters, notre autre foyer’.
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA a visité les deux organisations cette semaine afin de mieux comprendre comment elles effectuent leurs activités de proximité parmi la communauté engagée dans le commerce du sexe à Pattaya.
La collaboration avec les professionnel(le)s du sexe pour définir leurs besoins et plaider en faveur de politiques et programmes susceptibles d’améliorer leur santé, leur sécurité et leur participation à la riposte au sida est une stratégie avérée et un élément essentiel de l’approche de l’ONUSIDA.
‘Swing’ et ‘Sisters’: activités de proximité parmi la communauté engagée dans le
Multimédia:
Reportages:
Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA en visite en Thaïlande (17 Mars 2009)
Réunion du Forum des dirigeants de la région Asie-Pacifique (19 mars 2009)
Publications:
Note d’orientation de l’ONUSIDA sur le VIH et le commerce du sexe (pdf, 238 Kb) (en anglais)
Related

Feature Story
Les préservatifs et la prévention du VIH
19 mars 2009
19 mars 2009 19 mars 2009[Initialement publié en 2004, actualisé en 2009]

L’utilisation du préservatif est une composante essentielle d’une stratégie complète, efficace et durable de prévention et de traitement du VIH.
Photo: ONUSIDA.
L’utilisation du préservatif est une composante essentielle d’une stratégie complète, efficace et durable de prévention et de traitement du VIH.La prévention est le fondement de la riposte au sida. Les préservatifs sont une composante essentielle et font partie intégrante de programmes complets de prévention et de soins, et il faut accélérer leur promotion. En 2007, on estimait à 2,7 millions le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH. 45 % d’entre elles environ étaient des jeunes de 15 à 24 ans et les jeunes filles sont exposées à un risque d’infection plus important que les garçons.
Le préservatif masculin en latex est la seule technologie disponible la plus efficace pour réduire la transmission sexuelle du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles.
La recherche de nouvelles technologies de prévention, telles que les vaccins contre le VIH et les microbicides, continue d’avancer, mais les préservatifs resteront le principal outil de prévention pour un très grand nombre d’années encore. Les préservatifs sont une composante essentielle des stratégies de prévention que les personnes peuvent choisir de combiner à différents moments de leur vie pour réduire leur risque d’exposition sexuelle au VIH. Celles-ci incluent : retarder l’âge du premier rapport sexuel, s’abstenir sexuellement, prendre des risques moindres en étant – et en restant – fidèle à son partenaire lorsqu’aucun des deux partenaires n’est infecté, réduire le nombre de partenaires sexuels, utiliser correctement et régulièrement des préservatifs(1), se faire circoncire.
Des données concrètes probantes générées par une recherche élargie portant sur des couples hétérosexuels dont l’un des partenaires est infecté par le VIH révèlent qu’une utilisation correcte et régulière du préservatif réduit de manière significative le risque de transmission du virus de l’homme à la femme et de la femme à l’homme(2). Des études de laboratoire montrent que les préservatifs masculins en latex sont imperméables aux agents infectieux contenus dans les sécrétions génitales(3). Pour garantir sécurité et efficacité, la fabrication des préservatifs doit respecter les normes internationales les plus strictes. Ils doivent être fournis conformément aux procédures d’assurance de la qualité établies par l’OMS, l’UNFPA et l’ONUSIDA, et conservés à l’abri de sources directes de chaleur. Les programmes de prévention doivent s’assurer que des préservatifs de haut niveau de qualité sont accessibles pour ceux qui en ont besoin quand ils en ont besoin, et que les personnes ont les connaissances et les compétences nécessaires pour les utiliser correctement.
Il faut vraiment que les préservatifs soient facilement accessibles partout dans le monde, soit gratuitement soit à prix réduit, et promus d’une manière qui contribue à dépasser les obstacles sociaux et personnels à leur utilisation.
Les gens sont plus susceptibles d’utiliser des préservatifs lorsqu’ils peuvent les obtenir gratuitement ou à des prix fortement subventionnés. Une promotion efficace du préservatif cible non seulement la population générale mais également les personnes les plus exposées au risque d’infection à VIH, en particulier les femmes, les jeunes, les professionnel(le)s du sexe et leurs clients, les consommateurs de drogues injectables et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. L’UNFPA estime que l’offre actuelle de préservatifs dans les pays à revenu faible et intermédiaire est très inférieure à ce qui serait nécessaire (disponibilité insuffisante de préservatifs)(4). Malgré cette insuffisance, les financements internationaux destinés à l’achat de préservatifs n’ont pas augmenté ces dernières années. Il faut mettre en œuvre des actions collectives à tous les niveaux pour soutenir les efforts des pays, en particulier ceux qui sont tributaires de l’aide extérieure pour acheter, promouvoir et distribuer des préservatifs.
L’éducation à la prévention du VIH et la promotion des préservatifs doivent dépasser les obstacles liés à des facteurs complexes sexospécifiques et culturels.
Les jeunes filles et les femmes se voient régulièrement refuser des informations sur les préservatifs et l’accès à ceux-ci. Elles n’ont souvent pas les moyens de négocier l’utilisation des préservatifs. Dans de nombreux milieux, les hommes se montrent réticents à les utiliser et il faut en avoir conscience lorsque l’on conçoit des programmes de promotion des préservatifs. Les préservatifs féminins peuvent offrir aux femmes un meilleur moyen de contrôle pour se protéger. Les femmes resteront cependant extrêmement vulnérables à l’exposition au VIH jusqu’à ce que les hommes et les femmes partagent des pouvoirs équitables lorsqu’ils prennent des décisions relatives à leurs relations mutuelles.
Les préservatifs ont joué un rôle décisif dans les efforts de prévention du VIH dans de nombreux pays.
Les préservatifs ont aidé à réduire les taux d’infection à VIH là où le sida est déjà installé, limitant une propagation plus large du virus dans des milieux dans lesquels l’épidémie reste concentrée dans des groupes spécifiques de population.
Les préservatifs ont aussi encouragé une plus grande généralisation des comportements sexuels à moindre risque. Une étude récente sur l’épidémie de sida en Ouganda a confirmé qu’une utilisation accrue du préservatif, parallèlement à un report à un âge plus élevé du premier rapport sexuel et à une réduction du nombre de partenaires sexuels, était un facteur important de la diminution de la prévalence du VIH dans les années 90(5). Les efforts de la Thaïlande pour déstigmatiser les préservatifs et les promouvoir de manière ciblée auprès des professionnel(le)s du sexe et de leurs clients ont considérablement réduit les infections à VIH parmi ces groupes de population et contribué à limiter la propagation de l’épidémie à la population générale. Au Cambodge, un politique similaire a aidé à stabiliser la prévalence nationale tout en réduisant substantiellement la prévalence parmi les professionnel(le)s du sexe. En outre, la campagne précoce et dynamique de promotion des préservatifs auprès de la population générale et des groupes vulnérables au Brésil a contribué avec succès à lutter durablement contre l’épidémie.
Un accès élargi au traitement antirétroviral met en évidence le besoin et le caractère opportun d’une accélération de la promotion du préservatif.
Dans les pays industrialisés, les succès des thérapies antirétrovirales en matière de réduction des maladies et de prolongation de la vie peuvent altérer la perception des risques associés au VIH(6). La perception d’un risque faible et une certaine confiance excessive dans les progrès peuvent conduire les gens à avoir des rapports sexuels non protégés du fait d’une utilisation réduite ou irrégulière des préservatifs. La promotion d’une utilisation correcte et régulière des préservatifs dans les programmes de traitement antirétroviral et dans les services de planning familial et de santé reproductive, est essentielle pour limiter les nouveaux risques de transmission du VIH. Il est nécessaire d’élargir et d’intensifier rapidement le conseil et le test du VIH pour répondre aux besoins de prévention de toutes les personnes, qu’elles soient séropositives ou séronégatives au VIH.
1 ONUSIDA. Rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2004, page.72.
2 Holmes K, Levine R, Weaver M. Efficacité du préservatif pour la prévention des infections sexuellement transmissibles. Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé. Genève. Juin 2004.
3 OMS/ONUSIDA. Note d’information sur l’efficacité du préservatif pour la prévention des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH. Genève. Août 2001.
4 UNFPA. Rapport 2007 sur l’Appui des donateurs en matière de produits contraceptifs et de préservatifs pour la prévention des IST/du VIH.
5 Singh S, Darroch J.E, Bankole A. A, B et C en Ouganda : le rôle de l’abstinence, de la monogamie et de l’utilisation du préservatif dans la diminution du VIH. The Alan Guttmacher Institute. Washington DC. 2003.
6 Gremy I, Beltzer N. Risque d’infection à VIH et utilisation du préservatif parmi la population hétérosexuelle adulte en France entre 1992 et 2001 : retour au point de départ ? (en anglais) AIDS 2004;18:805-9.
Back to top
Les préservatifs et la prévention du VIH
Coparrainants:
Centre de presse:
Téléchargez la version imprimable (pdf, 60 Kb)
L’ONUSIDA encourage la prévention du VIH en association pour atteindre les objectifs de l’accès universel (18 mars 2009)
Reportages:
Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA en visite en Thaïlande (17 mars 2009)
Réunion du Forum des dirigeants de la région Asie-Pacifique (19 mars 2009)
Publications:
Collection Meilleures Pratiques: Faire du préservatif un outil efficace de prévention du VIH (pdf, 1.1 Mb) (en anglais)











