

Feature Story
Circoncision masculine médicale volontaire : une campagne essentielle pour atteindre les objectifs de la stratégie Accélérer
17 octobre 2016
17 octobre 2016 17 octobre 2016Les maladies liées au sida restent l'unique cause la plus importante d'années de vie perdues chez les adolescents et les hommes en âge de procréer en Afrique orientale et australe, alors que peu de politiques et de programmes se focalisent sur les services anti-VIH ciblés sur les hommes et les garçons et l'amélioration de leur accès aux soins. Pourtant, un type de programme, la circoncision masculine médicale volontaire (CMMV), sort du lot, car il atteint les hommes et les garçons en grand nombre et se révèle efficace à 60 % dans la prévention de la transmission du VIH de la femme à l'homme.
En 2007, des données probantes solides de l'impact préventif de la CMMV ont conduit l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'ONUSIDA à recommander la CMMV, en particulier dans les pays très touchés avec une faible prévalence de la circoncision masculine. Les deux organisations ont encouragé l'intensification de la circoncision masculine médicale volontaire dans 14 pays (Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, Rwanda, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe), guidée par les actions des ministères de la santé et d'autres parties prenantes.
L'objectif très ambitieux fixé était de proposer des services de CMMV à plus de 20 millions d'hommes d'ici fin 2016 dans les pays prioritaires. Fin 2015, 11,7 millions d'adolescents et d'hommes avaient été circoncis, et d'ici fin 2016 ce nombre devrait atteindre 14 millions : un immense succès, quel que soit le chiffre. Certains pays atteignent et dépassent les objectifs. En 2015, la province de Gambella en Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie avaient tous dépassé leurs objectifs fixés en 2011.
Aujourd'hui, les gouvernements et des partenaires comme l'ONUSIDA, l'OMS et le Plan présidentiel américain d'aide d'urgence à la lutte contre le sida sont engagés dans la poursuite de l'élargissement et le maintien de ce programme couronné de succès, mais il existe des sources d'inquiétude. Après des années d'augmentation rapide, le nombre annuel de circoncisions réalisées dans huit des 14 pays prioritaires a stagné ou diminué en 2015.
Des orientations sont toutefois prévues pour faire avancer les choses. Un nouveau rapport de l'OMS et de l'ONUSIDA, Prévention efficace du VIH et passerelle pour une amélioration de la santé des adolescents et des hommes en Afrique orientale et australe d'ici 2021, décrit les nouvelles orientations stratégiques pour les années à venir. Pour atteindre les objectifs de la stratégie Accélérer, le nombre annuel de CMMV doit passer à 5 millions par an. Dans le même temps, une approche globale de la prestation de services centrée sur l'individu pour les hommes et les garçons doit être adoptée au niveau des pays, avec des services sur mesure à proposer aux individus de différentes tranches d'âge et avec des profils de risque différents.
Le rapport énumère les éléments clés suivants sur la réalisation desquels tous les acteurs sont encouragés à collaborer :
- Promouvoir la CMMV dans le cadre d'un ensemble plus large de services de santé sexuelle et reproductive pour les hommes et les garçons, avec une éducation complète à la sexualité, l'usage du préservatif et la communication autour des normes de genre, y compris des notions positives de virilité.
- Utiliser de nouveaux modèles de prestation de service intégrés.
- Adopter des approches adaptées en fonction des divers groupes d'âge et des lieux géographiques.
- Augmenter le financement national pour assurer la pérennité de la CMMV et étendre les services de santé sexuelle et reproductive pour les hommes et les garçons.
- Développer de nouvelles approches pour la circoncision des adolescents et des nourrissons.
- Dénoncer les mythes et les fausses idées autour de la circoncision.
La Clearinghouse on Male Circumcision pour la prévention du VIH est le fruit d'un effort collaboratif entre plusieurs partenaires, dont l'ONUSIDA, pour l'échange d'informations et de ressources avec la communauté internationale de santé publique. La bibliothèque des ressources propose plus de 900 entrées et peut être consultée par thème ou par pays.
« La circoncision masculine médicale volontaire fournit un point de départ très utile pour atteindre les hommes et les garçons avec d'autres services de prévention du VIH et de santé, ce qui bénéficiera également par la suite aux femmes et aux filles », explique Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Sans cela, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs », ajoute t-il.
Related videos
Related


Feature Story
Pour en finir avec le sida d'ici à 2030, il faut investir dans les programmes de réduction des risques pour les consommateurs de drogues injectables
10 octobre 2016
10 octobre 2016 10 octobre 2016Pour en finir avec l'épidémie de sida d'ici à 2030, la riposte mondiale au VIH ne doit laisser personne de côté, y compris les consommateurs de drogues injectables. Il est nécessaire d'avoir des politiques de lutte contre les drogues et des services de prévention, de traitement, de soins et d'appui anti-VIH qui tiennent compte des droits humains et répondent aux besoins de santé des consommateurs de drogues injectables.
Les estimations montrent que, dans le monde, il existe environ 12 millions de consommateurs de drogues injectables, dont 1,6 million (14 %) vivent avec le VIH et 6 millions (50 %) vivent avec l'hépatite C. La prévalence du VIH chez les femmes qui consomment des drogues injectables est souvent plus élevée que chez leurs homologues masculins. Selon l'ONUSIDA, 140 000 consommateurs de drogues injectables ont été nouvellement infectés par le VIH dans le monde en 2014 et aucune baisse n'a été enregistrée dans le nombre annuel de nouvelles infections à VIH chez les consommateurs de drogues injectables entre 2010 et 2014.
Le rapport de l'ONUSIDA intitulé Pour moins de risque – santé, droits humains et consommateurs de drogues indique que des lois et des politiques moins répressives à l'égard des consommateurs de drogues et une hausse des investissements dans les programmes et les services de réduction des risques se traduisent par une baisse des nouvelles infections à VIH et un meilleur état de santé, tout en apportant des bénéfices sociaux de manière plus générale.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'ONUSIDA recommandent l'emploi de ces programmes et services sous la forme d'un ensemble complet, tel que décrit dans les Lignes directrices unifiées de l'OMS sur la prévention du VIH, le diagnostic, le traitement et les soins pour les populations clés.
La réduction des risques, ça fonctionne
Les preuves sont incontestables : la réduction des risques fonctionne. Le traitement substitutif aux opiacés a été associé à une réduction de 54 % du risque d'infection à VIH chez les consommateurs de drogues injectables et une baisse du risque d'infection par le virus de l'hépatite C, une augmentation de l'observance du traitement antirétroviral pour le VIH, une baisse des dépenses de santé non remboursées et une réduction du risque d'overdose aux opiacés de près de 90 %.
En Australie, 10 années de programmes aiguilles-seringues ont vu diminuer le nombre de cas de VIH jusqu'à 70 % et celui d'hépatite C jusqu'à 43 %.
Les données probantes montrent aussi clairement que les lois et les politiques qui empêchent les consommateurs de drogues d'accéder aux services de santé ne fonctionnent pas. Par exemple, la surveillance policière des lieux de soins et de services de réduction des risques décourage les consommateurs de drogues injectables d'accéder à ces services.
« Accélérer la riposte au sida nécessite de défendre les droits des consommateurs de drogues d'accéder à des services de réduction des risques de haute qualité, éclairés par des données probantes, et de supprimer les obstacles à l'accès à ces services », explique Aldo Lale-Demoz, Directeur exécutif adjoint de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Appliquer des lois qui proposent une alternative aux poursuites judiciaires et à l'incarcération pour usage et possession de drogues pour consommation personnelle permet de réduire les effets nocifs pour la santé associés à la consommation de drogues et n'aboutit pas à une augmentation de la consommation de drogues.
Les programmes de réduction des risques pilotés par les communautés peuvent atteindre les consommateurs de drogues injectables à travers les programmes aiguilles-seringues et d'autres services et orienter vers le dépistage, le traitement et les soins pour les personnes vivant avec le VIH. Au Pakistan par exemple, le Nai Zindagi Trust, un programme de proximité piloté par des pairs, fonctionne depuis 25 ans et s'occupe d'environ 13 000 consommateurs de drogues injectables vivant dans la rue par l'intermédiaire de plus de 600 pairs-éducateurs formés.
Le problème de l'investissement
Pourtant, malgré un large corpus de preuves, seulement 80 des 158 pays dans lesquels la consommation de drogues injectables a été recensée disposent d'au moins un lieu proposant un traitement substitutif aux opiacés, et seulement 43 pays ont mis en place des programmes dans les prisons. Les programmes aiguilles-seringues sont disponibles dans 90 pays uniquement et seuls 12 pays fournissent le seuil recommandé de 200 aiguilles stériles par consommateur de drogues injectables et par an.
La combinaison entre l'indisponibilité des services de réduction des risques et une couverture inadéquate là où ils existent met en péril le progrès de la riposte au VIH. Cela revient aussi à refuser des services de santé vitaux aux millions de consommateurs de drogues injectables.
« Lorsqu'il s'agit de consommateurs de drogues, les preuves sont nécessaires mais insuffisantes pour catalyser les engagements impératifs des gouvernements et des donateurs. La réduction des risques est une méthode de prévention du VIH qui fonctionne clairement, a la faveur des gens qui en ont besoin et coûte peu cher. Le désengagement financier n'a aucun sens, ni scientifiquement, ni moralement », déclare Daniel Wolfe, de l'Open Society Foundations.
Les investissements actuels dans les services de réduction des risques sont insuffisants. De même, le maintien des niveaux actuels ne suffira pas pour en finir avec l'épidémie de sida d'ici à 2030 et être à la hauteur des engagements pris dans la Déclaration politique de 2016 sur la fin du sida. La majorité des consommateurs de drogues injectables vivent dans les pays à revenu intermédiaire et élevé, mais les politiques actuelles des donateurs détournent l'aide internationale hors des pays à revenu intermédiaire, mettant en danger la continuité des services existants avec un risque de revirement des succès remportés à ce jour.
Il faut espérer que les gouvernements des pays touchés, la reconstitution réussie du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que de nouvelles initiatives comme le Fonds d'investissement pour les populations clés, contribueront de manière significative à l'intensification des programmes fondés sur des données probantes pour les consommateurs de drogues injectables.
« Les consommateurs de drogues injectables figurent parmi ceux qui ont été le plus laissés de côté par la riposte mondiale au VIH », déclare Mauro Guarinieri du Fonds mondial. « Nous devons admettre que le niveau de criminalisation, de discrimination et de violence auquel sont confrontés les consommateurs de drogues ne peut que se traduire par l'incitation à des comportements de prise de risque, en les excluant des systèmes d'appui sociaux et de santé dont ils ont besoin. Nous devons aller vers un traitement universel, pour tout le monde y compris les consommateurs de drogues, parce que ce sont des êtres humains comme nous ».
Resources
Related


Feature Story
Décentralisation des services de dépistage du VIH pour élargir l'accès aux consommateurs de drogues injectables au Viet Nam
12 octobre 2016
12 octobre 2016 12 octobre 2016Au Viet Nam, l'Autorité de contrôle du VIH/sida et le Ministère de la Santé ont piloté des services de dépistage du VIH de proximité afin d'accroître le recours à ces services chez les consommateurs de drogues injectables et leurs partenaires. Un dépistage du VIH a été proposé deux fois par mois dans les villages qui abritent d'importantes communautés de consommateurs de drogues injectables.
L'équipe de proximité était composée de deux professionnels de santé, un agent de santé du village et un pair-éducateur. Les consommateurs de drogues injectables et leurs partenaires étaient invités à se rendre dans un lieu accueillant pour recevoir des conseils sur le VIH et bénéficier de tests de dépistage rapides. Les résultats des tests réactifs étaient ensuite envoyés pour un dépistage de confirmation et les patients dont le diagnostic de séropositivité au VIH était confirmé étaient conseillés et mis en relation avec un hôpital pour recevoir un traitement et des soins.
Entre septembre 2014 et janvier 2015, 8,9 % des personnes dépistées ont été diagnostiquées séropositives au VIH, soit environ 4 fois plus que le pourcentage constaté dans les établissements de soins primaires locaux. Le résultat de ce programme pilote permet de conclure que la fourniture de services de dépistage du VIH à base communautaire est une méthode faisable et efficace pour augmenter la connaissance de l'état sérologique vis-à-vis du VIH chez les consommateurs de drogues injectables et leurs partenaires, de même que dans d'autres populations clés. Les pair-éducateurs et les agents de santé des villages ont joué un rôle fondamental dans le contact avec la population cible. Ce modèle va éclairer l'élaboration de directives nationales sur le dépistage du VIH à base communautaire. Source : http://who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/.
Pour en savoir plus sur la réduction des risques, rendez-vous sur la page consacrée à ce sujet sur le site de l'Organisation mondiale de la Santé http://who.int/hiv/topics/idu/fr/ .
Region/country
Related

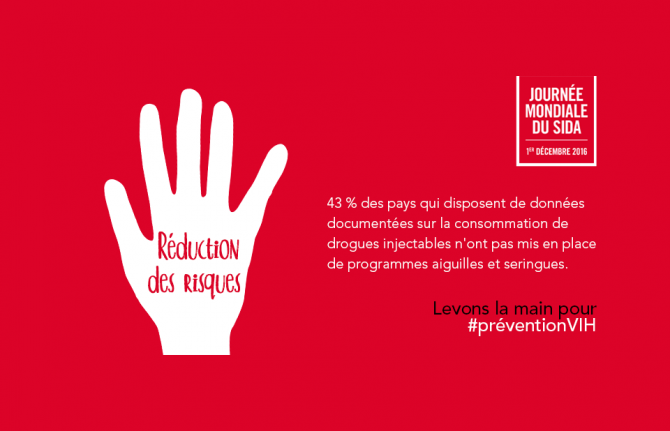
Mettre à jour
Réduction des risques
10 octobre 2016
10 octobre 2016 10 octobre 2016Les consommateurs de drogues injectables comptent parmi les populations clés les plus exposées au risque de contracter ou de transmettre le VIH. Pourtant, ce sont aussi ceux qui ont le moins accès aux services de prévention, de soins et de traitement du VIH, car leur consommation de drogues est souvent stigmatisée et criminalisée.
Les outils et les stratégies requis pour améliorer la santé et la vie des consommateurs de drogues sont bien connus et facilement disponibles. Les programmes aiguilles-seringues diminuent la propagation du VIH, de l'hépatite C et d'autres virus véhiculés par le sang. Le traitement substitutif aux opiacés et d'autres formes de traitement de la dépendance aux drogues éclairées par des données probantes permettent de limiter la consommation de drogues, de réduire la vulnérabilité aux maladies infectieuses et d'améliorer le recours aux services sanitaires et sociaux.
L'impressionnant corpus de preuves de l'efficacité de la réduction des risques, notamment dans les prisons et d'autres structures fermées, forme la base d'un ensemble complet d'interventions recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) pour prévenir la propagation du VIH et réduire les autres risques associés à la consommation de drogues. Malgré tout, peu de pays ont atteint une couverture suffisante des services de réduction des risques.
Levons la main pour #préventionVIH
Related





Feature Story
Libérer la parole : pour que le préservatif ne soit plus tabou
05 octobre 2016
05 octobre 2016 05 octobre 2016« Je veux réussir dans le monde de l'entreprise », explique Millicent, 19 ans, que l'on appelle Milly. Major de sa promotion en commerce à l'Université du Botswana, elle respire la sophistication et la confiance en soi.
Pourtant, Milly ne s'est pas toujours sentie aussi sûre d'elle pour prendre les bonnes décisions. Elle n'a pas toujours eu le sentiment de pouvoir de se protéger des infections sexuellement transmissibles, notamment du VIH, ou d'une grossesse non désirée. Être vue comme une personne sexuellement active l'embarrassait et prendre des préservatifs gratuits au dispensaire gouvernemental la mettait mal à l'aise. Quant à Peter, son petit ami, il était gêné d'acheter des préservatifs à la pharmacie, de sorte qu'ils ne se protégeaient pas toujours lors de leurs rapports sexuels.
Milly explique que les gens ont tendance à associer usage du préservatif et promiscuité sexuelle. « Il existe un stéréotype sur les adolescents qui utilisent des préservatifs », raconte-t-elle. « On dit que les préservatifs sont faits pour les adultes. Les gens ne veulent pas en parler ». Au dispensaire, « impossible de simplement y aller et en prendre », explique-t-elle. « Vous êtes critiqué parce que vous êtes jeune et que vous voulez des préservatifs ».
Les parents de Milly ne lui ont donné que les informations les plus généralistes sur la prévention du VIH, alors que son père est médecin. Au Botswana, les normes culturelles empêchent les parents et les enfants de parler de sexe ouvertement ; on suppose que si les adolescents en savent trop sur les préservatifs, « ils voudront expérimenter », ajoute Milly. Peter et elle ont lu quelques informations sur les préservatifs, mais ils ne savaient pas vraiment comment les utiliser. « On savait qu'on prenait des risques », reconnaît-elle.
Milly et Peter sont de la même classe d'âge, les 15-24 ans, ceux qui sont le plus exposés au risque d'infection, et l'ONUSIDA indique que les femmes de cet âge sont deux fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les hommes du même âge. Kabo Ngombe, du Ministère de la Santé du Botswana, explique que la réticence à parler des préservatifs constitue l'une des raisons pour lesquelles davantage de jeunes ne les utilisent pas. « Beaucoup de gens sont informés sur le VIH et les moyens de prévention, mais ils ne changent pas de comportement », indique-t-elle. « Les jeunes n'ont pas de modèles. Leurs parents ne peuvent pas leur parler du VIH. Ils préfèrent s'informer auprès des autres jeunes ».
C'est ce qu'a fait Milly. Un jour, elle croise un camion aux couleurs vives roulant au pas dans la rue, avec le mot CONDOMIZE! peint sur les côtés et entouré d'une foule jeune et animée. Debout sur la plate-forme du camion, d'autres jeunes, tous vêtus d'élégants T-shirts noirs portant les mots « Love Smart! Play Safe! CONDOMIZE! » inscrits en lettres rose vif sur la poitrine. Leur tête est coiffée d'un casque rose brillant. De la musique rock résonne tandis qu'ils invitent chaleureusement les passants à les rejoindre pour en savoir plus sur les préservatifs.
« Il y avait un monde fou autour de ce camion ! », raconte Milly. « Je voulais savoir qui étaient ces gens et ce qu'ils faisaient dans notre communauté. En fait, il s'agissait de jeunes éducateurs venus pour nous apprendre comment utiliser les préservatifs. Des jeunes comme moi ! En tant qu'adolescente, je préfère qu'un autre adolescent me donne des informations, pas quelqu'un qui me critique. C'était vraiment génial ! ».
À l'heure actuelle, ce camion et un autre plus petit ont déjà parcouru près de 2 000 kilomètres dans tout le Botswana. Ils sont le fer de lance de la campagne nationale CONDOMIZE!, lancée en juin 2014 par le Fonds des Nations Unies pour la population et le Condom Project pour attirer l'attention sur les préservatifs d'une manière conviviale, accueillante et drôle qui puisse intéresser les jeunes comme Milly. Les jeunes présents sur le camion font partie des 35 bénévoles locaux formés pour éduquer leurs pairs sur les préservatifs. Le Botswana est l'un des six pays africains où se déroulent les campagnes CONDOMIZE! depuis 2011.
Le camion croisé par Milly se gare ensuite près d'un parc où une table recouverte de présentoirs de préservatifs aux couleurs vives a été dressée, et la foule continue de grossir. L'équipe de CONDOMIZE! passe dans les rangs avec des paniers pleins de préservatifs multicolores et des paquets de lubrifiants aqueux, incitant tout le monde à se servir. « C'était extraordinaire », s'enthousiasme Milly, « je ne savais pas qu'il existait des préservatifs de couleur ! ». Les préservatifs qu'elle a vus ce jour-là proposaient autant de variétés que de couleurs, des tailles et des textures diverses (nervurés, rehaussés de petits reliefs, etc.), différentes épaisseurs et des parfums attirants (banane, fraise, chocolat), le tout dans un emballage séduisant. À l'inverse, les préservatifs gratuits du gouvernement sont disponibles en une seule taille, forme et couleur : orange. Ils sont jugés moins bons car ils ne portent pas de marque et les gens disent qu'ils sentent mauvais et se déchirent facilement.
Par contre, les nouveaux préservatifs partent comme des petits pains. « J'en ai pris des tonnes », s'amuse Milly. « C'était tellement fun ! Tout le monde était très surpris, très impressionné et très content d'avoir une telle campagne venue pour les informer et leur distribuer des préservatifs gratuits ! ».
Aujourd'hui, Milly et Peter utilisent les préservatifs correctement et de manière systématique, y compris des préservatifs féminins, une nouveauté pour eux. Ils aiment bien la diversité des textures, des couleurs et des parfums, ainsi que les lubrifiants, dont ils ignoraient l'existence jusqu'ici. Depuis, Milly a croisé d'autres manifestations de CONDOMIZE! et elle est bien fournie en préservatifs.
Related

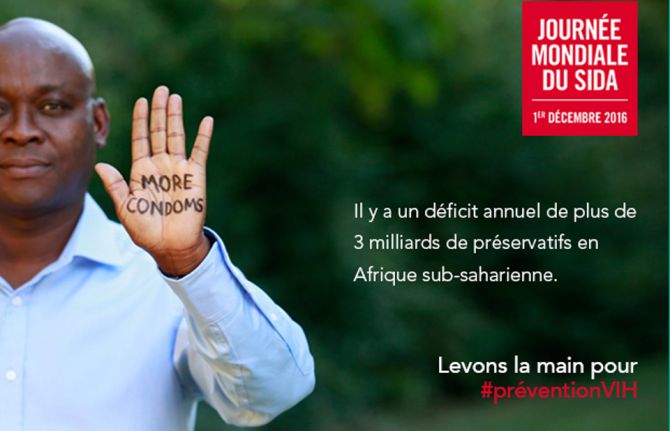
Mettre à jour
Préservatifs
03 octobre 2016
03 octobre 2016 03 octobre 2016Les préservatifs sont au cœur d'une approche de prévention combinée du VIH ; ce sont aussi des outils rentables de prévention des autres infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. On estime à 45 millions le nombre d'infections à VIH qui ont été évitées dans le monde grâce à l'usage du préservatif depuis 1990. Parvenir à l'objectif mondial pour 2020 concernant les préservatifs permettra d'éviter 3,4 millions de nouvelles infections. Le coût par infection évitée serait d'environ 450 dollars, une somme largement inférieure au coût d'un traitement antirétroviral fourni à vie.
LACUNES DANS LA PRÉVENTION
- Stagnation des fonds internationaux et nationaux consacrés à l'achat de préservatifs et aux programmes de distribution.
- Déficit annuel de plus de 3 milliards de préservatifs masculins en Afrique subsaharienne.
- Usage irrégulier du préservatif au sein de nombreuses populations et localités très démunies, avec des difficultés à négocier l'usage du préservatif pour les femmes.
- Mise à disposition insuffisante de lubrifiants et de préservatifs féminins.
CE QU'IL FAUT FAIRE
- Augmenter les ressources pour l'achat, la distribution et la promotion des préservatifs.
- Fournir des préservatifs masculins et féminins dans des packs de prévention combinée.
- Diversifier les produits autour du préservatif, notamment fourniture de préservatifs féminins avec les préservatifs masculins et les lubrifiants.
- Élaborer de nouvelles approches pour accroître l'usage du préservatif et améliorer la perception positive des préservatifs au sein des différentes populations dans le besoin.
- Impliquer les communautés dans la fourniture de préservatifs et utiliser des mécanismes de prestation de services innovants.
En 2015, on estimait à 1,9 million [1,7 million – 2,2 millions] le nombre d’adultes (plus de 15 ans) nouvellement infectés par le VIH, dont la grande majorité par voie sexuelle, et à 357 millions le nombre de personnes ayant contracté une chlamydiose, une gonorrhée, une syphilis ou une trichomonase. Chaque année, plus de 200 millions de femmes n’ont pas accès à la contraception alors qu’elles en auraient besoin, ce qui conduit à environ 80 millions de grossesses non désirées. Les préservatifs permettent de prévenir efficacement tous ces problèmes. De bons programmes de promotion du préservatif jouent un rôle essentiel dans les objectifs mondiaux ambitieux destinés à ouvrir l'accès à des services de prévention complets à 90 % des personnes exposées au risque d'infection à VIH et ramener les nouvelles infections à VIH à moins de 500 000 à l'échelle mondiale. Forts de ce constat, dans la Déclaration politique de 2016 sur le VIH et le sida, les pays se sont mis d’accord pour augmenter la disponibilité annuelle de préservatifs à 20 milliards d’ici à 2020. Ce chiffre inclut environ sept milliards de préservatifs pour l'Afrique subsaharienne chaque année et 30 à 50 préservatifs par homme et par an dans les pays à forte prévalence.
Related

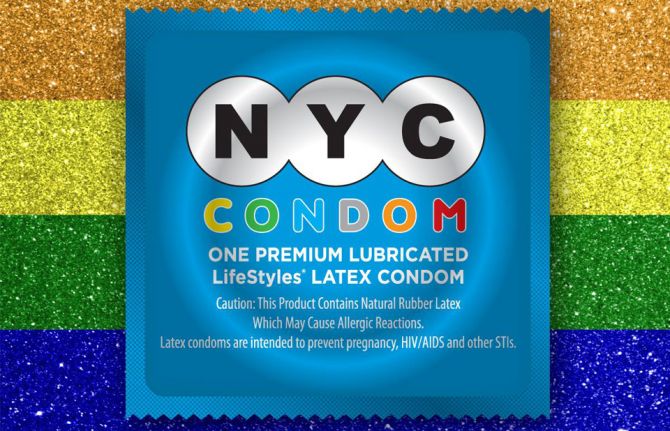
Feature Story
NYC Condom atteint les populations clés grâce à une distribution ciblée, des actions de promotion et une appli mobile
03 octobre 2016
03 octobre 2016 03 octobre 2016La ville de New York a été la première au monde à disposer de préservatifs portant sa propre marque et elle possède à l'heure actuelle le plus large programme de distribution gratuite de préservatifs de tous les États-Unis d'Amérique. Même dans cette ville cosmopolite à revenu élevé, la distribution gratuite de préservatifs joue un rôle essentiel dans la prévention du VIH, des autres infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées au sein des populations clés. La distribution gratuite de préservatifs s'inscrit dans une stratégie de prévention économique et rentable dans le cadre du Schéma directeur 2015 pour la fin de l'épidémie de sida dans l'État de New York d'ici à 2020.
Nombre de nouveaux cas de VIH diagnostiqués à New York City, 2001-2014
Source : New York City Health Department
Le programme de distribution gratuite de préservatifs de New York a démarré en 1971, avec des préservatifs gratuits distribués par l'intermédiaire des établissements de santé de la ville afin de lutter contre les infections sexuellement transmissibles. C'est en 2007 que les services de santé de la ville (Health Department) ont lancé le NYC Condom. Depuis, à l'occasion de chaque Journée nationale de sensibilisation au préservatif (le jour de la Saint-Valentin), l'aspect de l'emballage du NYC Condom est modifié ou un nouveau volet de marketing social est ajouté au programme.
Les services de santé de la ville fournissent gratuitement des préservatifs masculins, des préservatifs féminins et des lubrifiants à toutes les organisations ou entreprises new-yorkaises désireuses d'en distribuer. En 2011, les services de santé ont créé le NYC Condom Finder, une application pour téléphone mobile qui se sert du GPS pour aider les utilisateurs à trouver des points de distribution de préservatifs dans la ville ; cette application a été téléchargée par des dizaines de milliers de personnes.
Le New York City’s Condom Availability Program (NYCAP) a plus de 3 500 partenaires de distribution de préservatifs et, en 2014, ce sont plus de 37,1 millions de préservatifs masculins et près de 1,2 million de préservatifs féminins qui ont été distribués dans les cinq arrondissements de la ville. Ces partenaires ciblent la distribution dans les quartiers où les taux de VIH sont les plus élevés de la ville et dans les lieux de services aux personnes vivant avec le VIH et aux populations clés, comme les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
Le programme permet d'accroître la sensibilisation, la disponibilité et l'accessibilité des préservatifs pour les résidents de New York en maintenant une forte présence communautaire. En 2014, le NYCAP a participé à plus de 105 événements communautaires, organisé 825 présentations dans les établissements des services de santé municipaux qui traitent les infections sexuellement transmissibles, et pris part à tous les événements officiels et non officiels de la Gay Pride dans la ville, atteignant ainsi plus de 53 500 individus.
La sensibilisation et l'accès aux préservatifs NYC sont importants au sein des populations clés. Plus de 75 % des personnes interrogées lors des événements de la Gay Pride et de la parade de la Journée des Afro-Américains ont vu ou entendu parler des préservatifs NYC et en ont reçu.
Dans les établissements traitant les infections sexuellement transmissibles des services de santé de la ville, 86 % des personnes interrogées connaissent les préservatifs NYC et 76 % en ont déjà reçu. L'usage du préservatif est également répandu et concerne entre 69 et 81 % des personnes ayant reçu des préservatifs NYC.
Depuis le lancement du NYC Condom, plus de 300 millions de ces préservatifs ont été distribués. La tendance des nouveaux cas d'infections à VIH transmises par voie hétérosexuelle s'est inversée, avec une baisse de 52 % entre 2007 et 2014.
Related


Feature Story
Redonner de l’élan au préservatif comme moyen de prévention efficace et rentable contre le VIH
03 octobre 2016
03 octobre 2016 03 octobre 2016Le Rapport de l’ONUSIDA sur les lacunes en matière de prévention montre que les efforts de prévention du VIH doivent être relancés si le monde veut rester sur la bonne voie d’accélération pour en finir avec le sida d’ici à 2030. Pour atteindre l’objectif mondial d’une réduction accélérée du nombre de nouvelles infections à VIH à moins de 500 000 d’ici 2020, il faut davantage d’engagement politique et des investissements accrus dans la prévention du VIH, notamment la promotion de l’usage du préservatif.
En 2015, on estimait à 1,9 million [1,7 million – 2,2 millions] le nombre d’adultes de plus de 15 ans nouvellement infectés par le VIH, dont la grande majorité par voie sexuelle, et à 500 millions le nombre de personnes ayant contracté une chlamydiose, une gonorrhée, une syphilis ou une trichomonase. Chaque année, plus de 200 millions de femmes n’ont pas accès à la contraception alors qu’elles en auraient besoin, ce qui conduit à environ 80 millions de grossesses non désirées. Les préservatifs permettent de prévenir efficacement tous ces problèmes.
Les préservatifs masculins et féminins sont très efficaces et représentent l’outil de prévention le plus largement disponible, même dans les endroits à faibles ressources, pour les personnes exposées au risque d’infection à VIH, d’autres infections sexuellement transmissibles et de grossesse non désirée. Les préservatifs sont bon marché, rentables et faciles à stocker et à transporter, leur utilisation n’exige pas l’assistance de personnel médical ou d’agents de santé et toutes les personnes sexuellement actives peuvent s’en servir. Une analyse de modélisation mondiale récente a estimé que les préservatifs avaient permis d’éviter jusqu’à 45 millions de nouvelles infections à VIH depuis le début de l’épidémie de VIH. Pour de nombreux jeunes dans le monde, le préservatif reste la seule option réaliste pour se protéger.
La promotion de l’usage systématique du préservatif est une composante essentielle de la prévention combinée du VIH. L’usage du préservatif vient compléter toutes les autres méthodes de prévention du VIH, notamment la diminution du nombre de partenaires sexuels, la circoncision masculine médicalisée et volontaire, la prophylaxie préexposition (PPrE) et le traitement préventif pour les couples sérodifférents.
Malgré la hausse de l’usage du préservatif au cours des vingt dernières années, les études montrent que l’usage de préservatifs signalé lors de la dernière rencontre sexuelle d’une personne avec un partenaire non régulier va de 80 % dans certains pays à moins de 30 % dans d’autres. Il existe un besoin urgent que les pays renforcent l’offre et la demande en préservatifs et en lubrifiants aqueux. Dans la Déclaration politique de 2016 sur la fin du sida, les pays se sont mis d’accord pour augmenter la disponibilité annuelle de préservatifs à 20 millions d’ici à 2020 dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
De nombreux pays n’ont pas encore fixé d’objectifs ambitieux en matière de distribution et de taux d’usage de préservatifs et les programmes sont sous-dimensionnés, avec des lacunes dans la création de la demande et l’approvisionnement. Peu de programmes de promotion du préservatif abordent de manière adéquate les obstacles qui empêchent l’accès aux préservatifs et leur utilisation par les jeunes, en particulier les adolescentes et les jeunes femmes, les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les professionnel(le)s du sexe. Dans de nombreux pays, les préservatifs ne sont pas facilement accessibles pour les jeunes dans les écoles et ailleurs en dehors des établissements de santé. À certains endroits, les professionnel(le)s du sexe ont des rapports sexuels non protégés avec leurs clients, car le port de préservatifs est puni par la loi et utilisé par la police pour intimider les personnes ou prouver une implication dans le commerce du sexe. Certains programmes ne fournissent qu’un petit nombre de préservatifs à chaque professionnel(le) du sexe à chaque visite, alors que ces professionnel(le)s du sexe ont beaucoup plus de clients que de préservatifs. L’accès aux lubrifiants est également insuffisant : dans 165 pays, moins de 25 % des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont facilement accès à des lubrifiants gratuits, de même que de nombreux professionnel(le)s du sexe qui souhaitent y accéder mais ne le peuvent pas. La plupart des pays ne prévoient aucun approvisionnement en lubrifiants dans leurs plans et programmes stratégiques nationaux pour le préservatif.
Le financement international pour l’approvisionnement en préservatifs en Afrique subsaharienne a stagné ces dernières années, alors que le financement national n’a pas suffisamment augmenté. Les fonds consacrés à la distribution de préservatifs et à leur promotion ont même baissé. En 2015, on a estimé à plus de 3 milliards le déficit en préservatifs en Afrique subsaharienne, pour des besoins totaux s’élevant à 6 milliards.
Pour avoir un résultat positif, les programmes complets autour du préservatif doivent inclure des éléments tels que leadership et coordination, sécurité d’approvisionnement et du produit, demande, accès et promotion de l’utilisation, et soutien technique et logistique. Il est capital que les gouvernements créent un environnement propice pour les décideurs politiques et les prestataires de services, de façon à ce que les utilisateurs soient conscients des risques auxquels ils sont exposés, libres de demander et d’accéder aux préservatifs masculins et féminins, et qu’ils sachent comment les utiliser correctement et de manière systématique. Les jeunes et les populations clés représentent des alliés solides dans la promotion de l’accès aux préservatifs. Par exemple, lors de la dernière Conférence internationale sur le sida à Durban, en Afrique du Sud, les jeunes ont manifesté pour l’accès aux préservatifs et à d’autres services et produits de santé sexuelle et reproductive, comme les serviettes hygiéniques.
La promotion efficace du préservatif doit être adaptée aux personnes exposées à un risque accru de contracter le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles et/ou de grossesse non désirée, notamment les jeunes, les professionnel(le)s du sexe et leurs clients, les consommateurs de drogues injectables, les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. De nombreuses filles et jeunes femmes, en particulier celles qui sont engagées dans des relations durables et les professionnelles du sexe, n’ont ni le pouvoir ni les moyens de négocier l’usage de préservatifs, car les hommes se montrent souvent réticents. Des préservatifs devraient également être mis à disposition dans les prisons et autres structures fermées, ainsi que dans les situations de crise humanitaire.
Le recours aux réseaux sociaux, médias sociaux et nouvelles technologies pour promouvoir l’usage du préservatif et améliorer la sensibilisation doit également être élargi. La campagne CONDOMIZE! de l’UNFPA pour la déstigmatisation et la promotion de l’usage du préservatif est en cours de déploiement dans neuf pays, sous la houlette des gouvernements nationaux, avec deux déploiements nationaux prévus en plus pour 2016. Cette campagne fait participer activement les jeunes dans le rôle d’ambassadeurs, de blogueurs et de pairs-éducateurs. Aux États-Unis, la promotion du préservatif s’étend de plus en plus ; il est distribué gratuitement dans les écoles dans le cadre du traitement de problèmes tels que les grossesses adolescentes non désirées, les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Des villes comme New York et Washington, D.C. ont mis en place des distributions gratuites ciblées de préservatifs destinées aux populations clés et aux personnes les plus exposées au risque. En France, des distributeurs de préservatifs ont été mis en place dans les établissements scolaires et le Ministère de l’Éducation sud-africain est en train de revoir ses politiques afin de permettre la promotion et la distribution de préservatifs dans les écoles.
Au Zimbabwe, le gouvernement a soutenu des distributions de préservatifs à grande échelle par l'intermédiaire de canaux de marketing social et de distribution gratuite. 104 millions de préservatifs masculins ont été distribués au Zimbabwe en 2014, l'un des chiffres les plus élevés au monde. L'augmentation du taux d'usage du préservatif est citée comme l'une des raisons de la réduction de moitié du nombre de nouvelles infections à VIH entre 2009 et 2015. Le gouvernement sud-africain a financé un programme de distribution de préservatifs féminins à l'échelle nationale sur plus de 300 sites. Au Brésil, les responsables de la santé publique ont mis en œuvre l'une des plus grandes campagnes de distribution et de promotion du préservatif du monde. Malgré certaines réticences, le gouvernement brésilien a tenu bon dans son engagement sur la diffusion d'informations médicalement détaillées concernant les bénéfices de l'usage du préservatif.
Redonner de l’élan à la promotion du préservatif et atteindre 90 % d’utilisation du préservatif par les personnes exposées au risque qui ont des rapports sexuels avec des partenaires non réguliers permettrait d’éviter 3,4 millions de nouvelles infections à VIH en plus d’ici à 2020 et aurait un impact considérable sur la prévention d’autres infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées.
Related





Feature Story
Un guichet unique de la santé pour les routiers en Afrique du Sud
17 novembre 2016
17 novembre 2016 17 novembre 2016Mandie Pakkies frissonne dans son manteau noir trop fin en cette froide nuit d'hiver à Durban, dans un relais routier de la banlieue de Marianhill, situé sur l'une des principales routes de transport partant du port le plus actif d'Afrique. Le flux incessant de camions passant sur la grande route ne la dérange pas. Au contraire, elle est impatiente de les voir s'arrêter pour prendre du carburant et faire un brin de causette. Son travail consiste à encourager les chauffeurs routiers à prendre soin de leur santé, et lorsqu'ils s'arrêtent pour la nuit, elle les invite à entrer dans un dispensaire construit avec des conteneurs de fret tout au fond du parking.
« Les routiers ont des besoins très urgents en matière de santé ! C'est encourageant de les voir venir pour faire mesurer leur tension artérielle ou se faire dépister pour le VIH », explique Mme Pakkies. « Je leur apprends même les fondamentaux tels que « boire de l'eau » ou « marcher 20 minutes pour faire de l'exercice avant d'aller dormir sur le parking » ».
Le dispensaire ouvre ses portes en soirée afin de coïncider avec les arrêts nocturnes que font beaucoup de chauffeurs avant de charger leur véhicule au port à la première heure le lendemain. Mme Pakkies, pair-éducatrice, et Thuthuka Xulu, infirmier professionnel, travaillent ensemble pour accueillir les chauffeurs routiers et les professionnel(le)s du sexe des rues avoisinantes, qui viennent sur le parking pour rencontrer les routiers. « Nous ne délivrons pas seulement des services de santé de base, nous faisons aussi des tests de dépistage du VIH, de la tuberculose et des infections sexuellement transmissibles, et bien sûr nous distribuons beaucoup de préservatifs », explique M. Xulu.
Avec 2 000 camions qui passent chaque semaine à Marianhill et près de 500 camions qui stationnent ici chaque nuit, l'équipe ne chôme pas. Les chauffeurs routiers viennent de toute l'Afrique du Sud et des pays voisins. En raison de leurs horaires irréguliers et de leur mobilité, les chauffeurs routiers éprouvent des difficultés à accéder aux services de santé élémentaires. Pour répondre à ces besoins et à ceux des professionnel(le)s du sexe qui travaillent autour du relais, Truckers Wellness a mis en place un réseau de dispensaires le long des principaux axes de transport routier dans toute l'Afrique du Sud.
Le centre Trucking Wellness de Marianhill est l'un des 22 dispensaires de ce genre dans le pays, dans le cadre d'un réseau plus étendu de programmes à destination des routiers dans la région. Ce programme, lancé en 1999, est financé par l'industrie du transport et les transporteurs routiers et lié aux services du Ministère de la Santé. Ces cinq dernières années, ils ont testé plus de 10 000 personnes pour le dépistage du VIH, soit en moyenne une trentaine de tests par semaine.
« Nous voyons de plus en plus de gens qui viennent se faire dépister et demander nos services », ajoute M. Xulu, assis derrière un minuscule bureau recouvert par des dossiers, une boîte de gants chirurgicaux et des kits de dépistage du VIH.
La prochaine étape pour son dispensaire sera de pouvoir adopter les directives de l'Organisation mondiale de la Santé, afin que les patients puissent démarrer immédiatement le traitement antirétroviral si le résultat est positif. Il ajoute en souriant : « Cela va vraiment accroître l'importance de notre centre ».



