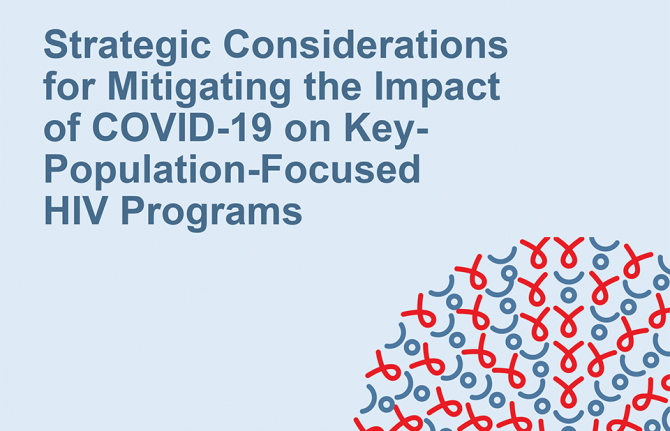Feature Story
Un projet de l'ONUDC fournit des services VIH transfrontaliers aux consommateurs de drogue afghans
16 avril 2010
16 avril 2010 16 avril 2010
Afin de garantir la réussite de la mise en oeuvre du projet et de renforcer les capacités du personnel des ONG et des fonctionnaires gouvernementaux, une formation de cinq jours sur le VIH a été organisée à Kaboul.
Photo: ONUDC
Une riposte au VIH qui se veut vraiment efficace doit fournir des services VIH complets aux consommateurs de drogues injectables (CDI). Conscient de ce facteur, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a apporté son soutien à la mise en oeuvre d'une initiative qui vise à rendre les services accessibles aux réfugiés afghans en Iran et au Pakistan qui consomment de la drogue par injection, ainsi qu'aux consommateurs afghans de drogue injectables qui sont rentrés au pays.
L'utilisation de matériel d'injection de drogues non stérile est un des modes les plus efficaces de transmission du VIH et demeure une des activités critiques qui alimente l'épidémie de VIH chez les consommateurs de drogue. Le VIH peut également se transmettre aux partenaires sexuels des consommateurs de drogues injectables ou à d'autres populations clés plus exposées au risque d'infection comme les professionnels du sexe.
Le projet poursuit la création d'un environnement qui prend en charge un réseau régional transfrontalier de services VIH afin que les réfugiés afghans puissent continuer à profiter de ces services une fois qu'ils seront rentrés au pays. L'ONUDC a octroyé deux bourses à des organisations non gouvernementales pour qu'elles fournissent des services aux consommateurs de drogues afghans dans la province d'Herat à la frontière avec l'Iran et dans la province de Nangarhar à la frontière avec le Pakistan.
L'Organisation Khatiz pour la réhabilitation dans la province d'Herat et l'Organisation pour la santé et le développement social à Nangarhar utilisent des unités de proximité mobiles pour offrir un large éventail de services. Parmi ceux-ci, citons la diffusion d'informations spécifiques et de matériel éducatif aux consommateurs de drogues, la distribution d'aiguilles et de seringues propres, la promotion de l'usage de préservatifs et la distribution de ceux-ci, le traitement et la prévention des infections sexuellement transmissibles et des soins primaires tels que des services de conseil et test volontaires et le traitement antirétroviral.
Formation au VIH et à la consommation de drogues
Afin de garantir la réussite de la mise en oeuvre du projet et de renforcer les capacités du personnel des ONG et des fonctionnaires gouvernementaux, une formation de cinq jours sur le VIH a été organisée à Kaboul. Elle a réunit des médecins, du personnel soignant, des travailleurs sociaux, des chefs de projet et des employés de la prison pour femmes.
La réunion, à laquelle participèrent également des délégations du gouvernement, des agences des Nations Unies et des ONG, a abordé la gravité de la situation en Afghanistan. Le Dr. Mohammad Zafar, ministre adjoint à la lutte contre les stupéfiants, a déclaré aux participants qu'une étude de l'ONUDC organisée en 2005 chiffrait à un million le nombre de consommateurs de drogues dans le pays, dont 19 000 à 25 000 consommateurs de drogues injectables, soit 3,8 % de la population totale.
Selon le Dr. Ajma Sabaoon, chargé du programme national de lutte contre le sida, l'Afghanistan est en train de passer d'une épidémie faible à une épidémie concentrée. Il a présenté aux participants les résultats d'une enquête biologique et comportementale intégrée réalisée par l'université John Hopkins en 2009 qui montre que la prévalence du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables dans trois grandes villes du pays (Kaboul, Herat et Mazar) est passée de 3 % en 2007 à 7 % en 2010.
Les CDI ont une connaissance très réduite du VIH. D'après l'étude, seuls 29 % des CDI étaient en mesure d'identifier correctement les méthodes de prévention de transmission sexuelle du VIH et rejetaient les grandes idées reçues sur la transmission du VIH. Environ 22 % des CDI ont passé un test de dépistage et connaissent leur statut sérologique.
Les consommateurs de drogues injectables sur lesquels l'étude a porté est une communauté mobile et près de 80 % d'entre eux ont signalé avoir changé de résidence au moins une fois. Une grande partie de cette mobilité s'explique par les différentes phases du conflit dans le pays et la majorité des CDI s'est déplacée vers le Pakistan ou vers l'Iran. L'ONUDC et ses partenaires espèrent que l'offre de services VIH aux consommateurs de drogues injectables dans ces zones frontalières permettra de faire reculer la prévalence du VIH parmi les CDI dans le pays ainsi que dans la zone sous-régionale.
La protection des consommateurs de drogues contre le VIH est un des neuf domaines d'action prioritaires du Cadre de résultats 2009-2011. Ceci est possible en rendant les interventions éclairées par les preuves et fondées sur les droits humains accessibles à tous les consommateurs de drogues (à savoir réduction des risques et réduction de la demande).
Un projet de l'ONUDC fournit des services VIH tra
Coparrainants:
Discours:
Read UNAIDS Executive Director's speech at the 53rd session of the Commission on Narcotic Drugs (10 mars 2010) (pdf, 40.3 kb.) (en anglais)
Reportages:
Appel en faveur d’une action urgente pour élargir la couverture des services de prise en charge du VIH destinés aux consommateurs de drogues injectables (8 mars 2010)
La Conférence internationale sur la réduction des risques s’ouvre à Bangkok (20 avril 2009)
OPINION : VIH et consommation de drogues : deux épidémies, une stratégie commune (20 avril 2009)
L’ONUDC et l’Iran signent des accords visant à réduire la vulnérabilité des femmes et des réfugiés afghans face aux drogues et au VIH (24 mars 2009)
Consommation de drogues injectables : entretien avec le Chef de l'équipe Prévention, soins et appui de l'ONUSIDA (11 mars 2009)
OPINION : Le silence sur la réduction des risques n'est pas acceptable (11 mars 2009)
Liens externes:
Related
 Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response
Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response

27 septembre 2023

Feature Story
HIV epidemic in Eastern Europe will be highlighted at Vienna AIDS conference
15 mars 2010
15 mars 2010 15 mars 2010A version of this story was first published at unodc.org

UNAIDS Executive Director Michel Sidibé at a press conference held March 10 to discuss AIDS 2010.
The rapidly growing AIDS epidemic in Eastern Europe, fuelled primarily by unsafe injecting drug use, will be a key focus of the XVIII International AIDS Conference (AIDS 2010), to be held in Vienna in July.
"To break the trajectory of the HIV epidemic in Eastern Europe, we must stop new infections among injecting drug users and their partners," said UNAIDS Executive Director Michel Sidibé at a press conference held March 10 to discuss AIDS 2010. "People using drugs have a right to access the best possible options for HIV prevention, care and treatment."
People using drugs have a right to access the best possible options for HIV prevention, care and treatment.
Michel Sidibé, Executive Director of UNAIDS
The United Nations, through the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and UNODC, is supporting the AIDS 2010 conference, to be held from 18 to 23 July 2010, which is organized by the International AIDS Society, a non-governmental organization.
Around 25,000 people working in the field of HIV, including policymakers, legislators, researchers, people living with HIV and others committed to working on AIDS issues will attend the conference, whose theme, Rights Here, Right Now, emphasizes the central importance of human rights in responding to HIV.
By holding the conference in Vienna, the organizers will highlight the situation in Eastern Europe and Central Asia, regions experiencing a fast growing epidemic largely through unsafe injecting drug use. An estimated 1.5 million people are living with HIV in these regions. Sharing needles and injection equipment is thought to be three times more likely to transmit HIV than sexual intercourse.
"We can and must reverse the HIV epidemic, first of all by preventing the spread of drug use, and then by providing treatment to addicts. In this comprehensive programme, HIV-targeted measures include providing clean injecting equipment, opioid substitution and antiretroviral therapy," said UNODC Executive Director Antonio Maria Costa.
Life on the edge
Yet, as the results published last week in The Lancet show, injecting drug users often have little or no access to evidence-informed comprehensive HIV services. Globally, only two needles and syringes are distributed to injecting drug users per month and only 8 per cent of injecting drug users receive opioid substitution therapy (Mathers et al, 2010).

UNODC Executive Director Antonio Maria Costa speaking at a press conference held March 10 to discuss AIDS 2010.
Many of today’s drug users live a life on the margins of society: they can be arrested, even for possessing a clean needle, and sent to prison, where the perfect environment is created for HIV and TB to spread. Or they can be confined to compulsory drug detention centres, often with no due legal process, where they are shackled and beaten in the name of drug “treatment” but with no access to any medically supervised remedies for drug dependency.
“We must focus our efforts to create evidence-based harm reduction measures that work, helping drug users protect their health and the health of the broader community—including preventing HIV infection,” said Mr Sidibé during his intervention at the 53rd session of the Commission on Narcotic Drugs. “Harm reduction is an effective and important form of HIV prevention and a key component of our pledge for universal access to HIV prevention, treatment, care and support”.
Effective harm reduction approaches include access to clean needles, opioid substitution therapy for opiate users, access to antiretroviral therapy and reducing sexual transmission of HIV from drug users to their sexual partners through condom promotion.
UN Secretary-General Ban Ki-moon has called on Member States to ensure that people who are struggling with drug addiction be given equal access to health and social services, and asserted, “No one should be stigmatized or discriminated against because of their dependence on drugs.”
UNODC is the lead agency within UNAIDS for HIV prevention, treatment, care and support for injecting drug users and in prison settings. It works in 55 priority countries in Africa, Eastern Europe and Central Asia, South and South-East Asia, Latin America and the Caribbean, helping countries to provide drug users, prisoners and people vulnerable to human trafficking with comprehensive evidence-informed HIV services.
HIV epidemic in Eastern Europe will be highlighte
Cosponsors:
Partners:
Press centre:
HIV/AIDS Epidemics in Eastern Europe under the Spotlight at Vienna AIDS Conference (10 March 2010)
Speeches:
Read UNAIDS Executive Director's speech at the 53rd session of the Commission on Narcotic Drugs (10 March 2010)
Feature stories:
Call for urgent action to improve coverage of HIV services for injecting drug users (10 March 2010)
International Harm Reduction conference opens in Bangkok (20 April 2009)
OPINION: HIV and drugs: two epidemics - one combined strategy (20 April 2009)
OPINION: Silence on harm reduction not an option (11 March 2009)
Injecting drug use and HIV: Interview with UNAIDS Team Leader, Prevention, Care and Support team (11 March 2009)
External links:
AIDS 2010
The Commission on Narcotic Drugs Fifty-third session
The Lancet: HIV prevention, treatment, and care services for people who inject drugs: a systematic review of global, regional, and national coverage
Related

Feature Story
Appel en faveur d’une action urgente pour élargir la couverture des services de prise en charge du VIH destinés aux consommateurs de drogues injectables
10 mars 2010
10 mars 2010 10 mars 2010 Un examen réalisé en 2009 par le Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et la consommation de drogues injectables conclut qu’à l’exception de quelques cas précis, la couverture mondiale de ces services parmi les populations de CDI est très faible et vraisemblablement insuffisante pour prévenir, stopper et inverser les épidémies de VIH. Photo: ONUSIDA/P.Virot
Un examen réalisé en 2009 par le Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et la consommation de drogues injectables conclut qu’à l’exception de quelques cas précis, la couverture mondiale de ces services parmi les populations de CDI est très faible et vraisemblablement insuffisante pour prévenir, stopper et inverser les épidémies de VIH. Photo: ONUSIDA/P.VirotUn examen réalisé en 2009 par le Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et la consommation de drogues injectables quantifie pour la première fois l’ampleur de la couverture des services de prévention, de traitement et de soins du VIH destinés aux consommateurs de drogues injectables (CDI) à travers le monde. L’étude conclut qu’à l’exception de quelques cas précis, la couverture mondiale de ces services parmi les populations de CDI est très faible et vraisemblablement insuffisante pour prévenir, stopper et inverser les épidémies de VIH.
Le document, publié par The Lancet dans son édition en ligne du 1er mars 2010, souligne également la nécessité d’améliorer la collecte de données relatives aux CDI dans chaque région afin d’obtenir une vision plus claire de l’étendue de leurs besoins. « Nous n’en savons toujours pas assez sur la nature et la taille des populations que nous devons cibler ».
Nous savons qu’une combinaison d’actions visant à réduire les risques liés à la consommation de drogues peut réduire à presque zéro le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les consommateurs de drogues.
M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA.
Au niveau des services, les manques sont déjà clairement visibles. Concernant la prévention, l’étude estime que deux aiguilles/seringues par mois ont été distribuées à chaque CDI. Dans les pays où l’on réalise une estimation du nombre de préservatifs distribués aux consommateurs de drogues injectables, on note qu’en moyenne 12 préservatifs par an ont été distribués à chaque CDI.
Ces moyennes mondiales masquent des variations encore plus importantes selon les régions et les pays au niveau de la fourniture des services.
Alors que presque tous les pays d’Europe occidentale et orientale, d’Asie centrale, d’Australasie et d’Amérique du Nord sont dotés de programmes d’échange de seringues/d’aiguilles, ces services ne sont pas présents dans neuf des 25 pays d’Asie de l’est, du sud-est et du sud où l’on recense des pratiques de consommation de drogues injectables. Ces programmes étaient également absents ou non déclarés dans 14 des 16 pays d’Afrique subsaharienne où l’on consomme des drogues injectables.
La couverture du traitement de substitution aux opiacés varie également de 1 % ou moins des CDI en Asie centrale, Amérique latine et Afrique subsaharienne, à des niveaux très élevés de 61 % en Europe occidentale.
Accès aux services pour tous les consommateurs de drogues
L’ONUSIDA considère que l’on peut prévenir les infections à VIH chez les consommateurs de drogues si des interventions complètes, éclairées par le concret et respectueuses des droits de l’homme leurs sont rendues accessibles à tous.
« Des stratégies efficaces de réduction des risques incluent un accès à des aiguilles/seringues propres, un traitement de substitution aux opiacés pour les consommateurs d’opiacés, un accès au traitement antirétroviral et une réduction de la transmission sexuelle du VIH des CDI à leurs partenaires sexuels par le biais de la promotion des préservatifs » a déclaré M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Mais la couverture actuelle de ces services est effroyablement basse ».
L’étude a été financée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Centre national australien de recherche sur les stupéfiants et l’alcool, l’Université de New South Wales et le Conseil national australien pour la santé et la recherche médicale.
Appel en faveur d’une action urgente pour élargir
Coparrainants:
UNODC (en anglais)
%Centre de presse:
HIV/AIDS Epidemics in Eastern Europe under the Spotlight at Vienna AIDS Conference (10 mars 2010) (en anglais)
Discours:
Lire le discours du Directeur executive de l'ONUSIDA à l'occasion de la Cinquante-troisième session de la Commission des stupéfiants (10 mars 2010)
Reportages:
OPINION : VIH et consommation de drogues : deux épidémies, une stratégie commune (20 avril 2009)
OPINION : Le silence sur la réduction des risques n'est pas acceptable (11 mars 2009)
Consommation de drogues injectables : entretien avec le Chef de l'équipe Prévention, soins et appui de l'ONUSIDA (11 mars 2009)
Liens externes:
Cinquante-troisième session de la Commission des stupéfiants
The Lancet : Services de prévention, de traitement et de soins du VIH destinés aux personnes qui consomment des drogues injectables : examen systématique de la couverture mondiale, régionale et nationale (en anglais)
Publications:
Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA 2009-2011 (pdf, 488 Kb.).
Related
 Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response
Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response

27 septembre 2023

Feature Story
Les projecteurs sur la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
27 janvier 2010
27 janvier 2010 27 janvier 2010
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, exhorte les pays à respecter l’équité et les droits humains dans leur approche de l’épidémie de VIH
Photo: ONUSIDA
Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l’épidémie de VIH, pourtant rarement mise en lumière, s’accroît régulièrement. En 2008, on estimait à 310 000 le nombre des personnes vivant avec le VIH, contre 200 000 en 2001. Cette même année, environ 35 000 personnes ont été nouvellement infectées par le VIH dans la région.
Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, M. Michel Sidibé, est sur place pour attirer l’attention sur certains problèmes clés qui doivent être abordés pour fournir une riposte efficace au sida, exhortant les pays à respecter l’équité et les droits humains dans leur approche de l’épidémie de VIH.
Utilisons la solidarité de la riposte mondiale au sida pour nous rapprocher davantage, telle une unité familiale mondiale, pour mettre fin à la souffrance et stimuler l’accomplissement humain.
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA
La stigmatisation et la discrimination restent des obstacles importants pour l’efficacité de la riposte régionale au sida, et dans nombre de pays la pénalisation des comportements à plus haut risque pousse les communautés affectées dans la clandestinité – limitant ainsi l’accès aux services de prévention, de traitement, de soins et d’appui en matière de VIH.
Etant donné que les populations plus exposées au risque sont affectées de manière disproportionnée même dans les contextes où la prévalence globale du VIH est faible, pour le bien de la santé publique il est nécessaire de faire preuve d’acceptation. « Comprendre est un impératif pour tirer de l’ombre celles et ceux qui sont les plus à risque et leur permettre de se protéger et, par extension, de protéger la communauté tout entière, » a déclaré M. Sidibé.
Le travail de l’ONUSIDA dans la région

Photo: ONUSIDA/P.Virot
L’ONUSIDA collabore étroitement avec les partenaires gouvernementaux et de la société civile dans la région pour plaider en faveur de la suppression des lois et politiques punitives auxquelles se heurte une riposte efficace.
Au Yémen, le 29 août 2009, le Parlement a voté une loi pour protéger les droits des personnes vivant avec le VIH qui visait à réduire la discrimination. Cet article 51 de la loi représente une étape majeure pour protéger les droits des individus vivant avec le VIH dans le pays.
En Egypte, un programme de proximité pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes a été lancé, et en quelques mois le projet a fourni des services à des centaines de personnes, dans un environnement extrêmement difficile. Ce programme est mis en œuvre par l’ONUSIDA en partenariat avec plusieurs ONG et avec le soutien financier de l’USAID et de la Fondation Ford.
Une autre initiative positive a été la première conférence régionale sur la réduction des risques organisée l’an passé au Liban. Cette conférence a représenté une percée pour la région et a rassemblé plusieurs experts et partenaires et mobilisé l’appui politique des parlementaires, des gouvernements nationaux et des organismes des Nations Unies.
La fourniture de services pour les populations clés est également en expansion dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, avec l’inclusion de la thérapie de substitution orale dans les programmes à l’intention des consommateurs de drogues injectables au Maroc et au Liban. En République islamique d’Iran, une assurance médicale est fournie aux personnes vivant avec le VIH et à leur famille, les cotisations étant entièrement à la charge du gouvernement. Ces réussites sont significatives et montrent combien il est nécessaire d’investir en faveur de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH dans la région.
Mettre l’accent sur les droits humains lors d’une conférence au Qatar
Alors qu’il se trouve dans la région, M. Sidibé a assisté au Colloque sur la responsabilisation de la famille dans le monde moderne qui se tient à Doha, au Qatar. Organisé par la Famille royale du Qatar et la Fondation du Qatar à Doha, le colloque rassemble des spécialistes pour aborder des problèmes tels que les tendances et les difficultés touchant la famille, la famille et les droits, et les familles à travers le monde.
Les familles constituent la première ligne de défense contre la stigmatisation et l’isolement ainsi que la principale source de soins.
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA
« Les familles constituent la première ligne de défense contre la stigmatisation et l’isolement ainsi que la principale source de soins, » a déclaré M. Sidibé dans son discours d’ouverture. Le responsable de l’ONUSIDA a également souligné les récentes conclusions d’un projet de recherche sur deux ans, l’Initiative conjointe de recherche sur les enfants et le VIH/sida. Selon le rapport, les familles supportent environ 90% du coût financier des soins aux enfants infectés et affectés.
La liberté de mouvement pour les personnes vivant avec le VIH représente également une préoccupation majeure, car elle touche de manière disproportionnée les travailleurs migrants et leur famille. Le Qatar – comme plusieurs autres pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord – impose des restrictions à l’entrée, au séjour et à la résidence sur la base de la sérologie VIH. Ces restrictions sont largement considérées comme discriminatoires et ne présentent aucun avantage sur le plan de la santé publique.
« Utilisons la solidarité de la riposte mondiale au sida pour nous rapprocher davantage, telle une unité familiale mondiale, pour mettre fin à la souffrance et stimuler l’accomplissement humain, » a déclaré M. Sidibé en conclusion de son discours.
Les défis à venir
A ce jour, une pénurie de données épidémiologiques et comportementales actualisées et fiables a empêché de bien comprendre la dynamique et les tendances de l’épidémie de VIH dans la région. Bien que la prévalence du VIH reste faible, les populations plus exposées au risque sont souvent durement touchées ; les épidémies dans les pays de la région sont généralement concentrées parmi les consommateurs de drogues injectables, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe et leurs clients.
Deux larges schémas de transmission ont été identifiés. Premièrement, de nombreuses personnes contractent le VIH alors qu’elles vivent à l’étranger, exposant ainsi leurs partenaires sexuel(le)s à l’infection à leur retour dans leur pays d’origine. Deuxièmement, la transmission du VIH survient au sein de populations plus exposées au risque, telles que les consommateurs de drogues injectables ou les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et peut aussi avoir pour résultat la transmission courante aux partenaires de sexe féminin.
Le point sur l’épidémie de sida 2009 publié par l’ONUSIDA suggère des activités de prévention intensifiées à l’intention des partenaires féminines des hommes qui sont exposés au VIH lorsqu’ils travaillent à l’étranger, qu’ils consomment des drogues, ou qu’ils ont des rapports sexuels avec des hommes ou avec des professionnel(le)s du sexe.
Les projecteurs sur la région du Moyen-Orient et
Discours:
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA: "Families on the Front Line of AIDS" (pdf, 77.6 Kb.) (en anglais)
Reportages:
Reportages sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
Informations sur les ripostes au sida au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (4 février 2009)
La Journée mondiale sida marquée à la Conférence de Doha (1 décembre 2008)
Liens externes:
Qatar Foundation (en anglais)
The Joint Learning Initiative on Children and HIV/AIDS (en anglais)
Publications:

Feature Story
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime s’attaque au VIH dans les prisons
08 décembre 2009
08 décembre 2009 08 décembre 2009
Dans la plupart des pays du monde, la prévalence du VIH est plus élevée parmi la population carcérale qu’au sein de la population générale. Cela est imputable à un certain nombre de facteurs tels que le manque relatif de connaissances des personnes incarcérées concernant le VIH, l’absence d’accès à des mesures de protection, un environnement souvent violent, un surpeuplement carcéral et des services de santé inadaptés.
Pour aider à lutter contre cette situation en Afrique, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a lancé, en partenariat avec l’OMS, la Banque mondiale et l’ONUSIDA, le Réseau de partenariat sur le VIH dans les prisons en Afrique (AHPPN).
L’initiative a été annoncée lors de la consultation des pays d’Afrique orientale et australe qui a eu lieu les 17 et 18 novembre 2009. Cette consultation a réuni des représentants des autorités carcérales, de la société civile, des conseils nationaux de lutte contre le sida, d’établissements de santé, de recherche et universitaires, ainsi que de différents organismes des Nations Unies de 16 pays d’Afrique.
Réagir à la situation dans les prisons n’est pas seulement essentiel pour les personnes incarcérées mais aussi pour la société dans son ensemble. Lorsqu’ils sont libérés et retournent dans leur communauté, les prisonniers qui ont été infectés par le VIH pendant leur incarcération sont alors susceptibles d’avoir – en dehors des prisons – des comportements induisant des risques élevés.
Malgré ces problèmes, les stratégies visant à lutter contre le VIH dans les prisons sont souvent isolées et mal intégrées dans les plans et programmes nationaux de riposte au sida.
Le Réseau de partenariat sur le VIH dans les prisons d’Afrique soutiendra des efforts visant à mettre en place des ripostes au VIH efficaces et respectueuses des droits de l’homme dans les prisons d’Afrique. Le réseau espère aussi faciliter le partage des connaissances et la création d’alliances entre différents partenaires afin d’encourager une approche cohérente, large et globale.Nous avons besoin d’informations plus complètes concernant la situation du VIH dans les prisons à travers l’Afrique… Ces informations doivent servir à éclairer l’élaboration de services complets et basés sur le concret de prévention, de soins, de traitement et d’appui en rapport avec le VIH pour les hommes, les femmes et les jeunes incarcérés ainsi que les anciens détenus, sans discrimination
Mme Elizabeth Mataka, Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le sida en Afrique
Se faisant l’avocate de ce besoin de coordination, Mme Elizabeth Mataka, Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le sida en Afrique et oratrice principale lors du lancement du réseau, a indiqué : « Nous ne pouvons pas travailler de manière isolée… nous avons besoin de tout le monde, depuis les responsables gouvernementaux, les conseils nationaux de lutte contre le sida et les organismes chargés de l’application des lois, jusqu’aux organisations de la société civile, aux personnes incarcérées et aux anciens détenus, pour atteindre réellement les objectifs d’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui pour ce sous-groupe spécifique de population, mais aussi au profit de la société considérée dans son ensemble ».
Le réseau s’assurera aussi que les manques actuels de connaissances sur la vraie nature et l’ampleur de l’épidémie de VIH dans les milieux carcéraux soient comblés et que la riposte soit basée sur des données valables et du concret.
Mme Mataka a ajouté : « Nous avons besoin d’informations plus complètes concernant la situation du VIH dans les prisons à travers l’Afrique… Ces informations doivent servir à éclairer l’élaboration de services complets et basés sur le concret de prévention, de soins, de traitement et d’appui en rapport avec le VIH pour les hommes, les femmes et les jeunes incarcérés ainsi que les anciens détenus, sans discrimination. Il va sans dire que ces services doivent présenter une qualité et des normes identiques à ceux destinés aux non prisonniers et inclure des liens avec la communauté au sens large ».
La mission du Réseau de partenariat sur le VIH dans les prisons en Afrique est large et sera non seulement axée sur le VIH mais aussi sur la tuberculose, la santé mentale, la consommation de drogues et le surpeuplement des prisons. En outre, le réseau fournira à ses pays membres un accès à l’appui technique.
Une déclaration d’engagement à lutter contre le sida dans les prisons au niveau régional a été adoptée lors de la consultation. Tenant compte du contexte économique et socioculturel de l’Afrique, la déclaration servira de document cadre pour encourager une lutte efficace contre le VIH dans les prisons de la région.
Le Réseau, qui sera soutenu financièrement par l’Equipe suédoise/norvégienne de lutte contre le VIH/sida en Afrique, a créé un site Internet pour partager les idées et les expériences via le forum le plus large possible. On peut accéder à ce site à l’adresse www.ahppn.com.
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le
Coparrainants:
ONUDC (en anglais)
ONUDC et VIH (en anglais)
Reportages:
L’ONUDC et les autorités brésiliennes lancent des actions contre le sida en milieu carcéral (22 avril 2009)
ICASA 2008 : le VIH dans les lieux de détention (6 décembre 2008)
Contact:
Kevin Town
ONUDC Afrique australe
Tél: +27-12-342-2424
E-mail: kevin.town@unodc.org
Publications:
Le VIH et les prisons en Afrique subsaharienne (pdf, 2.12 Mb.) (en anglais)
Related

Feature Story
La Journée mondiale sida célébrée par le Bureau de l’ONUSIDA à Washington
30 novembre 2009
30 novembre 2009 30 novembre 2009En collaboration avec 26 organisations de la société civile, le Programme des Nations pour le Développement (PNUD), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), et la Banque mondiale, l’ONUSIDA accueille un déjeuner le 1er décembre, qui couronne une série de forums politiques sur le VIH, les droits humains et les populations clés à risque.
Au cours de ces derniers mois, l’ONUSIDA a reçu des dirigeants venus du monde entier à Washington, DC, pour débattre des questions de droits humains en matière de lutte contre le VIH dans trois populations clés à risque : le 16 septembre, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; le 15 octobre, les professionnel(le)s du sexe ; et le 12 novembre, les personnes qui s’injectent des drogues. Un représentant de chacun de ces groupes abordera les droits humains et l’accès universel. Des représentants de la société civile feront part de leurs recommandations au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le Représentant des Etats-Unis, Jim McDermott (Etat de Washington), prononcera une allocution spéciale.
Related
 AIDS care in the Californian desert
AIDS care in the Californian desert
12 février 2019
 UNAIDS is awarded the Science and Medicine Award at the 25th Annual Steve Chase Awards
UNAIDS is awarded the Science and Medicine Award at the 25th Annual Steve Chase Awards

12 février 2019
 Call for a broader vision for harm reduction
Call for a broader vision for harm reduction

09 novembre 2018

Feature Story
Plaidoyer en faveur de services liés à la coinfection VIH/hépatite C pour les consommateurs de drogues injectables en Inde
15 septembre 2009
15 septembre 2009 15 septembre 2009Une version de ce reportage a d'abord été publiée sur www.unodc.org

Loon Gangte, militant contre le sida, sensibilise à la coinfection VIH/hépatite C
Loon Gangte préside le Réseau des personnes séropositives de Delhi et plaide activement pour la prévention du VIH et de l'hépatite C. Dans un entretien accordé au Bureau régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l'Asie du sud-est, il explique pourquoi la coinfection VIH/hépatite C, en particulier chez les consommateurs de drogues injectables, constitue un problème exigeant une intervention urgente. Il commence par donner son opinion sur la stigmatisation et la discrimination.
ONUDC: Les consommateurs de drogues injectables (CDI) vivant avec le VIH sont victimes de stigmatisation et de discrimination. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de parler de sa séropositivité, comme vous ?
LG: Les consommateurs de drogues injectables séropositifs sont victimes d’une double stigmatisation. Ils sont marginalisés et victimes de discrimination parce qu'ils consomment des drogues et qu'ils sont séropositifs. Il est donc souvent très difficile pour ces consommateurs séropositifs de se sentir bien dans leur peau. Cela faisait 15 ans que je consommais des drogues lorsque j'ai découvert ma séropositivité en 1998. Pendant quatre ans, je n’ai pas pu le dire à ma famille car j'avais peur de leur réaction.
C'est comme porter une chaussure trop petite qui fait tout le temps mal sans que personne ne sache que vous souffrez.
Loon Gangte, Président du Réseau des personnes séropositives de Delhi
Cela a été difficile à annoncer mais, avec l'aide du jeune pasteur de l'église de Churachandpur, j’y suis arrivé. Ils ont été choqués mais pas surpris.
Je pense qu'il est très important de parler de sa séropositivité car cela vous permet de rechercher le bon type de traitement médical le plus tôt possible. Ensuite, cela encourage d'autres personnes à parler de leur propre séropositivité et à demander de l'aide. Si vous ne révélez pas votre séropositivité, c’est vous qui souffrez. C'est comme porter une chaussure trop petite qui fait tout le temps mal sans que personne ne sache que vous souffrez. Dites-vous qu'aujourd'hui, si personne ne parlait de sa séropositivité, il n'y aurait ni prévention ni programme de traitement.
ONUDC: Avez-vous été personnellement victime de stigmatisation et de discrimination ? Que fait le Réseau pour lutter contre ce problème ?
LG: Les personnes avec lesquelles je vis et je travaille à New Delhi depuis 12 ans m’ont soutenu tout en connaissant ma séropositivité. Cependant, il y a quelques années, alors que je faisais patiemment la queue pour prendre des médicaments contre le VIH dans un hôpital de New Delhi et qu’il me restait plus d’une heure à attendre avant de parvenir au petit guichet et de transmettre mon ordonnance, voici ce qui m'est arrivé. À cette époque-là, si vous viviez avec le VIH, votre ordonnance portait un tampon disant « séropositif » comme une marque au fer rouge. Voyant cela, l'infirmière m’a ordonné de refaire la queue. Tandis que je m’exécutais, je ne comprenais pas pourquoi j'avais été victime de discrimination. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris que ma séropositivité l'avait poussée à me mettre à part et à me traiter différemment. Je n'ai pas compris cela tout de suite parce que, pour moi, la séropositivité n’entraîne pas la perte de mes droits. Je suis comme tout un chacun, si vous me coupez, je saignerai, j'ai des aspirations, et les organes de mon corps fonctionnent comme ceux de tout autre. La présence d'un petit virus ne permet à personne de me priver de mes droits fondamentaux.
Comme l'hépatite C et le VIH ont des voies de transmission similaires (en particulier le partage de seringues), la coinfection est fréquente chez les consommateurs de drogues injectables.
Loon Gangte, Président du Réseau des personnes séropositives de Delhi
Le Réseau des personnes séropositives de Delhi plaide pour le traitement et la réduction de la stigmatisation et de la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH. Lorsque l'un de ses membres est victime de discrimination, quelle qu’elle soit, le Réseau, avec l'aide du collectif des juristes, intervient et s’attaque immédiatement au problème, que ce soit sur le lieu de travail, à l'hôpital, à l’école ou au sein de la famille. Le Réseau compte des orateurs séropositifs qui présentent des cas de stigmatisation et de discrimination lors de conférences, ateliers, réunions scolaires, formations et discussions. Cela permet d'attirer l'attention sur les problèmes que rencontrent les personnes séropositives. Pour lutter contre l'autostigmatisation, le Réseau a mis en place un groupe d'entraide offrant aux personnes vivant avec le VIH des lieux sûrs pour se rencontrer, échanger et mettre en commun leur expérience. Au bout d'un certain temps, les membres des groupes d'appui deviennent des membres actifs du Réseau et défendent les droits des séropositifs.
ONUDC: Vous vivez aussi avec l'hépatite C. Décrivez-nous votre expérience en matière d'accès au traitement.
LG: Vivre avec le VIH et l'hépatite C s'appelle vivre avec une coinfection. Elle a été diagnostiquée chez moi il y a deux ans. J'ai de la chance car je reçois une aide financière par le biais de la Coalition internationale de la préparation au traitement pour un dépistage périodique de l'hépatite C. Je ne suis actuellement pas de traitement. L'infection à l'hépatite C se répand rapidement parmi les consommateurs de drogues injectables du fait de son fort caractère infectieux (près de 10 fois supérieur à celui du VIH, et, contrairement au VIH, elle peut se transmettre non seulement en partageant des seringues et des aiguilles, mais aussi d'autres matériels tels que l'eau, le coton, etc.). Comme l'hépatite C et le VIH ont des voies de transmission similaires (en particulier le partage de seringues), la coinfection est fréquente chez les consommateurs de drogues injectables. Elle entraîne d’autres complications, accélère la progression de l'hépatite C et rend le traitement du VIH plus difficile.
En même temps, souvent, aucun symptôme de l’hépatite C ne se manifeste et la grande majorité des CDI ignorent leur maladie car ils ne bénéficient pas de services et sont étrangers au système de soins de santé. Par conséquent, pour que l'accès universel existe vraiment, il faut fournir un traitement adapté à la coinfection VIH/hépatite C.
ONUDC: Pourquoi est-ce si important de plaider pour le traitement de l'hépatite C en Inde ?
LG: D’après une étude, 92 % des consommateurs de drogues injectables sont infectés par l'hépatite C en Inde . Les taux de coinfection VIH/hépatite C sont élevés, en particulier dans le nord-est du pays. L’État de Manipur est le plus touché . Il n'existe actuellement aucune surveillance officielle, nationale, ou par État, de l'hépatite C en Inde. J'ai moi-même noté que beaucoup de personnes infectées par le VIH étaient aussi atteintes par l'hépatite C. Malgré une prévalence considérable, le diagnostic, le traitement et la prise en charge de l'hépatite C sont largement inaccessibles ici.
La plus grande difficulté est de sensibiliser les consommateurs de drogues injectables et les professionnels de santé à l'infection VIH/hépatite C. Le dépistage de l'hépatite C est coûteux et s'élève à entre 1200 et 2100 dollars américains en Inde. Le dépistage de l'hépatite C peut faire partie d'un dépistage anonyme du VIH qui est fourni dans les centres intégrés de conseil et de dépistage.
Les médicaments utilisés dans le traitement de l'hépatite C, l'interféron pégylé et la ribavirine, coûtent cher. Pour un traitement de six mois, il faut compter entre 4000 et 5000 dollars E.-U.; soit le salaire de certains Indiens pendant toute une vie. Contrairement au VIH, pour lequel la thérapie antirétrovirale de première ligne est gratuite, il n'existe aucun appui ni subvention de la part du gouvernement pour le traitement de l'hépatite C. Au Manipur, où la coinfection VIH/hépatite C est importante, les patients décèdent de complications hépatiques, malgré les traitements et le suivi des thérapies antirétrovirales.
Le Guide technique pour aider les pays à fixer des objectifs de l’OMS, de l’ONUSIDA et de l’ONUDC inclue le traitement pour les hépatites B et C dans les services aux consommateurs de drogue. Comme toujours, la prévention est essentielle pour arrêter la transmission. Les systèmes de santé nationaux et publics doivent être soutenus pour empêcher la transmission sanguine et fournir des traitements pour l'hépatite C, quel qu’en soit le coût, et si possible gratuitement. De nombreuses personnes atteintes d'hépatite C ne peuvent payer ni le dépistage ni le traitement. Le prix des médicaments contre l'hépatite C doit être fortement réduit.
L’ONUDC travaille en Inde sur la prévention, la prise en charge et le traitement du VIH pour les consommateurs de drogues injectables et les détenus. L'ONUDC travaille avec ses homologues gouvernementaux, les organisations non gouvernementales, les réseaux de consommateurs de drogues, et les personnes vivant avec le VIH, et plaide pour la fourniture de services complets.
1 Aceijas C.Rhodes T Global estimates of HCV among Injecting Drug Users. Int Journal of Drug Policy 2007,18(5),352-358
2 Sarkar K, Bal B, Mukherjee R, Chakarabortys, Bhattacharya SK, Epidemic of HIV coupled with HCV Injecting drug users in west Bengal, Eastern India bordering Nepal, Bhutan and Bangladesh, Substance Use Misuse 2006, 41(3);341-52
Plaidoyer en faveur de services liés à la coinfec
Coparrainants:
ONUDC (en anglais)
Reportages:
Les consommateurs de drogues injectables jouent un rôle central dans un film contre la stigmatisation (10 août 2009)
La Conférence internationale sur la réduction des risques s’ouvre à Bangkok (20 avril 2009)
OPINION : VIH et consommation de drogues : deux épidémies, une stratégie commune (20 April 2009)
L’ONUDC et l’Iran signent des accords visant à réduire la vulnérabilité des femmes et des réfugiés afghans face aux drogues et au VIH (24 mars 2009)
Consommation de drogues injectables : entretien avec le Chef de l'équipe Prévention, soins et appui de l'ONUSIDA (11 mars 2009)
OPINION : Le silence sur la réduction des risques n'est pas acceptable (11 mars 2009)
Publications:
OMS, ONUDC, ONUSIDA, Guide technique pour aider les pays à fixer des objectifs en vue de l’accès universel des consommateurs de drogues injectables à la prévention, au traitement et à la prise en charge du VIH (2009) (pdf, 570.7 Kb.) (en anglais)
Related
 Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style
Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

13 décembre 2022
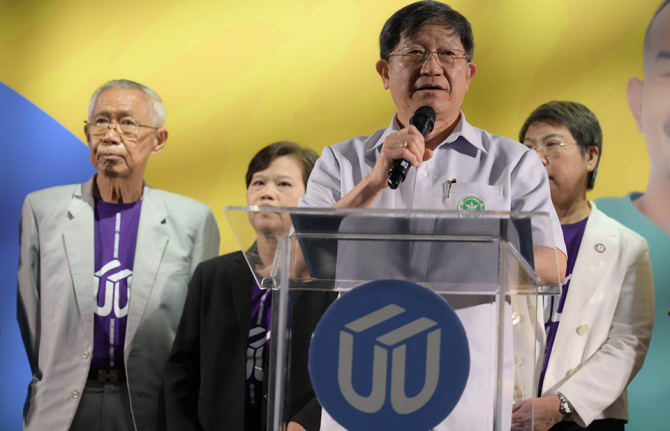 Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U
Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U
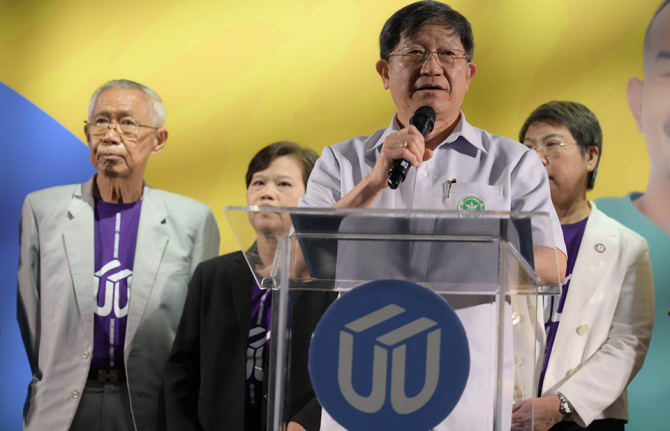
12 décembre 2022

Feature Story
Les Coparrainants de l’ONUSIDA arrivent en force pour le 9ème ICAAP
09 août 2009
09 août 2009 09 août 2009
Les 10 Coparrainants de l’ONUSIDA démontrent une forte présence alors que des milliers de délégués convergent vers Bali, Indonésie, pour partager idées, connaissances, meilleures pratiques, enseignements tirés et résultats de recherches dans le cadre du 9ème Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique (ICAAP).
Les Coparrainants font partie intégrante de la riposte des Nations Unies à l’épidémie mondiale de sida, et l’ONUSIDA rassemble leurs efforts et leurs ressources.
Faisant écho au thème du Congrès, ‘Responsabiliser les individus – renforcer les réseaux’, les Coparrainants organisent et présentent des symposiums, des ateliers de développement des compétences et des réunions satellites qui réunissent nombre de participants issus de tout un éventail de disciplines, dans le but d’aider à établir et à maintenir des partenariats pour soutenir la riposte au sida dans la région.
Plusieurs événements sont des initiatives conjointes des Coparrainants. Par exemple, le symposium sur la ‘prévention du VIH et les jeunes les plus à risque’, qui se tient le 10 août, est parrainé par l’UNFPA, l’UNICEF, l’UNESCO, le PNUD, l’OMS et l’ONUSIDA. Le symposium, organisé par le Groupe de coordination des Nations Unies pour la région de l’Asie et du Pacifique sur les jeunes les plus exposés au risque d’infection, se penche sur les besoins spécifiques à cette population qui n’est, en général, pas atteinte par les services de prévention du VIH. Cela comprend les consommateurs de drogues injectables, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et les professionnel(le)s du sexe et leurs clients. Des représentants de ces groupes participeront également à la discussion en panel – un nouvel exemple de la manière dont les activités des Coparrainants au Congrès entendent impliquer les populations clés.
Parmi d’autres exemples des activités des Coparrainants, on citera notamment la collaboration du PNUD, de l’OIT et de l’ONUSIDA (avec l’Initiative conjointe des Nations Unies sur la mobilité et le VIH/sida en Asie du Sud-Est) à l’occasion d’un symposium qui se tiendra le 12 août, intitulé ‘L’impact de la crise financière sur la migration de la main-d’œuvre et le VIH’, où ils apporteront leur expertise respective concernant cette question pressante au niveau international. Le HCR, avec l’ONUSIDA, organise une session satellite le 12 août, qui s’intitule ‘Opportunités et défis de la lutte contre le VIH parmi diverses populations humanitaires’. Le PAM utilisera une session satellite, le 11 août, pour étudier le rôle vital de la nutrition et de la sécurité alimentaire pour les personnes vivant avec le VIH et, en compagnie de ses partenaires, réfléchira aux ‘Modèles destinés à intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire dans les soins, le soutien et l’appui en matière de VIH dans la Région de l’Asie : Opportunités et défis’.
La Banque mondiale fait également la promotion, le 10 août, du film Suee (Aiguille) par la lauréate du festival du film de Cannes, Sai Paranjpye, qui traite de la vie des consommateurs de drogues injectables et de la stigmatisation liée au sida à laquelle ils sont confrontés. Le film est issu d’une compétition organisée par le Development Marketplace pour la région de l’Asie du Sud, un programme de subvention dirigé par la Banque et appuyé par une gamme de partenaires dont l’ONUSIDA, l’UNICEF, l’ONUDC et le PNUD.
Une multitude d’autres activités menées par les Coparrainants se tiennent au cours des cinq jours du Congrès, et plusieurs de ces événements seront décrits sur le site web de l’ONUSIDA au fur et à mesure de la progression des travaux de l’ICAAP.
L’ONUSIDA et ses 10 Coparrainants s’emploient à apporter un soutien technique aux pays pour les aider à mettre en œuvre leurs plans nationaux de lutte contre le sida. Une ‘répartition des tâches’ oriente l’appui technique fourni pour améliorer la coordination, éviter les chevauchements et dispenser la meilleure assistance disponible. Chacun des organismes coparrainants est chef de file dans au moins un domaine technique. Ces organisations sont les suivantes :
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
Organisation internationale du Travail (OIT)
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)
Les Coparrainants de l’ONUSIDA arrivent en force
Coparrainants:
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
Organisation internationale du Travail (OIT)
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Reportages:
Réunion du Comité des Organismes coparrainants de l’ONUSIDA (6 avril 2009)
Liens externes:
Le 9ème Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique (en anglais)
Related

Feature Story
L'ONUDC et les autorités brésiliennes lancent des actions contre le sida en milieu carcéral
22 avril 2009
22 avril 2009 22 avril 2009Une version de ce reportage a également été publiée sur le site UNODC.org

La première consultation nationale sur le VIH en milieu carcéral s'est tenue à Brasília du 31 mars au 2 avril 2009.
Credit: UNODC
Beaucoup reste à faire pour améliorer les services de prévention, de traitement et de prise en charge du sida dans les prisons brésiliennes. Ceci est la principale conclusion de la première consultation nationale sur le VIH en milieu carcéral, qui s'est tenue à Brasília du 31 mars au 2 avril.
Organisée par le Ministère de la Santé et le Ministère de la Justice du Brésil, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), cette consultation avait pour objectif de proposer, à l'issue des discussions, un agenda contenant un plan d'action visant à assurer dans les prisons des services de prévention, de traitement, de prise en charge et d'appui portant sur le VIH, d'autres infections sexuellement transmissibles et certaines coinfections comme la tuberculose et l'hépatite B.
« L'ONUDC s'engage à soutenir le Gouvernement brésilien dans la prestation de services de prévention et de prise en charge du VIH auprès de la population carcérale », a déclaré Giovanni Quaglia, représentant de l'ONUDC pour le Brésil et le Cône sud.
La consultation nationale a réuni environ 150 professionnels. Parmi ceux-ci figuraient des spécialistes des principaux ministères, des représentants des 26 états du Brésil et du district fédéral (où se trouve la capitale), des professionnels de santé travaillant en milieu pénitentiaire, des membres du réseau national de réduction des risques, des représentants de la branche brésilienne de la Commission des soins pastoraux catholiques en prison et des membres du Réseau national des personnes vivant avec le VIH.
L'ONUDC s'engage à soutenir le Gouvernement brésilien dans la prestation de services de prévention et de prise en charge du VIH auprès de la population carcérale.
Giovanni Quaglia, représentant de l'ONUDC pour le Brésil et le Cône sud
Au Brésil comme dans la plupart des pays, la prévalence du VIH est plus élevée dans la population carcérale que dans l'ensemble de la population. Les recherches les plus récentes indiquent qu'une étude locale publiée en 2007 fait état de prévalences de 5,7% dans certaines populations carcérales. Ces chiffres contrastent avec les chiffres de l'ONUSIDA concernant la population adulte totale, qui indiquaient une prévalence de 0,6% à la fin de l'année 2007.
On estime que le pays compte environ 420 000 détenus vivant souvent dans un environnement violent, dans lequel la surpopulation, l'absence de services médicaux et l'insalubrité peuvent engendrer une plus grande vulnérabilité vis-à-vis du VIH et d'autres agents infectieux, comme ceux de la tuberculose ou des hépatites. Ces conditions peuvent également accroître la mortalité due au sida et saper les tentatives de mise en oeuvre d'une riposte efficace à l'épidémie dans les prisons.
Liliana Pittaluga, Conseillère technique de l'unité de prévention du programme national sur les IST et le sida, a déclaré que cette consultation était un symbole de la solidité du partenariat entre le Gouvernement brésilien et l'ONUDC. « La coopération intersectorielle est essentielle pour améliorer les services de prévention et de prise en charge disponibles en milieu carcéral. Nous sommes convaincus que cette consultation aboutira non seulement à un échange d'expériences, mais également à la mise en place d'un plan d'action aux effets positifs sur le système pénitentiaire national. »
Le principal résultat de la consultation a été la décision prise par le Ministère de la Santé, le Ministère de la Justice et l'ONUDC de former un groupe de travail, qui aura pour mission de concevoir un plan opérationnel précisant directives, objectifs et délais d'exécution. Des organisations de la société civile, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l'ONUSIDA feront d'ailleurs partie de ce groupe.
En plus des représentants de l'ONUDC, de l'ONUSIDA, de l'OPS et de l'Organisation mondiale de la Santé, des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ont également participé à la réunion. Des experts dans les domaines de la santé et de la justice, venus de la région du Cône sud, ont également assisté à la réunion en tant qu'observateurs, sur l'invitation de l'ONUDC.
Right Hand Content
Coparrainants:
Reportages:
ICASA 2008 : le VIH dans les lieux de détention (06 décembre 2008)
Publications:
Le VIH et les prisons en Afrique subsaharienne : actions possibles (pdf, 2.12 Mb) (en anglais)

Feature Story
Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA, 2009 – 2011
22 avril 2009
22 avril 2009 22 avril 2009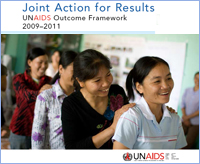
Au cours des 10 dernières années, le paysage des organisations œuvrant dans le domaine du VIH a évolué et s’est complexifié. L’ONUSIDA, les donateurs et la société civile, notamment les réseaux de personnes vivant avec le VIH, exigent, avec raison, que les liens entre les besoins, le financement, les activités et les résultats soient davantage clarifiés. En outre, une plus grande précision est instamment demandée concernant le rôle de l’ONUSIDA et du Secrétariat au sein de la pléiade d’acteurs concernés.
Ce Cadre de résultats, qui s’appuie sur le Cadre stratégique de l’ONUSIDA (2007 – 2011), orientera les investissements à venir et attribuera au Secrétariat et aux Coparrainants la responsabilité de faire travailler les ressources des Nations Unies en vue de résultats dans les pays. Il explique que le Secrétariat et les Coparrainants de l’ONUSIDA doivent tirer parti de nos ressources et mandats respectifs pour travailler de concert afin de produire des résultats.
Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA, 2009 – 2011 (pdf, 388 Kb)
Une action conjointe en vue de résultats : Cadre
Coparrainants:
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
Organisation internationale du Travail (OIT)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Banque mondiale
Publications:
http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2010/jc1713_joint_action_fr.pdf (pdf, 388 Kb)