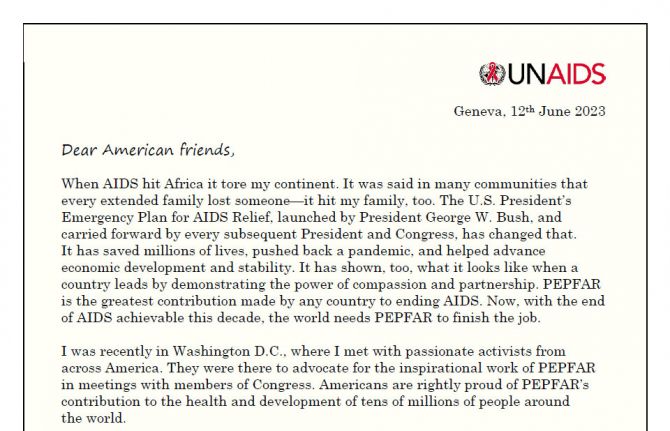Feature Story
La Chine se penche sur l’incidence du VIH parmi les HSH
16 janvier 2009
16 janvier 2009 16 janvier 2009 En 2008, la Chine a annoncé un vaste programme visant à s’attaquer à la forte hausse des taux de VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)
En 2008, la Chine a annoncé un vaste programme visant à s’attaquer à la forte hausse des taux de VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)Photo: UNAIDS
En 2008, la Chine a annoncé un vaste programme visant à s’attaquer à la forte hausse des taux de VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), un signe de plus idiquant que le pays pourrait bien être en train de commencer à faire face à une crise qui a longtemps paru taboue.
Annonçant la campagne auprès des HSH, le ministère de la santé a déclaré que les comportements sexuels à risque étaient le plus important facteur derrière la propagation du VIH en Chine continentale, à l’exception de Hong Kong, et que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes étaient à présent le groupe de la population le plus exposé au risque d’infection par le virus. En Chine, environ 700 000 personnes vivent aujourd’hui avec le VIH, et 11,1% d’entre elles sont des HSH.
« Par le passé, entre 1% et 3% des HSH sur le continent étaient positifs au VIH. Aujourd’hui ce pourcentage se situe entre 2,5 et 6,5% », déclare Hao Yang, Directeur adjoint du bureau de lutte contre les maladies au sein du ministère, cité par le quotidien China Daily.
La campagne annoncée implique des mesures de prévention ciblées sur les quelque 5 à 10 millions de HSH, comprenant une promotion plus énergique du recours au préservatif, un accroissement de la couverture et de la qualité des activités de prévention du VIH, un accès accru aux services de conseil et de test volontaires, et une amélioration de l’accès au traitement des infections sexuellement transmissibles.
Comme point de départ de sa nouvelle campagne à grande échelle pour réduire l’incidence du VIH parmi les HSH, la Chine a pour objectif de pratiquer un dépistage du VIH parmi 21 000 HSH, afin d’établir une base statistique plus claire du taux d’infection. C’est la plus vaste étude de ce type entreprise dans le monde et la première du genre en Asie.
L’effort de prévention de la Chine impliquera des organisations communautaires de HSH et la société civile à tous les niveaux. Les organisations communautaires effectuent des campagnes de sensibilisation au sida, orientent les gens vers le CTV, s’occupent d’éducation par les pairs, de promotion de la sexualité à moindre risque et de distribution de préservatifs ; elles mettent en place des hotlines et utilisent des forums de discussion en ligne et des sites Internet.
L’ONUSIDA considère qu’un des principaux éléments de la riposte au sida consiste à donner aux HSH et aux autres groupes marginalisés les moyens de se protéger du VIH.
« Le gouvernement chinois a fait de la prévention du VIH parmi les HSH une priorité et l’ONUSIDA s’en réjouit », dit Bernhard Schwartlander, Coordonnateur de l’ONUSIDA en Chine.

Dans la plupart des pays d’Asie les HSH restent un sujet de gêne : dans nombre de ces pays, les rapports sexuels entre hommes sont illégaux et les témoignages de harcèlement fréquents.
Photo: UNAIDS
Cependant, malgré les progrès réalisés, plusieurs problèmes subsistent, dont la stigmatisation et la discrimination qui sont encore bien trop répandues dans la population générale et jusque dans la communauté des HSH elle-même.
On estime qu’à fin 2007, 8% seulement des HSH avaient bénéficié d’interventions complètes de prévention du VIH. De plus, selon les estimations du ministère de la santé, plus de la moitié des HSH chinois ont plus d’un partenaire sexuel, mais entre 10 et 20% seulement d’entre eux utilisent des préservatifs.
« Il est d’une importance capitale que le gouvernement et les nombreux groupes de travail sur les HSH trouvent les moyens d’améliorer leur capacité à travailler ensemble au sein de partenariats ouverts et non-discriminatoires », explique Schwartlander.
Une épidémie largement ignorée
Cette évolution de la situation en Chine survient en parallèle avec d’autres signes indiquant que certains gouvernements de la région Asie-Pacifique semblent également plus disposés à reconnaître une épidémie jusque-là largement ignorée.
Dans la plupart des pays d’Asie les HSH restent un sujet de gêne : dans nombre de ces pays, les rapports sexuels entre hommes sont illégaux et les témoignages de harcèlement fréquents. En conséquence, peu de choses ont été faites en termes de soutien spécifique à des programmes à l’intention des HSH.
« On suscite beaucoup d’intérêt, mais il faut faire bien davantage », estime Paul Causey, un consultant basé à Bangkok qui s’occupe des questions relatives aux HSH au sein de la Coalition Asie-Pacifique sur la santé sexuelle masculine (APCOM) et des Nations Unies.
La plupart des hommes asiatiques qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes ne parlent pas ouvertement de leur comportement sexuel. Les tabous sociaux et la discrimination poussent nombre d’entre eux à dissimuler leur orientation sexuelle. Pour de nombreux autres, leurs pratiques sexuelles avec d’autres hommes peuvent ne constituer qu’une petite partie de leur rôle social ou de leur vie sexuelle. Etant donné que de nombreux hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes ont également des rapports sexuels avec des femmes, les taux élevés de VIH parmi les HSH peuvent aussi se traduire en un nombre important de femmes exposées à un risque d’exposition au VIH.
La combinaison d’un nombre élevé de partenaires ayant un comportement à haut risque tel que le rapport sexuel anal non protégé a été le facteur principal de l’augmentation de plus en plus rapide du taux d’infection au VIH dans de nombreuses villes d’Asie.
Pratiquement aucun des pays asiatiques ne consacre suffisamment de ressources aux HSH, même si la prévention coûte bien moins cher que le traitement. Par exemple, un dollar investi dans une prévention efficace permet d’économiser jusqu’à huit dollars en dépenses de traitement dans les pays dont l’épidémie est en expansion.

La plupart des hommes asiatiques qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes ne parlent pas ouvertement de leur comportement sexuel. Les tabous sociaux et la discrimination poussent nombre d’entre eux à dissimuler leur orientation sexuelle.
Photo: UNAIDS
Impliquer les groupes communautaires
Le moment clé dans la prise de conscience de la dimension de la crise des HSH s’est produit avec la convocation d’une conférence spéciale à New Delhi en septembre 2006 intitulée « Risques et responsabilités : santé sexuelle masculine et VIH en Asie et dans le Pacifique ».
La conférence était véritablement tripartite, réunissant des gouvernements, des donateurs ainsi que 380 membres de groupes communautaires. Les semaines précédant l’événement ont été tout aussi importantes, 16 pays ayant organisé des réunions préparatoires parrainées par l’ONUSIDA. Dans certains cas, y compris celui de la Chine, c’était pratiquement la première fois que des représentants officiels du gouvernement et des représentants de la communauté élargie des HSH se rencontraient pour évaluer la situation et envisager des solutions.
Une des autres réalisations durables de cette conférence a été la décision de lancer APCOM, qui regroupe des groupes de la société civile, des représentants du secteur gouvernemental, des donateurs, des experts techniques et les Nations Unies afin de promouvoir une riposte efficace face à l’incidence grandissante du VIH parmi les HSH.
Les efforts d’APCOM viennent compléter ceux d’un groupe de travail technique des Nations Unies sur les HSH et le VIH/sida lancé au milieu de 2006 en Chine. Le groupe est dirigé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
« Le groupe de travail technique collabore avec le gouvernement, les groupes communautaires de HSH et les donateurs afin d’améliorer la coordination et la communication, de renforcer les capacités du gouvernement à interagir avec les organisations de la société civile pour élaborer les politiques et fournir des services publics, et développer les capacités institutionnelles et professionnelles de ces organisations », précise Edmund Settle, responsable VIH auprès du PNUD en Chine.
Right Hand Content
Reportages:
L’homophobie fait obstacle à la prévention du VIH (13 janvier 2009)
ICASA 2008 : Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et VIH en Afrique (7 décembre 2008)
Les HSH et l’épidémie mondiale de VIH (31 juillet 2008)
Renforcer le travail avec les HSH en Afrique (23 mai 2008)
Initiative mondiale pour interrompre la propagation du VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (24 juillet 2007)
Centre de presse:
L’ONUSIDA et une large coalition travaillent pour faire libérer neuf hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes au Sénégal qui ont été déclarés coupables et emprisonnés (15 janvier 2009)
La criminalisation des comportements sexuels et de la transmission du VIH entrave les ripostes au sida(27 novembre 2008)
Publications:
Prévention générale du VIH - Principales directives opérationnelles de l’ONUSIDA
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, VIH prevention et soin (pdf, 638 Kb) (en anglais)
Related

Feature Story
Le PEPFAR dépasse ses objectifs de fourniture de traitements et de soins du VIH
13 janvier 2009
13 janvier 2009 13 janvier 2009
D’après le rapport annuel 2009 du Plan présidentiel d’urgence d’aide à la lutte contre le sida des Etats-Unis, le PEPFAR a dépassé ses objectifs à cinq ans de fourniture de traitements à deux millions de personnes et de soins à dix millions de personnes.
Le PEPFAR a soutenu la fourniture de traitements qui sauvent la vie à plus de 2,1 millions d’hommes, de femmes et d’enfants à travers le monde. Il a aussi participé à la fourniture de soins à plus de 10,1 millions de personnes affectées par le VIH, dont plus de 4 millions d’orphelins et d’enfants vulnérables.
Le 12 janvier, la Secrétaire d’Etat, Mme Condoleezza Rice, a prononcé le discours d’ouverture lors de la présentation du Rapport annuel 2009 du Plan présidentiel d’urgence d’aide à la lutte contre le sida des Etats-Unis (PEPFAR) au Congrès. Le rapport décrit les grandes lignes des succès considérables enregistrés par le PEPFAR dans la riposte au sida et souligne les réalisations des programmes engagés en partenariat avec des pays bénéficiaires à travers le monde.
En 2003, M. George W. Bush, Président des Etats-Unis, a lancé le Plan présidentiel d’urgence d’aide à la lutte contre le sida des Etats-Unis (PEPFAR) pour s’attaquer à l’épidémie mondiale de VIH. Ce plan représentait le plus important engagement jamais pris par un pays pour combattre une seule maladie. Par le biais du PEPFAR, le gouvernement des Etats-Unis a apporté $ 18,8 milliards pour financer la riposte au VIH et le Congrès américain a adopté un budget pouvant aller jusqu’à $ 48 milliards pour financer des activités de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sur les cinq prochaines années.
Pendant l’exercice 2008, le PEPFAR a fourni $ 1,6 milliard pour appuyer des programmes de traitement du VIH, dans les pays ciblés par ce projet, et environ $ 712 millions pour souvenir des activités de prévention.
S’adressant à la presse, M. l’Ambassadeur Mark Dybul, Coordonnateur pour les Etats-Unis de la lutte mondiale contre le sida, a souligné que le renforcement des systèmes de santé constituait un autre succès du PEPFAR. « Les données disponibles donnent à penser que les interventions contre le VIH/sida renforcent en réalité les soins dans d’autres domaines et ont un effet d’entraînement ».
Right Hand Content
Reportages:
Un vote du Sénat reconduit le programme mondial d’aide à la lutte contre le sida du gouvernement (PEPFAR) (17 juillet 2008)
link
Centre de presse:
L’ONUSIDA se réjouit du vote du Sénat américain en faveur de la reconduction de son programme mondial d’aide à la lutte contre le sida (16 juillet 2008) (en anglais)
Déclaration sur le vote en faveur de la reconduction du PEPFAR par l’ensemble de la Chambre des Représentants des Etats-Unis (03 avril 2008) (en anglais)
L’ONUSIDA se réjouit de l’appel en faveur d’une augmentation à $ 30 milliards de l’aide à la riposte au sida (30 mai 2007) (en anglais)
Liens externes:
Plan présidentiel d’urgence d’aide à la lutte contre le sida des Etats-Unis (PEPFAR) (en anglais)
Related

Feature Story
L’homophobie fait obstacle à la prévention du VIH
13 janvier 2009
13 janvier 2009 13 janvier 2009
Aside from the individual pain homophobic attitudes inflict, the continuing stigma attached to same-sex relations is complicating hugely the task of slowing the spread of HIV. Credit: L. Tanabe, National SDT/AIDS Programme, Brazil
Le Grupo Gay da Bahia (GBB), plus ancienne association brésilienne de défense des droits des gays, indique qu’au Brésil, une personne meurt des suites de violences liées à sa sexualité tous les deux ou trois jours. Au Mexique, le chiffre déclaré est de près de deux décès par semaine.
Les victimes sont pour la plupart des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – qu’ils soient homosexuels ou bisexuels – ou des transgenres.
Mais si le Brésil et le Mexique sont les pays d’Amérique latine dans lesquels la violence à l’encontre des HSH apparaît la plus élevée, c’est peut-être parce que les groupes de défense des droits qui existent dans ces pays surveillent cette situation de plus près que partout ailleurs dans la région. De nombreux actes de violence sont tout bonnement passés sous silence ailleurs, selon les organisations de militants homosexuels.
« Le Brésil et le Mexique sont les seuls pays dans lesquels il existe un dispositif officiel de recensement des meurtres. Cela ne signifie pas nécessairement que la violence y est plus importante qu’ailleurs » déclare Arturo Díaz Betancourt du Conseil national mexicain pour la prévention de la discrimination.
On remarquera que lorsque le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires a été en mission officielle au Guatemala en 2006, son attention a été attirée par une série de meurtres d’homosexuels et de transgenres, et que son rapport ultérieur au Conseil des droits de l’homme indiquait « Des meurtres motivés par la haine à l’égard de personnes s’identifiant comme des homosexuels, des lesbiennes, des transgenres et des transsexuels sont restés impunis. Des informations de sources fiables suggèrent qu’il y a eu au moins 35 meurtres de ce type entre 1996 et 2006. Compte tenu de l’absence de statistiques officielles et de la réticence probable, sinon de l’ignorance, des membres des familles des victimes, il y a des raisons de penser que les chiffres réels sont substantiellement plus élevés ».
Lorsque l’on aborde la question de la défense de la liberté et de l’orientation sexuelle, de nombreux pays d’Amérique latine s’enorgueillissent d’avoir des législations avancées sur le plan social. Avec les réformes législatives engagées au Nicaragua et au Panama au cours des 12 derniers mois, il n’existe désormais plus aucun état d’Amérique latine qui criminalise les rapports homosexuels.
Pourtant, les préjugés et la discrimination continuent de se propager malgré les lois, ce qui est peut-être dû à un « machisme ambiant persistant ». L’Amérique latine est largement considérée comme ayant un long chemin à parcourir pour lutter efficacement contre l’homophobie ou « la peur ou la haine des homosexuels ».
« Il existe un vrai contraste entre la théorie et la réalité. C’est la région en développement du monde dans laquelle il y a le plus grand nombre de lois contre la discrimination basée sur l’orientation sexuelle » déclare le Dr Ruben Mayorga, Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le pays pour l’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.
Outre les blessures personnelles infligées par les attitudes homophobes, la stigmatisation permanente associée aux relations entre personnes de même sexe complique considérablement les efforts de ceux qui cherchent à ralentir la propagation du VIH dans une région dans laquelle les rapports sexuels entre hommes sont le principal mode de transmission du virus, selon les rapports des experts de santé.
La stigmatisation et l’homophobie renforcent l’isolement des homosexuels, des bisexuels et des transgenres, et ceux-ci hésitent plus, de ce fait, à sortir de l’ombre, à être identifiés et à demander des conseils.
Dans l’un de ses rapports, l’Organisation panaméricaine de la Santé affirmait : « L’homophobie représente une menace pour la santé publique en Amérique latine. Cette forme de stigmatisation et de discrimination basée sur l’orientation sexuelle n’affecte pas seulement la santé mentale et physique de la communauté homosexuelle, mais contribue également à la propagation de l’épidémie de VIH ».
Cela fait longtemps que l’ONUSIDA fait campagne contre la discrimination tant à l’égard des personnes infectées par le VIH qu’à l’égard des personnes au motif de leur orientation sexuelle.

Stigma and homophobia increase the isolation of gays, bisexuals and transgender people making them more reluctant to come forward, be identified and get advice. Credit: L. Tanabe, National SDT/AIDS Programme, Brazil
En Amérique latine, l’urgence est soulignée dans les rapports officiels sur la situation de l’épidémie de VIH en Colombie, en Equateur, en Bolivie et au Pérou où les rapports sexuels entre hommes sont reconnus comme étant le principal facteur à l’origine des nouvelles infections. La prévalence du VIH parmi ce groupe est beaucoup plus élevée que dans la population générale, avec des taux situés entre 10 % et 20 % dans de nombreuses grandes villes d’Amérique latine.
Dans son rapport 2008 pour l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) sur la situation de l’épidémie de VIH, le Brésil a déclaré que les HSH avaient 11 fois plus de risques d’être séropositifs au VIH que la population considérée dans son ensemble.
Dans certaines régions d’Amérique centrale, où la résistance politique et sociale à la reconnaissance des droits des homosexuels, des lesbiennes et des transgenres est importante, les taux d’incidence du VIH parmi les HSH sont particulièrement élevés.
Et l’impact de ces taux élevés de VIH s’étend au-delà des seuls HSH. Au Pérou, par exemple, la plupart des femmes qui sont contaminées le sont par des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, selon une étude du ministère de la Santé, d’où il résulte que la prévention parmi les HSH est essentielle pour prévenir efficacement la transmission du VIH chez les femmes.
La prévention ne suit pas
Les dépenses engagées pour la prévention du VIH parmi les HSH en Amérique latine est très inférieure à ce qui est nécessaire compte tenu de l’ampleur de l’impact de l’épidémie au sein de ce groupe de personnes. En moyenne, moins de 10 % des fonds alloués à la prévention sont investis dans des campagnes ciblant spécifiquement les HSH, selon l’ONUSIDA.
En Bolivie, on estimait en 2005 que moins de 3 % des HSH avaient accès à des services de prévention, contre 30 % pour les professionnel(le)s du sexe.
« Toutes ces années, la prévention n’a pas été réalisée au bon endroit, c’est-à-dire là où l’épidémie se développe » a déclaré M. Díaz. « Personne n’a travaillé avec les homosexuels, les trans(genres), bien au contraire. Ils ont été rejetés et la cible de discriminations » a-t-il ajouté, évoquant la situation à travers la région.
L’explication tient à un ensemble de facteurs politiques, culturels et même religieux, indiquent les militants des droits de l’homme et les responsables de santé.
« Politiquement, les HSH ne représentent pas un sujet d’intérêt majeur. Dans la plupart des pays et pour beaucoup d’institutions, il n’y a pas d’avantage politique à en parler » indique M. Mayorga.
Les groupes religieux, qu’ils soient catholiques romains ou évangéliques, qui considèrent les relations sexuelles entre personnes du même sexe comme « un péché », se sont souvent vigoureusement opposés aux tentatives visant à accorder une attention spécifique aux HSH.
« Les gouvernements sont très influencés par les structures religieuses qui se mobilisent contre les politiques qui bénéficient aux homosexuels, bisexuels ou transsexuels » déclare Orlando Montoya qui travaille en Equateur avec l’ASICAL, organisation qui s’occupe de promouvoir la santé de gays, des autres HSH et des lesbiennes en Amérique latine.
Toutefois, il est difficile de généraliser. Certaines églises ont été les toutes premières à intervenir sur le terrain pour les HSH et de nombreuses organisations religieuses locales d’Amérique latine ont réagi face au VIH avec tolérance et compassion, y compris parmi les populations les plus marginalisées.
Problème largement ignoré au niveau international
Le problème n’est pas simplement que les gouvernements des pays n’accordent pas l’attention requise aux HSH. L’Amérique latine n’a pas attiré de financements internationaux pour endiguer l’épidémie de VIH dans les mêmes proportions que d’autres régions du monde – à savoir l’Asie et l’Afrique.
« La région a, dans une certaine mesure, été victime des trois « négations » qui n’ont pas favorisé un financement international de sa lutte contre le VIH » indique M. Mayorga. « La région ‘n’est pas’ très peuplée, elle ‘n’est pas’ très pauvre et l’épidémie ‘n’y est pas’ très importante » a-t-il ajouté.
Les règles régissant l’aide du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, principal bras financier international contre ces maladies, ont joué contre la région car elles ont tendance à exclure les pays à revenu intermédiaire et élevé, tels que l’Argentine et le Chili.
Toutefois, le Fonds a récemment accepté d’étudier des projets d’assistance pour des programmes ciblant des pays plus riches confrontés à des épidémies concentrées avec des taux de prévalence du VIH supérieurs à 5 % dans des groupes fortement exposés au risque d’infection, tels que les HSH, les consommateurs de drogues, les transgenres et les professionnel(le)s du sexe.
Renforcer le ciblage
Malgré ces marques persistantes de désintérêt, on note certains signes positifs dans la région qui permettent de penser que l’épidémie qui touche les HSH sera combattue à l’avenir par des mesures et des politiques plus appropriées.
Au cours des quatre ou cinq dernières années, le Brésil et le Mexique, et dans une moindre mesure l’Argentine et la Colombie, ont mené des campagnes contre l’homophobie. Ces pays, et certains autres, ont également cherché à intégrer des initiatives spéciales pour les HSH dans des programmes destinés à limiter la propagation du VIH.
Le programme officiel baptisé « Un Brésil sans homophobie » a été lancé en 2004 avec pour objectif d’améliorer les services fournis aux homosexuels, autres HSH et transgenres au sein des établissements publics de santé. Ce programme prévoit aussi d’élargir aussi la couverture et la riposte à l’épidémie de VIH au sein de ces groupes.
Le Pérou a lancé un plan national qui donne la priorité aux programmes de prévention ciblant ceux qui sont définis comme les groupes « les plus affectés », lesquels incluent les HSH, les professionnel(le)s du sexe et les prisonniers. Grâce à un financement du Fonds mondial, le plan a pour but d’étendre la couverture de la prévention à 25 % au moins des HSH et 50 % des professionnel(le)s du sexe.
De même, la Bolivie a élaboré un plan national destiné à réduire de moitié les taux d’infection à VIH d’ici à 2015. Ce plan inclut des campagnes visant à renforcer les droits des HSH et des transgenres, et à combattre la stigmatisation et la discrimination.
Malgré ces développements prometteurs, l’Amérique latine est encore loin de maîtriser l’épidémie qui affecte les HSH, et l’homophobie et la stigmatisation demeurent des obstacles majeurs pour y parvenir.
Right Hand Content
Reportages:
ICASA 2008 : Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et VIH en Afrique (07 décembre 2008)
Les HSH et l’épidémie mondiale de VIH (31 juillet 2008) (31 juillet 2008)
Renforcer le travail avec les HSH en Afrique (23 mai 2008)
Initiative mondiale pour interrompre la propagation du VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (24 juillet 2007)
Centre de presse:
La criminalisation des comportements sexuels et de la transmission du VIH entrave les ripostes au sida (27 novembre 2008)
Publications:
Directives pratiques pour intensifier la prévention du VIH (en anglais)
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, prévention du VIH et soins (en anglais) (pdf, 638 Kb)

Feature Story
Connaître votre épidémie, comprendre les implications politiques
07 janvier 2009
07 janvier 2009 07 janvier 2009
Connaître votre épidémie, comprendre les implications politiques
Pour deux personnes qui accèdent au traitement contre le VIH, cinq autres sont nouvellement infectées par le virus. Etant donné cet écart, la nécessité d’intensifier les efforts de prévention du VIH est largement admise parmi les communautés scientifiques, gouvernementales et de la société civile.
L’ONUSIDA préconise des ripostes de prévention du VIH qui soient adaptées aux contextes locaux et confortées par des preuves par le biais d’analyses épidémiologiques, de données comportementales et de la compréhension des normes sociales et sexospécifiques.
Selon un éditorial publié en 2008 dans le Journal of the Royal Society of Medicine, le fait de « connaître votre épidémie » n’est en soi pas suffisant pour agir. L’article de décembre 2008, dont les coauteurs sont Michel Sidibé, ONUSIDA, Kent Buse, ONUSIDA, et Clare Dickinson, Institut HLSP, soutient que l’incapacité à apprécier les dimensions politiques du VIH peut contrecarrer les efforts visant à promouvoir et à mettre en œuvre les politiques fondées sur des preuves.
Les auteurs recommandent qu’une analyse visant à définir les obstacles politiques et les opportunités en matière de politiques fondées sur des preuves doit constituer un élément de base de chaque riposte nationale au VIH.
Une analyse de 28 articles revus par des pairs, portant sur des études empiriques de l’évolution des politiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, a été publiée par l’Institut HLSP en octobre 2008. Ses conclusions visaient à aider les défenseurs de la cause et les décideurs à prendre des décisions plus stratégiques au sujet des politiques futures et de leur mise en œuvre.
Right Hand Content
Reportages:
The Lancet : lancement d'une série d'articles sur la prévention du VIH (06 août 2008)
Liens externes:
Revues de la Royal Society of Medicine Press
Technical Approach Papers de l’Institut HLSP : Implications politiques et politiques sur le VIH
Publications:
Comprendre les implications des politiques nationales sur le VIH : rôles des institutions, intérêts et idées – Clare Dickinson, Kent Buse, octobre 2008
VIH : Connaître votre épidémie, agir sur ses aspects politiques – Kent Buse, Clare Dickinson et Michel Sidibé : J R Soc Med 101(12): 572-573;
Related
 Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response
Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response

27 septembre 2023

Feature Story
Le club « Far Away from Home »
05 janvier 2009
05 janvier 2009 05 janvier 2009
Le développement et la croissance économiques rapides du Viet Nam au cours de la dernière décennie ont entraîné des niveaux accrus de mobilité, tant à l’intérieur du pays qu’au-delà de ses frontières.
Le développement et la croissance économiques rapides du Viet Nam au cours de la dernière décennie ont entraîné des niveaux accrus de mobilité, tant à l’intérieur du pays qu’au-delà de ses frontières. D’importants projets d’infrastructures et de développement, conjugués à la croissance industrielle, ont encouragé des jeunes et des travailleurs de tout le pays à se déplacer vers les grandes villes et les grandes provinces.
Toutefois, dans les zones où l’économie se développe rapidement et où les migrations internes s’accroissent, des facteurs tels que l’éloignement de la famille et de la communauté et des conditions de travail très difficiles contribuent à accroître la vulnérabilité des migrants et des populations mobiles au VIH et à d’autres infections sexuellement transmissibles, car ils adoptent des comportements risqués, comme les rapports sexuels sans protection et la consommation de drogues injectables.
En outre, comme les services de prévention du VIH et de soins de santé ne sont pas spécifiquement ciblés sur les migrants et les populations mobiles, ces groupes tendent à avoir un accès plus restreint à ces services. C’est particulièrement le cas des migrants et des personnes mobiles qui souvent ne sont pas déclarés comme résidents dans la région où ils travaillent.
La population migrante comprend les professionnelles du sexe, les travailleurs migrants sur les chantiers de construction, dans les zones industrielles et d’exportation ainsi que les ouvriers qui travaillent dans les ports fluviaux et les gares routières.
Depuis qu’elle a été désignée Zone industrielle et de transformation en 2002, la province de Ca Tho, dans le sud-ouest du pays, s’est distinguée comme pôle d’attraction pour les travailleurs migrants, car il s’agit de la plus grande ville du delta du Mékong. Le nombre des cas de VIH à Can Tho a également plus que décuplé, passant de 73 en 1997 à 733 en 2006.
En 2004, le Programme régional VIH/sida Canada-Asie du Sud-Est a lancé un projet avec le Département du travail, des invalides et des affaire sociales de Can Tho et le Syndicat de Can Tho, pour entreprendre des activités de prévention du VIH auprès des migrants tels que les travailleurs occasionnels, les chauffeurs routiers et les professionnel(le)s du sexe. Le projet a créé le Club « Far Away From Home », qui vise à offrir un cadre réconfortant et accueillant aux professionnel(le)s du sexe et autres travailleurs migrants de la ville de Can Tho.
On estime à 1100-1600 le nombre de professionnelles du sexe dans la province de Can Tho, dont 400-500 travaillent dans la rue ; les mêmes autorités estiment à 2200-2500 les personnes qui s’injectent des drogues.
Education par les pairs
Le Club permet aux membres des populations mobiles et autres migrants de s’assumer en leur offrant une formation aux compétences psychosociales avec l’accent sur le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles, sur le sida, l’expression orale, la sexospécificité et la sexualité, la stigmatisation et la discrimination.
Une équipe de base composée de 10 éducateurs pour les pairs (cinq professionnel(le)s du sexe et cinq travailleurs migrants) a apporté son soutien à plus de 60 membres du Club « Far Away From Home » ; ces derniers ont reçu des informations et des compétences visant à réduire leur risque d’exposition au VIH. Ces membres retournent au sein de leurs réseaux sociaux et partagent leurs connaissances avec leurs pairs, de manière officieuse.
L’une des principales réalisations du projet a été de garantir la confidentialité à tous ceux qui demandent de l’aide et un appui auprès du groupe. L’assurance d’une confidentialité et d’un anonymat complets a encouragé davantage de professionnel(le)s du sexe et de travailleurs migrants à accéder aux services de santé, grâce à l’orientation des membres du Club et des éducateurs pour les pairs. Des orientations ont été assurées en particulier vers une série de dispensaires fournissant des services confidentiels et accessibles à l’intention des populations mobiles, notamment des traitements contre les infections sexuellement transmissibles, le conseil et le test volontaires, et des bilans de santé généraux.
Le club touche chaque mois des centaines de migrants et de personnes mobiles grâce à l’engagement des membres du secteur privé dans des interventions sur les lieux de travail ou à ses activités de proximité dans les points chauds pour les professionnel(le)s du sexe direct(e)s et indirect(e)s.
Faire participer les migrants et les populations mobiles et leur donner les moyens de plaider en faveur de l’accès aux services liés au VIH pour leurs pairs ont été au cœur de la réussite du programme. En outre, sa rigueur éthique, sa pertinence et son efficacité ont fait du projet un élément réussi des stratégies de prévention du VIH et un travail de référence visant les migrants et les populations mobiles.
Right Hand Content2
Centre de presse:
Déclaration du Secrétariat de l’ONUSIDA à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé – la santé des migrants (22 mai 2008) (en anglais)
Reportages:
Publications:
Le Club « Far Away From Home » : Prévention du VIH et rétro-information sur la mise en œuvre de politiques pour les populations migrantes et mobiles dans le delta du Mékong, Viet Nam (en anglais) (pdf, 899 Kb.)

Feature Story
L'ONUSIDA en 2008 : Une année de progrès, de défis, de débats, et de changements
26 décembre 2008
26 décembre 2008 26 décembre 20082008 a été une année de progrès, de défis, de débats et de changements. Dans ce bilan de fin d’année, l’ONUSIDA fournit un instantané des problèmes, des événements et des initiatives clés qui ont façonné la riposte mondiale au sida au cours des 12 derniers mois.
| Progrès |
| Les investissements dans le sida donnent des résultats |
|
|
|
Plusieurs étapes ont été franchies en 2008 : l’objectif d’avoir au moins 3 millions de personnes sous traitement antirétroviral a été atteint ; à la fin de 2008, environ 4 millions de personnes étaient sous traitement. Il y a eu moins de nouvelles infections à VIH en 2008 qu’en 2005, et le nombre de personnes qui sont mortes à cause du sida a diminué. |
|
|
|
| Leadership accru pour la riposte mondiale au sida | |
|
|
L’engagement du leadership pour le VIH s’est maintenu à des niveaux élevés tout au long de 2008. Lors de la Réunion de haut niveau sur le sida et les objectifs du Millénaire pour le développement, les pays ont réaffirmé leurs engagements en faveur de la réalisation des cibles mondiales sur le sida. Une nouvelle initiative de l’ancien Président du Botswana, M. Festus Mogae, a invité les dirigeants africains à s’unir pour des activités de prévention du VIH. Deux commissions indépendantes sur le sida, l’une en Afrique et l’autre en Asie, ont passé en revue la situation de l’épidémie de sida sur les deux continents et ont appelé les dirigeants à accélérer les efforts de prévention et de traitement du VIH. Près de US $10 milliards étaient disponibles pour la riposte au sida dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les dépenses domestiques sur le sida ont augmenté de 25% à 54%, et les pays de l’Afrique subsaharienne ont dépensé six fois plus en provenance de leurs propres ressources. Les Etats-Unis d’Amérique ont engagé US $48 milliards supplémentaires sur cinq ans à partir de 2009 pour le sida, la tuberculose et le paludisme.
|
|
|
|
| Défis |
| Les efforts de prévention et de traitement du VIH sont à la traîne | |
|
|
D’importants défis subsistent dans le cadre de la riposte au sida : pour deux personnes placées sous traitement, cinq autres sont nouvellement infectées. Le nombre total des personnes vivant avec le VIH s’est accru pour atteindre 33 millions. Près de 6 millions de personnes ont aujourd’hui besoin de traitement. L’accès au traitement pédiatrique est à la traîne, et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes qui s’injectent des drogues et les professionnel(le)s du sexe sont souvent ignorés par les programmes de prévention et de traitement du VIH. |
|
|
|
| Les crises mondiale ont des répercussions sur la riposte au sida | |
|
|
Les systèmes de santé sont dépassés – tout comme d’autres secteurs, par exemple l’éducation et l’emploi. La hausse du prix des aliments, ainsi que les pénuries alimentaires, ont placé un fardeau supplémentaire sur la capacité des familles à faire face à leurs besoins. En outre, la crise financière mondiale a créé des incertitudes au sujet de l’impact qu’elle risque d’avoir sur la riposte au sida. |
|
|
|
| Les droits humains des personnes vivant avec le VIH et des personnes marginalisées sont souvent violés | |
|
|
De nombreux pays sont en train de réviser leurs lois ou d’en adopter de nouvelles, dont plusieurs visent à protéger les personnes vivant avec le VIH contre la discrimination. Mais dans nombre de pays, on observe une tendance préoccupante à la criminalisation de la transmission du VIH ainsi que des comportements sexuels.
|
|
|
|
| Débats |
| Le sida est-il terminé? | |
|
Le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2008 de l’ONUSIDA a montré clairement que le sida n’est terminé dans aucune partie du monde, même si le nombre des nouvelles infections à VIH a chuté dans plusieurs pays. Le rapport a mis en garde que le sida restait une cause principale de décès en Afrique. Il soulignait également que l’incidence du VIH est en hausse dans les pays qui connaissent des épidémies plus anciennes tels que les Etats-Unis d’Amérique, l’Australie, l’Allemagne, et le Royaume-Uni. Les dirigeants mondiaux, lors de divers forums internationaux, à commencer par la Réunion de haut niveau sur le sida et la Conférence sur le sida de Mexico jusqu’à l’ICASA de Dakar, ont réfuté avec véhémence la notion que ‘le sida est terminé’. |
|
|
|
| Le sida affaiblit-il les systèmes de santé ? | |
|
|
La faiblesse des systèmes de santé a entravé les progrès dans l’accélération de l’accès aux services de traitement du VIH dans de nombreux pays. Parallèlement, le sida a également exercé une pression sur des systèmes de santé déjà faibles dans un grand nombre de pays. S’exprimant lors de la Conférence internationale sur le sida à Mexico, le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan, a déclaré « Nous ne devrions pas accuser les programmes spécifiques aux maladies d’avoir affaibli les systèmes de santé. La vérité est que pendant des décennies, les gouvernements ont sous-investi dans les infrastructures sanitaires. » Le Dr Chan a ajouté que « d’autres progrès durables dépendent absolument de l’amélioration de la capacité des services. A ce stade, nous avons une opportunité historique d’aligner l’agenda de la riposte au sida sur l’agenda du renforcement des services de santé. » Au cours d’un entretien, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, le Dr Peter Piot, a déclaré « Il n’y a absolument aucune preuve que le sida ébranle les services de santé. Au contraire, il a certainement renforcé certains services. Les gouvernements déterminés feront en sorte que le financement spécifique à la maladie soit utilisé pour renforcer les capacités locales. » |
|
|
|
| Y a-t-il une solution miracle pour la prévention du VIH ? | |
|
|
Les stratégies et programmes de prévention du VIH ont été au centre de nombreux débats. Divers experts ont approché la prévention sous des angles différents : le rôle des partenaires sexuels multiples et des relations simultanées, le traitement contre le VIH en tant que mesure de prévention, la circoncision masculine, le rôle des préservatifs, et le report du début de l’activité sexuelle ont fait l’objet de débats. L’ONUSIDA a soutenu que le mot « seulement » ne s’applique pas au sida – que ce soit pour le traitement seulement, la prévention du VIH seulement, les préservatifs seulement, l’abstinence seulement ou la circoncision masculine seulement. En réalité, ils sont tous nécessaires – une approche réellement exhaustive. Pour l’ONUSIDA, les trois piliers d’une riposte complète et efficace au sida, alors que nous nous approchons de l’accès universel, sont la prévention, le traitement, les soins et l’appui en matière de VIH. L’ONUSIDA préconise que les pays mettent en œuvre des programmes de prévention du VIH qui seront vraiment efficaces pour réduire les nouvelles infections à VIH. Cela demande une combinaison stratégique d’interventions qui s’adressent aux populations exposées au risque d’infection ou vulnérables à la transmission du VIH et qui utilisent des méthodes de changement comportementales et sociales qui sont appropriées et fondées sur les dernières données probantes. |
|
|
|
| Changements à l’ONUSIDA |
| Le mandat du Dr Peter Piot en tant que Directeur exécutif de l’ONUSIDA se termine à la fin 2008. | |
|
|
A la fin 2008, le Dr Peter Piot, le Directeur exécutif fondateur de l’ONUSIDA, quittera ses fonctions après avoir dirigé l’organisation depuis sa création. En 2009, il rejoindra l’Imperial College de Londres comme premier directeur de son nouvel Institut pour la santé mondiale. |
|
|
|

Feature Story
Soutenir les jeunes élèves vivant avec le VIH en Namibie et en Tanzanie
23 décembre 2008
23 décembre 2008 23 décembre 2008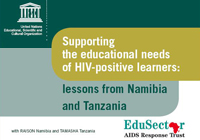
‘Soutenir les besoins éducatifs des élèves séropositifs au VIH : leçons tirées de l’expérience de la Namibie et de la Tanzanie’
Photo: UNESCO
Selon un nouveau rapport de l’UNESCO, les secteurs de l’éducation ne répondent pas aux besoins d’apprentissage des enfants séropositifs au VIH en Namibie et en Tanzanie, leurs ripostes au sida étant décrites comme inappropriées à de nombreux égards.
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) indique que les écoles et le secteur de l’éducation ont la possibilité et la responsabilité de soutenir les enfants séropositifs au VIH dans leurs apprentissages et leur développement social. Afin d’améliorer les capacités du secteur de l’éducation, elle a commandé ce premier rapport spécifiquement axé sur les besoins éducatifs des élèves séropositifs au VIH.
Le rapport intitulé ‘Soutenir les besoins éducatifs des élèves séropositifs au VIH : leçons tirées de l’expérience de la Namibie et de la Tanzanie’ recense les obstacles auxquels sont confrontés les établissements d’éducation qui souhaitent répondre aux besoins des enfants et des jeunes vivant avec le VIH, et propose des recommandations et des directives sur la meilleure manière de les aider.
L’une des observations les plus frappantes de l’étude est l’omniprésence de la stigmatisation et de la discrimination. Chaque enfant séropositif interrogé en Namibie et en Tanzanie a décrit de quelle manière il subissait de manière personnelle et permanente les conséquences négatives de la révélation de son statut sérologique VIH. Chacun a senti qu’il était plus sûr de garder le silence sur cette question. La stigmatisation a été décrite comme « plus mortelle » que la maladie elle-même.
Des études ont révélé que les informations sur le VIH communiquées dans les écoles étaient souvent « dépersonnalisées et loin des besoins des individus infectés et affectés par la maladie ». On note, parallèlement à ce sens du déni et au silence qui entoure le VIH, un manque de communication efficace concernant la santé sexuelle et reproductive. Dans de nombreuses écoles, on a découvert que cette question était traitée avec « désinvolture ».
L’étude a révélé que l’environnement scolaire recèle le potentiel pour offrir un appui important pour la prise en charge sociale et le développement de l’enfant. Les familles d’enfants séropositifs au VIH peuvent elles-mêmes être affectées par le virus et cela signifie que l’appui des enseignants et des pairs est susceptible de fournir un complément précieux pour l’enfant. Dans la mesure où de nombreux enfants séropositifs vivent dans des internats plutôt que dans le milieu familial, l’école devient un auxiliaire important à la prise en charge institutionnelle.
Le rapport fait valoir que le manque de données et l’absence d’études masquent l’ampleur des lacunes au niveau de l’appui aux élèves séropositifs. Parallèlement, des éléments concrets concernant la réduction des frais scolaires et l’élargissement des programmes d’alimentation pour les enfants rendus orphelins ou vulnérables par le VIH et les enfants vivant avec le virus donnent à penser que « les choses s’améliorent ».
Le rapport de l’UNESCO recommande que l’on dispense une éducation accessible et de qualité de manière intensifiée et équitable pour tous les enfants. Une telle éducation est considérée comme une action aussi importante que les interventions ciblant spécifiquement les enfants vivant avec le VIH.
Soutenir les jeunes élèves vivant avec le VIH en
Coparrainants:
Publications:
Soutenir les besoins éducatifs des élèves séropositifs au VIH : leçons tirées de l’expérience de la Namibie et de la Tanzanie
Actuellement disponible en anglais, le rapport sera bientôt publié en français et en portugais. Un nombre limité d’exemplaires du rapport peuvent être obtenus gratuitement en adressant un courriel à aids@unesco.org et en précisant le nombre d’exemplaires souhaités et la langue choisie.
Related

Feature Story
La région Caraïbes doit cibler davantage sa prévention pour que sa riposte au VIH soit plus efficace
22 décembre 2008
22 décembre 2008 22 décembre 2008
Le Dr Karen Sealey, Directrice de l’Equipe d’appui aux régions pour les Caraïbes de l’ONUSIDA, lors du lancement du rapport 'Keeping score II' à Port of Spain.
Photo: UNAIDS
Les personnes les plus exposées au risque d’infection à VIH dans les Caraïbes ne sont généralement pas incluses au centre des stratégies de prévention du virus. C’est l’une des conclusions du rapport ‘Keeping Score II’ récemment publié par l’Equipe d’appui aux régions pour les Caraïbes à Trinidad et Tobago.
Le rapport ‘Keeping Score II’ est une analyse consolidée des rapports d’activité des pays caribéens présentés par les gouvernements pour la réunion de haut niveau sur le sida de l’Assemblée générale des Nations Unies 2008.
Cependant, près de 80 % des comptes-rendus d’actualisation des pays ne contiennent pas d’informations sur la couverture des programmes de prévention ciblant les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe et les consommateurs de drogues injectables. Ces lacunes indiquent, semble-t-il, que bon nombre des décisionnaires nationaux et des personnes chargées de la mise en œuvre des ripostes nationales ne connaissent pas bien le rôle de ces groupes de population les plus exposés au risque d’infection dans leur épidémie et la nécessité d’avoir des programmes de prévention spécifiquement axés sur eux.
Commentant la récente publication du rapport à Port of Spain, le Dr Karen Sealey, Directrice de l’Equipe d’appui aux régions pour les Caraïbes de l’ONUSIDA, a déclaré qu’il était nécessaire d’engager des efforts plus soutenus pour s’assurer que les programmes de prévention du VIH atteignaient les personnes les plus exposées au risque d’infection.
Le Dr Amery Browne, Ministre du Développement social de Trinidad et Tobago, a aussi insisté sur la nécessité, pour les programmes de prévention, d’atteindre des taux de réussite plus élevés lorsqu’il a évoqué la publication du rapport. Indiquant que 20 000 personnes avaient été nouvellement infectées par le VIH dans la région l’an dernier, le Dr Browne a déclaré « Cette statistique épouvantable devrait nous inciter à faire plus que simplement réfléchir à la question. Elle devrait nous encourager à chercher de nouvelles méthodes novatrices pour que les messages de prévention atteignent les publics clés. Nous devons être audacieux ».
Parallèlement à un examen des obstacles, le rapport ‘Keeping Score II’ met aussi en lumière les réalisations de la riposte des Caraïbes au sida. Il y a eu des succès remarquables au niveau du traitement du VIH dont la couverture a été considérablement élargie. A la fin 2007, 30 000 personnes recevaient un traitement antirétroviral, c’est-à-dire 50 % de plus que douze mois plus tôt. La couverture du traitement reste néanmoins inférieure à 45 % dans la région.

Le rapport ‘Keeping Score II’ est une analyse consolidée des rapports d’activité des pays caribéens présentés par les gouvernements pour la réunion de haut niveau sur le sida de l’Assemblée générale des Nations Unies 2008.
Dans les domaines de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et de la sécurité transfusionnelle, des progrès ont été enregistrés dans différents pays. En outre, on a noté un renforcement de l’engagement politique de haut niveau, un accroissement des ressources allouées aux ripostes nationales et un élargissement/un approfondissement de l’approche multisectorielle.
Mme Angela Lee Loy, présidente du Comité national de coordination de la lutte contre le sida de Trinidad et Tobago, a déclaré espérer que le rapport ‘Keeping Score II’ serait largement utilisé pour aider la région Caraïbes à structurer et intensifier sa riposte au VIH. « Je pense que c’est une initiative essentielle qui permettra au Comité national de coordination de la lutte contre le sida d’améliorer sa planification stratégique » a-t-elle indiqué.
La région Caraïbes est la deuxième région la plus durement touchée après l’Afrique subsaharienne, avec un taux de prévalence du VIH chez les adultes de 1,1 % et où le sida demeure l’une des principales causes de décès chez les caribéens âgés de 25 à 44 ans. L’épidémie s’est stabilisée dans plusieurs pays – à un niveau généralement élevé toutefois. A la fin 2007, on estimait à 230 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH dans la région.
La région Caraïbes doit cibler davantage sa préve
Reportages:
Importants progrès à déclarer : UNGASS 2008 (12 mars 2008)
Publications:
Keeping Score II (pdf, 2.82 Mb) (en anglais)

Feature Story
L’amour à l’époque du VIH
19 décembre 2008
19 décembre 2008 19 décembre 2008
« Il est possible d’aimer une personne séropositive. C’est comme aimer n’importe qui » déclare Christina Rodriguez dans l’un des cinq épisodes d’une nouvelle série de documentaires sur la vie sexuelle et reproductive des jeunes qui vivent avec le VIH. Photo: aids2031
« Il est possible d’aimer une personne séropositive. C’est comme aimer n’importe qui » déclare Christina Rodriguez dans l’un des cinq épisodes d’une nouvelle série de documentaires sur la vie sexuelle et reproductive des jeunes qui vivent avec le VIH.
Agée de 16 ans, Christina a été diagnostiquée séropositive au VIH lorsqu’elle avait 3 ans, au moment où ses parents ont eux-mêmes découvert qu’ils étaient séropositifs. Aujourd’hui, elle parle ouvertement de la manière dont elle s’adapte à son traitement et de la manière dont elle et sa mère gèrent leur séropositivité. « Ca risque peut-être de rendre mes rencontres amoureuses plus difficiles, mais tant que je ne pense pas que la relation est sérieuse, je n’ai pas à dire quoi que ce soit ».
Christina raconte son histoire dans l’un des cinq épisodes qui étudient la manière dont les jeunes qui vivent avec le VIH abordent le passage à l’âge adulte, leur vie sexuelle et reproductive, leur carrière professionnelle et leur famille, et leurs attentes et espoirs dans l’avenir. Chaque épisode présente plusieurs jeunes séropositifs qui vivent dans des villes différentes : New York, Bombay, Londres, Saint-Pétersbourg et Le Cap.
Par le biais d’histoires intimes, la série de documentaires ‘L’amour à l’époque du VIH’ (titre original Love in a Time of HIV) a pour but d’aider à lutter contre le relâchement de la vigilance à l’égard du sida en montrant comment certains jeunes sont affectés par l’épidémie et en éduquant les téléspectateurs sur les besoins impérieux des jeunes – qu’ils soient séropositifs ou séronégatifs – en matière d’accès à des informations et des services de santé sexuelle et reproductive.
« On m’a juste donné un petit bout de papier avec le signe ‘plus’ dessus. Qu’est-ce que c’était ? Qu’est-ce que cela signifiait ? Je ne comprenais pas ce que le ‘plus’ voulait dire à ce moment là. Plus tard, en revanche, au dispensaire [de désintoxication], on m’a simplement interdit d’entrer en me disant que j’étais séropositive au VIH » a déclaré Masha, ancienne consommatrice de drogues injectables qui vit avec le virus.
Masha et son amie sont toutes les deux mariées à de jeunes hommes séronégatifs au VIH. A mesure que l’on raconte leur histoire, le téléspectateur découvre les sérieux dilemmes auxquels ces couples sérodiscordants sont confrontés. Les hommes, qui ont tous les deux 25 ans, sont tellement désireux d’être pères qu’ils ont des relations sexuelles non protégées avec leur épouse qui est séropositive pour essayer de concevoir un enfant sans tenir compte du risque d’être contaminé.
Les jeunes d’aujourd’hui ont grandi parallèlement au développement dans la pandémie de sida et leurs actions sont déterminantes pour l’évolution future du sida. Les jeunes sont aussi affectés de manière disproportionnée par l’épidémie – plus de 40 % des nouvelles infections à VIH recensées à travers le monde affectent les jeunes de moins de 25 ans. Il existe actuellement 10 millions de jeunes qui vivent avec le VIH et bon nombre d’entre eux n’ont pas accès au traitement, aux soins et à l’appui nécessaires pour être bien portants.

Masha et son amie sont toutes les deux mariées à de jeunes hommes séronégatifs au VIH. Photo: aids2031
Malgré les statistiques criantes qui indiquent que les jeunes d’aujourd’hui sont les plus exposés au risque d’infection à VIH à travers le monde et la foule de difficultés que les jeunes rencontrent quotidiennement – depuis des taux de chômage qui explosent à la violence sexuelle et l’émergence rapide de situations de conflit – on sait très peu de choses sur les idées et les comportements des jeunes, en particulier en ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive. Les jeunes sont rarement consultés pour l’élaboration des politiques et des programmes de santé au niveau national et il existe un écart croissant entre ce que les universitaires/scientifiques et les décisionnaires considèrent comme la « réalité » des vies des jeunes et les expériences réelles que ces derniers connaissent alors qu’ils grandissent dans une économie que se mondialise rapidement.
Les points de vue et les perceptions des jeunes concernant les problèmes auxquels eux et leur pays sont confrontés au quotidien sont essentiels pour élaborer une riposte efficace contre le sida. Leurs idées et opinions doivent être intégrées dans la lutte contre le sida pour s’assurer que les programmes et les politiques prennent en compte les jeunes comme il convient.
La série de documentaires ‘L’amour à l’époque du VIH’ est actuellement diffusée sur BBC World, depuis novembre 2008. Elle fait aussi l’objet d’une diffusion et de débats en ligne. Découvrez plus d’informations sur le site Internet BBC World et visionnez la série sur le site Internet aids2031.
Quelques mots sur aids2031
aids2031 est un projet sur deux ans élaboré en 2007 par un consortium de partenaires – composé d’économistes, d’épidémiologistes, de spécialistes des sciences biomédicales, sociales et politiques – pour étudier ce que l’on a appris sur la lutte mondiale contre le sida et pour fournir des recommandations sur la manière de l’orienter vers une riposte pérenne à long terme. Ce projet ne porte pas sur ce qui devrait être fait en 2031 mais sur ce qui peut l’être différemment aujourd’hui pour changer le visage de la pandémie d’ici à 2031, 50 ans après la description des premiers cas de sida.
A la fin 2009, aids2031 publiera ses recommandations dans son rapport final intitulé An Agenda for the Future (Ordre du jour pour l’avenir). Pour étayer ce rapport, aids2031 a organisé neuf groupes de travail mondiaux qui sont chacun chargés de s’interroger sur la sagesse conventionnelle, de stimuler une nouvelle recherche et de déclencher des débats publics sur la situation actuelle et future de la riposte au sida. A cette fin, les différents groupes de travail ont fait participer près de 500 leaders, militants et experts au sein et en dehors des communautés concernées par le sida à des discussions dans le cadre de groupes de réflexion, de dialogues publics et d’un sommet des jeunes leaders.
L’amour à l’époque du VIH
Liens externes:
Site Internet aids2031 (en anglais)
BBC World : L’amour à l’époque du VIH (en anglais)
Multimédia:
Visionnez les documentaires de la série ‘L’amour à l’époque du VIH’ (en anglais)

Feature Story
Le Guyana lance la coalition nationale ‘foi et VIH’
16 décembre 2008
16 décembre 2008 16 décembre 2008
Faith leaders from the Hindu, Christian, Islamic, Rastafarian and Baha’i faiths gathered at the Guyana National "faith-and-hiv" Conference in Georgetown, Guyana, on 11 December 2008.
Credit: UNAIDS
Le 11 décembre 2008, le Secrétariat du Programme national de lutte contre le sida du Ministère de la Santé du Guyana a convoqué une conférence nationale sur ‘la foi et le VIH’, avec le soutien du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). La conférence visait à établir une coalition nationale des leaders confessionnels de toutes appartenances au Guyana afin d’aborder la stigmatisation et la discrimination liées au VIH.
Lors de l’ouverture de la ‘Conférence nationale foi et VIH du Guyana’, des leaders de la foi hindoue, chrétienne, islamique, rastafari et baha’i ont convenu de passer de l’engagement et de la rhétorique à l’action, en approuvant la ‘Déclaration foi et VIH du Guyana’.
Par cette déclaration, les leaders confessionnels reconnaissent la nécessité d’incorporer des informations appropriées sur le VIH dans leurs discours, rituels, éducation religieuse, et formation des futurs chefs religieux. Ils ont aussi accepté de respecter les droits des personnes vivant avec et affectées par le VIH, et d’assurer leur inclusion totale dans la vie religieuse, sociale, familiale et économique.
En outre, il se sont promis d’exhorter les femmes et leurs partenaires masculins à accéder aux soins de santé officiels, notamment au test VIH, étant donné que le VIH est une maladie traitable et que les parents séropositifs au VIH peuvent avoir des enfants exempts de VIH. Ils se sont également engagés à prendre en compte toutes les vulnérabilités auxquelles sont confrontés les enfants affectés par le VIH et vivant avec le virus, en particulier à faire en sorte que soit respecté leur droit d’accéder à l’éducation, au traitement, aux soins et à l’appui dans un milieu aimant.
Enfin, ils ont accepté d’utiliser leurs lieux de culte, leurs établissements d’enseignement et de santé, ainsi que leurs programmes à l’intention des femmes et des jeunes pour fournir la gamme complète des services de prévention, de traitement, de soins et d’appui dans le domaine du VIH.
Dans ses remarques d’introduction, le Ministre de la Santé, le Dr Leslie Ramsammy, a souligné l’importance, pour les organisations confessionnelles, de jouer un rôle plus actif dans la riposte au sida et attiré l’attention sur les résultats d’une enquête récente révélant que seules 50% de ces organisations soutenaient pleinement les personnes vivant avec le VIH.

Participants at the Guyana National "faith-and-hiv" Conference, Georgetown, Guyana, 11 December 2008
Credits: UNAIDS
Malgré la bonne volonté et l’engagement manifestés afin de trouver des manières de travailler ensemble, il y a un écart entre les bonnes intentions et une action commune efficace. L’incompréhension de la manière dont les diverses communautés religieuses sont organisées ; le manque de tolérance et de respect pour les croyances de leurs adeptes ; et la question de savoir comment identifier des initiatives communes qui transcendent les religions organisées, peuvent constituer des obstacles.
La conférence a été utilisée pour orienter les discussions qui permettront au leadership religieux du Guyana d’aborder les questions de stigmatisation et de discrimination liées au VIH et sur la manière dont la ‘Coalition foi et VIH du Guyana’ peut apporter une contribution majeure, en partenariat avec le Secrétariat du Programme national de lutte contre le sida du Ministère de la Santé et ses partenaires, à la réalisation des cibles nationales sur la voie de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH pour tous les Guyaniens, quels qu’ils soient, et où qu’ils soient.
« La riposte au VIH, dans chaque pays, dépend en grande partie d’une large mobilisation de ses dirigeants, de ses institutions et de ses mouvements. Les chefs religieux et leurs communautés sont présents pratiquement partout dans le monde, et font un énorme travail à la fois de proximité et d’introspection. Ils sont d’importantes parties prenantes dans la riposte au VIH, car ils bénéficient d’un avantage stratégique pour ce qui est de l’appui, de la compréhension, et de l’acceptation des personnes vivant avec le VIH, et jouent un rôle majeur dans la prévention des nouvelles infections à VIH, » a déclaré le Dr Ruben del Prado, Coordonnateur de l’ONUSIDA au Guyana.
Le leadership religieux a une influence considérable sur les efforts menés pour mettre fin à la propagation du VIH et, comme le montre le Guyana, cet important leadership peut être renforcé en partenariat avec les pouvoirs publics, la société civile et la communauté internationale.
Le Guyana lance la coalition nationale ‘foi et VI
Reportages:
Les chefs religieux hindous s’engagent dans la riposte au sida (18 juin 2008)
Elaborer des stratégies pour travailler avec les organisations confessionnelles (10 avril 2008)
Publications:
Déclaration du Guyana sur la foi et le VIH (pdf, 112 Kb) (en anglais)