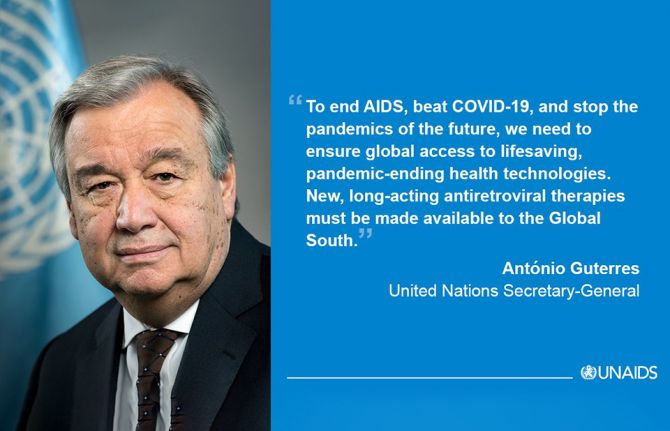Feature Story
Le Dr Peter Piot présente son dernier rapport en tant que Directeur exécutif à l’organe directeur de l’ONUSIDA
16 décembre 2008
16 décembre 2008 16 décembre 2008 Dr Peter Piot a présenté au CCP son dernier rapport en tant que Directeur exécutif.
Dr Peter Piot a présenté au CCP son dernier rapport en tant que Directeur exécutif.Lors de la 23ème réunion du Conseil de Coordination du Programme (CCP) de l’ONUSIDA, le Dr Peter Piot a présenté son dernier rapport en tant que Directeur exécutif.
Dans ce qu’il a appelé son « chant du cygne », le Dr Piot a présenté un examen concis et cependant complet de son mandat à l’ONUSIDA, ainsi que de la riposte au sida vue par les yeux du premier directeur exécutif de l’ONUSIDA.
Le Dr Piot a évoqué à quel point les choses sont différentes aujourd’hui dans le monde de ce qu’elles étaient lorsque l’ONUSIDA a été créé en 1996, alors que les contributions pour le sida dans les pays en développement n’atteignaient que 250 millions de dollars et que personne n’était sous traitement antirétroviral. Il a poursuivi en décrivant les réalisations de la riposte au sida et a terminé en portant un regard sur les problèmes futurs, notamment le leadership et le financement, la nécessité que les politiques soient informées par la science, l’absence de compromis en matière de droits de l’homme, l’engagement de la société civile, et le « faire travailler l’argent disponible » pour les personnes qui en ont le plus besoin.
Le Dr Piot a conclu son rapport en appelant l’organe directeur de l’ONUSIDA à donner au nouveau Directeur exécutif, M. Michel Sidibé, le même soutien que celui dont il a bénéficié.
Les délégations ont fait part de leur satisfaction. Les pays et délégations sont intervenues pour saluer le travail du Dr Piot, tout en rappelant les défis auxquels est confrontée la riposte au sida et en assurant M. Sidibé de leur appui dans les tâches qui l’attendent.
M. Sidibé a remercié le conseil de son travail et le directeur exécutif actuel de ses contributions, et il a promis de poursuivre sans relâche les efforts pour inverser le cours de l’épidémie de sida.
Le Dr Piot a clôturé la session en notant que les médias parlent souvent de conflits liés au sida, mais ce qu’on ne voit pas assez, c’est l’étonnante coalition d’intérêts très divers. « Dans quelles autres circonstances verriez-vous tous ces groupes différents ? », a-t-il déclaré. Il a ensuite remercié le président du CCP, M. l’Ambassadeur Mark Dybul, de son leadership et conclu par ces paroles d’Arundhati Roy :
« Ne jamais simplifier ce qui est compliqué et compliquer ce qui est simple. Respecter la force, jamais le pouvoir. Et surtout, observer. Essayer de comprendre. Ne jamais détourner le regard. Et ne jamais, jamais oublier. »
Le Dr Peter Piot présente son dernier rapport en
Discours:
Regarder la vidéo du discours du Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA (pdf, 56 Kb) (en anglais)
Discours de Michel Sidibé, nommé nouveau directeur exécutif de l’ONUSIDA à compter du 1er janvier 2009, à l’occasion de la 23ème réunion du Conseil de Coordination du Programme, 16 décembre 2008 (pdf, 44 Kb) (en anglais)
Publications:
Résolution de la 23ème réunion du Conseil de Coordination du Programme (16 décembre 2008) (pdf, 21 Kb) (en anglais)
ONUSIDA : Les 10 premières années (pdf, 5.94 Mb) (en anglais)

Feature Story
Nouvelle enquête sur le site Internet de l'ONUSIDA
12 décembre 2008
12 décembre 2008 12 décembre 2008L'ONUSIDA cherche à mieux comprendre son public et à savoir dans quelle mesure les utilisateurs de notre site Internet sont satisfaits des fonctions et des contenus disponibles. Les informations fournies nous aideront à évaluer les besoins supplémentaires et nous permettront de rendre le site encore plus utile à l’avenir.
Votre avis nous intéresse et nous vous serions très reconnaissants de nous aider en complétant l’enquête en ligne. Elle ne vous prendra que 5-7 minutes et vos réponses sont totalement confidentielles.
Cliquez ici pour participer à l'enquêteRelated

Feature Story
Plaidoyer pour l’efficacité des essais de méthodes anti-VIH pour les femmes
11 décembre 2008
11 décembre 2008 11 décembre 2008
Les femmes et les filles représentent la moitié des personnes vivant avec le VIH dans le monde.
Photo: ONUSIDA/P. Virot
Les femmes et les filles, qui représentent la moitié des personnes vivant avec le VIH, sont souvent sous-représentées dans les essais de méthodes biomédicales de prévention du VIH, en particulier dans ceux qui évaluent les nouveaux traitements ou stratégies médicamenteuses. Lorsqu’elles participent, elles sont en nombre trop insuffisant pour qu’on puisse en tirer des conclusions spécifiques. Malgré des différences biologiques entre hommes et femmes qui peuvent influencer le métabolisme des médicaments, les données de recherche ne sont pas ventilées, analysées et communiquées par sexe.
Il y a un an jour pour jour, une réunion prenait fin et marquait le début de l’initiative Femmes et essais de méthodes anti-VIH. Ce nouveau forum ouvrait un dialogue entre académiciens, scientifiques et preneurs de décisions sur les normes de recherche soutenant la relative invisibilité des femmes dans la conception, le déroulement et les rapports des essais cliniques. Cet événement était organisé par quatre partenaires, à savoir l’ONUSIDA, la Coalition mondiale sur les femmes et le sida, le Centre international de recherche sur les femmes (CIRF) et Tibotec.
Un an plus tard, on constate que cette initiative génère un certain intérêt au niveau mondial. « La plus grande réussite de l’année écoulée a été l’approche simultanée et sur plusieurs fronts de la question de la participation des femmes aux essais VIH », a déclaré Karen Manson de Tibotec, co-organisatrice de la première réunion.
« La réunion de Genève a catalysé de nombreuses actions et initiatives dont certaines étaient le fruit des groupes de travail créés pour la réunion et beaucoup d’autres le résultat indirect de la motivation de certains à faire avancer les choses partout où cela était possible. »
Un certain nombre de domaines stratégiques ont été identifiés pendant la consultation de 2007 puis formulés dans un plan d’action mis en œuvre autour des thèmes suivants : conception, mise en œuvre et suivi des résultats des essais.
Conception d’essais prenant compte la réalité féminine
Afin de dresser un tableau précis de la participation des femmes aux essais cliniques, l’une des activités menées au cours de ces douze derniers mois a consisté à évaluer les progrès réalisés depuis 2000 quant à la proportion des femmes associées à la phase finale des essais cliniques de méthodes anti-VIH. L’utilisation de la « carte de pointage » a permis de montrer que les essais financés par des fonds publics, tels ceux financés par l’Institut national de la santé aux Etats-Unis, associaient davantage de femmes que les essais financés par des fonds privés. L’engagement de l’Institut national de la santé à recourir à une représentation appropriée des femmes dans ses essais cliniques est conforme à la législation du pays relative à l’intégration des femmes et des minorités dans les essais financés par le gouvernement.
« Les avancées constatées aux Etats-Unis du fait de la Public Law revitalization act sont une vraie bonne nouvelle. Il nous reste cependant beaucoup à faire pour être en conformité avec ces normes en matière d’essais de traitement anti-VIH », a déclaré le Dr Sharon Walmsley, Professeur de médecine à l’Université de Toronto (Canada), qui a présenté les résultats de cet exercice à la Conférence internationale sur le sida (Mexique, août 2008).
Recrutement et maintien du nombre des participantes aux essais
Il peut s’avérer difficile de convaincre les femmes de participer à des essais cliniques. Lorsqu’elles le font, les recherches montrent qu’elles abandonnent rapidement, pour un certain nombre de raisons. Il est reconnu que la participation de groupes communautaires, y compris de groupes de femmes, à la conception d’essais et aux discussions relatives à la mise en œuvre peuvent améliorer leur participation sur toute la durée des essais. Parvenir à atteindre les lieux où les femmes peuvent se retrouver ou rendre les lieux où sont menés les essais plus accueillants pour les femmes, par exemple en offrant les services d’une garderie et des horaires souples, sont des façons d’attirer les participantes et de faire en sorte qu’elles participent à la totalité des essais.
Essais menés tout en répondant aux besoins des femmes
Les organisateurs d’essais ont des responsabilités éthiques envers les participants. La tenue d’essais cliniques peut en effet toucher la santé des sujets de recherche. Dans les essais cliniques de méthodes anti-VIH, il est obligatoire de fournir des services de santé spécifiques, tels que les mesures de prévention du VIH et l’accès à des traitements antirétroviraux lorsque cela est nécessaire. Pour les participantes, les services de santé offerts doivent aussi comprendre des services liés à la santé sexuelle et reproductive, y compris des frottis réguliers pour dépister le cancer du col de l’utérus et des dépistages réguliers d’infections sexuellement transmissibles.
« En définissant les services de santé sexuelle et reproductive qui seront fournis aux femmes lors des essais de méthodes anti-VIH, ceux qui parrainent ces essais ont la possibilité de bien faire et de faire du bien », déclare Anna Forbes, Directrice adjointe de la Campagne mondiale pour les microbicides.

Les services de santé offerts doivent aussi comprendre des services liés à la santé sexuelle et reproductive
Photo: ONUSIDA/P. Virot
« Utiliser les ressources mises en place pour l’essai en vue de construire un accès durable à ces soins après la période d’essai (par exemple en formant le personnel de santé publique local et en achetant du matériel qui peut être laissé sur place à l’usage de la communauté) contribue aussi au respect des responsabilités éthiques induites par les essais et à la réduction des disparités mondiales en matière d’accès aux soins de santé chaque fois que cela est possible, par le biais même des essais », affirme Mme Forbes.
Des essais prenant en compte la sexospécificité
L’initiative Femmes et essais de méthodes anti-VIH a donné lieu à des discussions sur le rôle des essais cliniques dans l’examen de facteurs sociaux tels que la sexospécificité, qui pourraient expliquer les différences des ripostes à une intervention en cours d’examen. Le centre international de recherche sur les femmes (CIRF) joue un rôle directeur dans la promotion d’une perspective sociale des essais.
Cet été, à la Conférence internationale sur le sida qui s’est déroulée au Mexique au cours de laquelle un certain nombre de réunions parallèles se sont tenues sur les « Femmes et [les] essais de méthodes anti-VIH », le CIRF a publié un document sur la difficulté de recruter des femmes pour des essais cliniques et de faire en sorte qu’elles participent à la totalité de l’essai.
Selon Geeta Rao Gupta, Présidente du CIRF et membre d’un groupe d’orientation pour l’initiative Femmes et essais de méthodes anti-VIH, « les essais cliniques offrent une opportunité unique de recueillir et de communiquer des données sociales et comportementales pouvant fournir un tableau plus complet de l’épidémie de VIH chez les hommes et chez les femmes.
Essais donnant des résultats montrant les différences entre hommes et femmes
Il existe un certain nombre de différences entre le fonctionnement du corps des hommes et celui des femmes. Par exemple, la masse corporelle, les cycles hormonaux et les taux de métabolisme sont différents. Cependant, quand les résultats d’essais sont publiés dans des revues scientifiques, ceux-ci n’apparaissent pas ventilés par sexe. Cela veut dire que nous demeurons aveugles en ce qui concerne les niveaux et les dosages de médicaments administrés chez les hommes et chez les femmes.
L’initiative Femmes et essais de méthodes anti-VIH vise à stimuler les personnes pour qu’elles aient un regard neuf sur les pratiques de recherche.
« Quand nous avons fait des exposés visant à éveiller les consciences et l’intérêt d’une large palette de partenaires, notamment les chercheurs, les groupes communautaires, les promoteurs nationaux de la recherche, les entreprises pharmaceutiques, les autorités internationales de réglementation et les rédacteurs en chef de revues médicales, nous avons noté qu’il existait un réel élément de surprise », note Catherine Hankins, Conseiller scientifique en chef à l’ONUSIDA et l’un des moteurs de cette initiative.
« Beaucoup nous ont dit qu’ils n’avaient jamais réfléchi à cette question auparavant et qu’ils n’imaginaient pas qu’on en sache si peu en matière de différences entre les réactions des hommes et celles des femmes aux médicaments, y compris aux médicaments anti-VIH. »
Pour lutter contre cela et mettre la pression sur les chercheurs pour qu’ils conçoivent des essais, sur les promoteurs pour qu’ils les financent, et sur les auteurs pour qu’ils en rendent compte, l’initiative Femmes et essais de méthodes anti-VIH propose une série de questions que les rédacteurs en chef de revues médicales et que les relecteurs devraient poser au moment d’évaluer les manuscrits d’essais. Il y a deux questions fondamentales :
- L’étude permet-elle de tirer des conclusions concernant les femmes ? En d’autres termes, le nombre de femmes ayant participé à cette étude est-il suffisant pour qu’une analyse statistique soit possible et pour que l’on puisse tirer des conclusions sur d’éventuelles différences entre hommes et femmes ?
- Les données ont-elles été recueillies, ventilées, analysées et communiquées par sexe ?
Le groupe CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), dont les lignes directrices sont une référence essentielle pour les auteurs cherchant des conseils sur la façon de rédiger les résultats de leurs essais avant publication, a récemment ajouté un lien sur son site Web vers la page Web de l’ONUSIDA sur les femmes et l'expérimentation d'interventions anti-VIH.
Prochaines étapesCatherine Hankins considère que l’année écoulée a posé les fondations d’un plaidoyer continu par la mise en place d’un cadre d’action et l’élaboration de matériels de sensibilisation : rapport de réunion, brochure, carte de pointage, site Web.
« Nous avons créé un élan en matière de changement des normes de recherche pour que les femmes soient mieux représentées dans les essais cliniques de méthodes anti-VIH et que les communications de résultats sexospécifiques deviennent courantes », déclare-t-elle.
D’après Karen Manson, membre du comité directeur, l’une des prochaines étapes importantes pour l’initiative Femmes et essais de méthodes anti-VIH sera de montrer des résultats tangibles.
« Montrer que plus de femmes participent ou ont accès aux essais cliniques VIH sera essentiel pour rompre l’idée qu’il s’agit d’une barrière insurmontable. »
Catherine Hankins considère qu’une approche collaborative est la clé de voûte de la consolidation et de la réussite à long terme de cette initiative.
« Notre prochaine étape visera à poursuivre la construction d’un réseau de partenaires plaidant pour que les femmes et les adolescentes soient au centre des recherches cliniques sur le VIH. »
Par ce biais, un impact sur l’ensemble de l’épidémie est possible. En tant que Directrice de la Coalition mondiale sur les femmes et le sida, Kristan Schoultz affirme : « Si notre riposte au sida n’est pas efficace pour les femmes – et cela inclue notre riposte du point de vue des essais cliniques – elle ne va tout simplement pas être efficace du tout. »
Plaidoyer pour l’efficacité des essais de méthode
Partenaires:
Coalition mondiale sur les femmes et le sida (en anglais)
Centre international de recherche sur les femmes (en anglais)
Tibotec (en anglais)
Reportages:
Questions d’éthique concernant les essais cliniques VIH (3 décembre 2007)
Le rôle des femmes dans les essais VIH (5 décembre 2007)
Des experts font le point concernant les femmes et les essais cliniques VIH (7 décembre 2007)
Liens externes:
Science, collection spéciale en ligne : tribulations cliniques (octobre 2008)
Discours:
Contact:
Pour tout complément d’information, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : womenandtrials@unaids.org
Publications:
La science clinique rejoint les sciences sociales : sexospécificité et recherche sur un vaccin contre le sida (Centre international de recherche sur les femmes, IAVI) (pdf, 2.70 Mb)
Brochure : Rendre les essais sur le VIH efficaces pour les femmes et les adolescentes (juillet 2008) (pdf,140 kb ) (en anglais)
Analyse des influences du genre et du sexe dans la recherche en santé - Guide pour les chercheurs et les évaluateurs (Instituts de recherche en santé du Canada)
Considérations éthiques relatives aux essais de méthodes biomédicales de prévention du VIH (en anglais) (pdf, 750kb)
Guide des bonnes pratiques de participation aux essais de méthodes biomédicales de prévention du VIH (en anglais) (pdf, 3.04Mb)
Presentations at satellite session XVII International AIDS Conference, Mexico City, August 2008:
Women and Trials in High-Income Settings: Clinical Investigator Perspective
Judith S. Currier (ppt)
What does sexual & reproductive health have to do with clinical trials?
Anna Forbes (ppt)
Women and Trials in Low and Middle-income settings: the clinical investigator’s
Perspective Beatriz Grinsztejn (ppt)
Women and clinical trials: where have we been and where are we going?
Catherine Hankins, Chief Scientific Adviser to UNAIDS (ppt)
Women’s Participation in Clinical Trials - Are we POWERED to meet the Challenge?
Dr Sharon Walmsley (ppt)
Creating Meaningful Research for Women: Issues and challenges from the community perspective
Heidi Nass (pdf)

Feature Story
L’ONUSIDA et la FICR reconduisent leur collaboration
11 décembre 2008
11 décembre 2008 11 décembre 2008
(from left) Elhadj Amadou Sy, Director of Partnerships and External Relations
Credit: UNAIDS/L. Solberg
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) ont reconduit leur accord de collaboration afin de travailler ensemble pour intensifier les efforts sur la voie de l’accès universel aux services de prévention, de traitement, de soins et d’appui en matière de VIH à travers le monde.
Le partenariat, qui couvre une période de trois ans du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, sera axé sur deux thèmes principaux. Premièrement, il s’attachera en particulier à lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et deuxièmement, il visera également à maximiser les activités de prévention, de traitement, de soins et d’appui dans les situations de crise humanitaire.
Pour atteindre l’objectif qui consiste à réduire la stigmatisation et la discrimination, la FICR travaillera en partenariat avec le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH et le sida (GNP+), l’organisation de premier plan qui défend la qualité de vie de tous les individus vivant avec le VIH.
La collaboration entre la FICR et le GNP+ a joué un rôle déterminant dans l’accord précédent de 2004-2006 conclu avec l’ONUSIDA en s’attaquant à la stigmatisation et la discrimination liées au VIH par le biais des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La promotion et la protection des droits de l’homme, la participation accrue des personnes vivant avec le VIH à la riposte au sida, l’égalité des sexes et l’implication de la société civile dans les organes nationaux de coordination et de prise de décisions sont parmi les principes directeurs qui guident cette collaboration.

Credit: UNAIDS/L. Solberg
A propos de la FICR
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est la plus grande organisation humanitaire au monde ; elle dispense son aide sans discrimination de nationalité, de race, de religion, de classe ou d’opinions politiques. Fondée en 1919, la Fédération internationale compte des Sociétés nationales membres, un Secrétariat basé à Genève et différents points stratégiques à travers le monde. La Fédération aspire, par le biais de l’engagement volontaire fondé sur les Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à un monde de communautés ayant davantage de pouvoir, mieux à même de prévenir et de réduire les souffrances humaines et de faire progresser le développement.
A propos de l’ONUSIDA
L’ONUSIDA, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, est le principal ambassadeur de l’action mondiale contre l’épidémie. Il rassemble les efforts et les ressources de 10 organisations du système des Nations Unies dans la riposte au sida : le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, l’ONUDC, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il dirige, renforce et appuie une riposte mondiale élargie visant à prévenir la transmission du VIH, à fournir soins et soutien, à réduire la vulnérabilité au VIH des individus et des communautés, et à atténuer l’impact de l’épidémie.
L’ONUSIDA et la FICR reconduisent leur collaborat
Partenaires:
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)
Publications:
Un partenariat vital: le travail de GNP+ et de la FICR en matière de VIH/sida
Collection Meilleures Pratiques de l'ONUSIDA, octobre 2003 (pdf, 1.17 Mb) (en anglais)
Related

Feature Story
Une nouvelle génération de défenseurs des droits de l’homme et de la santé inspirée par le Dr Jonathan Mann.
10 décembre 2008
10 décembre 2008 10 décembre 2008
Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA , 24 Novembre 2008
Photo: ONUSIDA/M. Girardin
« Lui, nous l’avons perdu, mais nous n’avons pas perdu l’héritage qu’il nous a laissé » a déclaré le Juge Michael Kirby de la Haute Cour d’Australie, du Dr Jonathan Mann, cet épidémiologiste visionnaire, activiste et chercheur, qui a mis en évidence les liens inextricables entre les droits de l’homme et la santé publique.
En commémoration de sa disparition prématurée il y a dix ans, et pour célébrer l’héritage qu’il a laissé et le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’ONUSIDA, l’OMS et le HCDH ont animé une rencontre sur le thème « Le VIH, la santé et les droits de l’homme : l’héritage de Jonathan Mann aujourd’hui » le 24 novembre 2008.
Cette commémoration a réuni pour un émouvant hommage les amis et anciens collègues du regretté Dr Mann ainsi que des professionnels du VIH, de la santé et des droits de l’homme.
Le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a parlé de l’influence capitale de Jonathan Mann dans l’élaboration de la riposte au sida à ses débuts. « Si quelqu’un d’autre avait été responsable du programme mondial de lutte contre le sida, il l’aurait créé avec d’autres idées, avec des idées dépassées en matière de santé publique, telles que la quarantaine et le dépistage obligatoire. La riposte au sida aurait été très différente et elle aurait été catastrophique », a dit le Dr Piot.
Voir le visage humain des personnes affectées et rassembler des ressources en leur nom

Photo: ONUSIDA/M. Girardin
Le Dr Piot a expliqué que le Dr Mann avait mené la lutte en concevant le VIH comme étant plus qu’un virus, en voyant « immédiatement les implications sociétales et politiques » de la maladie. « Il était plutôt comme un joueur d’échecs dans sa manière de repérer et d’anticiper le prochain ‘coup’ du virus, aussi bien que les gens qui ne voulaient pas s’en occuper », a rappelé le Dr Piot.
Le Juge Michael Kirby, de la Haute Cour australienne, qui a été un conseiller du Dr Mann lorsque celui-ci était Directeur du programme mondial de lutte contre le sida, a prononcé une allocution liminaire éloquente. Le Juge Kirby a rappelé la conviction du Dr Mann lors de leur première réunion : « le sida, c’est aussi le problème des femmes… c’est le problème des femmes en raison de la perte de pouvoir qu’elles subissent».
Le Juge Kirby a parlé avec émotion du leadership plein d’inspiration du Dr Mann et il a encouragé le personnel des Nations Unies et les autres invités à poursuivre l’œuvre du Dr Mann avec la même imagination et le même courage. Il a aussi profité de cette occasion pour remercier le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, le Dr Peter Piot, pour son propre leadership résolu et son soutien sans faille pour les droits de l’homme dans la riposte au VIH.
Un film sur Jonathan Mann, produit par The Face of AIDS et intitulé « Jonathan Mann : l’héritage laissé par un défenseur des droits de l’homme » a été projeté en avant-première lors de l’événement. Il comprend notamment des entretiens datant de la fin des années 80, dans lesquels le Dr Mann explique la manière unique qu’a le sida de dévoiler et tout à la fois d’exacerber les déséquilibres existants et les défis sociaux, rendant les droits de l’homme essentiels à toute riposte au VIH.

Photo: ONUSIDA/M. Girardin
L’appel du Dr Mann à une meilleure compréhension des personnes qui sont affectées par la maladie a résonné tout au long de la discussion qui a suivi, illustrant l’actualité de son message.
Le Directeur du département VIH/sida de l’OMS, Kevin M. De Cock, a animé un panel composé d’anciens collègues, qui se sont remémorés l’homme qu’ils connaissaient et ont illustré son engagement de manière très vivante pour les 140 invités, qui représentaient différentes générations de la riposte au sida.
Le groupe a rappelé que le plaidoyer infatigable de Jonathan en faveur d’une riposte au VIH inclusive et comprenant les personnes vivant avec le VIH, les professionnel(le)s du sexe, les consommateurs de drogues injectables et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, avait contribué à un bouleversement sismique dans la manière dont les Nations Unies comme le monde avaient réagi au VIH.
Teguest Guerma, Directeur adjoint du département VIH/sida de l’OMS, se souvient : « Pour lui, la voix d’un(e) professionnel(le) du sexe et celle d’un président avaient le même poids ».

Photo: ONUSIDA/M. Girardin
Daniel Tarantola, Professeur en droits de l’homme et de la santé à l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a rappelé la nature fondamentalement pratique du message de Jonathan : « Il était guidé par la véritable utilité pratique des droits de l’homme comme cadre de référence de la riposte au VIH ». Avec Sophia Gruskin, Directrice du Programme sur la santé internationale et les droits de l’homme de la Harvard School of Public Health, il a décrit l’incroyable leadership du Dr Mann, qui a réuni, pour la première fois, le VIH et le respect des droits de l’homme.
Il est manifeste que la passion du Dr Mann a également été une grande inspiration pour toute une nouvelle génération qui ne l’a pas connu. Korey Chisholm, jeune chercheur associé auprès de l’ONUSIDA, a déclaré que la façon simple et directe qu’avait le Dr Mann d’expliquer les droits de l’homme à tous, allait l’aider lorsqu’il retournera dans son pays, le Guyana, pour contribuer au développement des capacités au sein de réseaux de professionnel(le)s du sexe et d’hommes ayant des rapports avec des hommes. Chisholm a souligné combien cette approche allait permettre aux gens de comprendre leurs propres droits et de mieux se défendre.
La pertinence des droits de l’homme dans la santé et le VIH aujourd’hui
Jonathan Cohen, de l’Open Society Institute, a animé la discussion qui a suivi sur la pertinence, toujours d’actualité, des droits de l’homme dans la santé et le VIH, à la lumière de certains des problèmes actuels relatifs à ces droits.
Cohen a souligné que l’on retrouve la même urgence dans un message clé de Jonathan Mann délivré dans un article publié en 1988 sous le titre « Santé et droits de l’homme, si ce n’est pas maintenant, alors quand ? » et dans la Déclaration de 2007, signée par plus de 600 organisations, intitulée « Droits de l’homme et VIH/sida : Aujourd’hui plus que jamais ».
Mark Heyward, directeur du AIDS Law Project et vice-président du Conseil national sida d’Afrique du Sud, a appelé à une réorientation de la riposte au sida fondée sur la reconnaissance des droits de l’homme, et il a souligné la nécessité d’aller au-delà de la rhétorique.
Mettant au défi les personnes présentes de se souvenir des paroles du Dr Mann comme s’il était encore vivant aujourd’hui, Mme Gracia Violeta Ross Quiroga, du Réseau bolivien des personnes vivant avec le VIH/sida, a souligné que son message était aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était alors. Et d’ajouter : « Quand avons-nous perdu la passion qu’il apportait ? »
Mme Ross a elle aussi posé la question de savoir si la discussion sur le VIH ne serait pas différente si le Dr Mann était toujours vivant. Comme l’a fait observer le Dr Peter Piot : « Jonathan Mann voyait au-delà de l’état de santé pour voir l’être humain. Il voyait, au-delà du patient, une société malade ». La nécessité d’une telle vision subsiste aujourd’hui.
L’événement était coparrainé par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), avec des invités appartenant au Secrétariat de l’ONUSIDA et à ses Coparrainants, au Fonds mondial, ainsi qu’à d’autres organisations et missions gouvernementales.
Une nouvelle génération de défenseurs des droits
Coparrainants:
Organisation mondiale de la santé
Haut Commissariat aux droits de l’homme
Centre de presse:
A l’occasion du dixième anniversaire de son décès, l’ONUSIDA rappelle l’héritage qu’a laissé Jonathan Mann dans les domaines de la santé et des droits de l’homme (2 septembre 2008) (pdf, 54 Kb.)
Multimédia:
Manifestation à la mémoire de Jonathan Mann et du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (24 novembre 2008)

Feature Story
ICASA 2008 : Le changement social est nécessaire pour réduire les risques d’infection par le VIH et la vulnérabilité au VIH
07 décembre 2008
07 décembre 2008 07 décembre 2008
Les questions sociales telles que l’inégalité entre les sexes, la violence contre les femmes et la criminalisation de certaines activités, par exemple le commerce du sexe, la consommation de drogues injectables et les relations sexuelles homosexuelles, sont des facteurs rendant les personnes plus vulnérables à l’infection à VIH. Afin d’examiner les difficultés posées par ces facteurs sociaux, le Secrétariat de l’ONUSIDA, l’UNESCO et le groupe de travail sur la communication relative au changement social ont tenu une séance parallèle à l’ICASA, dimanche 7 décembre.
« Les programmes de lutte contre les facteurs sociaux ou "structurels" qui rendent les personnes plus vulnérables au VIH ne peuvent pas obtenir des résultats immédiats. Il faut de toute urgence les adapter aux besoins locaux des communautés, les mettre en œuvre, les évaluer et les améliorer continuellement en tant que volets essentiels des stratégies, des plans opérationnels et des budgets nationaux affectés à la lutte contre le sida », a déclaré Barbara de Zalduondo, Chef des priorités et du support en matière de programmes à l’ONUSIDA.

Barbara de Zalduondo, UNAIDS Chief Division of programmatic priorities support
Les consultations menées par l’ONUSIDA, en 2006, dans plus de 120 pays, ont révélé que de nombreux obstacles à l’efficacité des programmes contre le VIH relevaient davantage de raisons sociales, juridiques et politiques que de raisons strictement techniques. L’inégalité entre les sexes et la violence faite aux femmes sont des facteurs aussi importants que la criminalisation d’activités telles que le commerce du sexe, la consommation de drogues injectables et les relations homosexuelles. La persistence de la stigmatisation liée au VIH ainsi que d’autres violations des droits de l’homme constituent aussi des obstacles.
Ces difficultés sociales ne sont pas nouvelles. Bien qu’elles fassent l’objet d’études depuis plus de vingt ans, elles ne sont que rarement l’objet de programmes concrets menés sur une échelle suffisamment large et inclus dans les ripostes nationales et sous nationales au sida.
C’est pour cette raison que la session de l’ICASA a réuni des experts ayant conçu, mis en œuvre et analysé des programmes couronnés de succès en matière de lutte contre l’inégalité entre les sexes, la violence sexuelle, la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et d’autres violations des droits de l’homme dans des contextes africains multiples. Ces experts ont fait valoir les approches programmatiques qui vont au-delà du renforcement des connaissances et de la motivation de chacun et qui s’attaquent aussi aux lois, aux politiques et aux normes sociales.
Cette séance parallèle a permis aux responsables de la planification des programmes de lutte contre le sida, aux défenseurs des communautés et aux donateurs de débattre d’une programmation efficace de la lutte contre le VIH.
Les participants ont mis en commun des exemples de programmes catalysant et soutenant le changement des normes sociales néfastes qu’ils peuvent envisager de mettre en place ou d’adapter chez eux.
Les experts ont aussi échangé des informations sur les outils existant pour mesurer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, les normes appuyant l’inégalité entre les sexes et les partenariats sexuels parallèles. De plus, des exemples de programmes, des méthodes d’évaluation et des données ont été présentés et examinés.
La 15ème Conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique (ICASA) se termine aujourd’hui à Dakar. Au cours de ces quelques jours, des centaines de délégués africains et du monde entier ont parlé des avancées et des tendances en matière de VIH dans la région.
ICASA 2008 : Le changement social est nécessaire

Feature Story
Partenariats public-privé dans la riposte au sida : une opportunité pour l’innovation et le leadership
07 décembre 2008
07 décembre 2008 07 décembre 2008 (from left) Ambassador Louis Charles Viossat; Tim Martineau, UNAIDS Director of the Technical and Operational Support Division.
(from left) Ambassador Louis Charles Viossat; Tim Martineau, UNAIDS Director of the Technical and Operational Support Division.Credit: UNAIDS/Mamadou Gomis
Les experts qui se sont exprimés à la séance de l’ICASA vendredi ont affirmé qu’il était vital d’évaluer ce qui fonctionnait réellement dans la riposte au sida et d’en comprendre les raisons dans le contexte actuel de ralentissement financier mondial.
« Le déclin économique actuel nous pousse à redoubler d’efforts et à porter une attention particulière à l’efficacité des programmes, ainsi qu’aux résultats qu’ils obtiennent ou n’obtiennent pas », a souligné Tim Martineau, Directeur de l’appui technique et opérationnel à l’ONUSIDA.
Cet événement, intitulé « Partenariats public-privé contre le VIH : comment peut-on changer ensemble le cours des choses ? », a été organisé par l’ONUSIDA dans le cadre du Programme sur le leadership de la Conférence. M. Louis-Charles Viossat, ambassadeur chargé de la lutte contre le sida, a présidé une discussion avec, entre autres participants, des représentants de la Coalition nigériane des entreprises contre le VIH/sida, de Versteergard Frandsen, de la Coalition camerounaise des entreprises contre le VIH/sida et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
Cette réunion a permis d’examiner les avantages et les inconvénients des partenariats public-privé dans la riposte mondiale au sida.
On appelle partenariat public-privé (PPP) toute « relation institutionnelle entre l’Etat et le secteur privé, à but lucratif ou non lucratif, dans laquelle les différents acteurs participent conjointement à la définition des objectifs, des méthodes et de la mise en œuvre d’un accord de coopération. » Ce type de partenariat se caractérise par des objectifs, des risques et des bénéfices communs.
Les PPP permettent aux gouvernements d’acquérir de l’expérience dans des domaines où ils en manquent et de disposer d’un soutien logistique contribuant à l’amélioration des services de prévention et de traitement tout en en réduisant les coûts.
Les PPP permettent au secteur privé (à but lucratif et non lucratif) d’élargir ses opportunités commerciales et de renforcer son environnement socio-économique.
Les participants ont convenu qu’il était nécessaire de prêter attention et de veiller à la large participation et représentation de l’ensemble du secteur privé, notamment les syndicats, les fédérations d’employeurs, les petites et moyennes entreprises et le secteur informel. Bien que des avancées aient été constatées, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la participation des petites et moyennes entreprises et du secteur informel qui emploient la plupart de la main-d’œuvre en Afrique.
Le groupe a identifié quatre facteurs essentiels à la création et à la durabilité des PPP :
- La définition claire des rôles et des responsabilités de chaque partenaire
- La transparence et le respect des normes éthiques
- La coordination entre les partenaires
- Les évaluations périodiques du partenariat
D’après M. Louis-Charles Viossat, « les partenariats public-privé ont fait preuve de leur efficacité et de leur rôle dans l’amélioration de la riposte au sida. Nous devons cependant reconnaître qu’ils ne sont pas la panacée. »
« La formation, l’information, l’évaluation périodique du partenariat et l’application des normes éthiques sont des éléments importants », a-t-il ajouté.
Il a aussi été signalé que l’innovation était essentielle à la réussite de tout partenariat public-privé. Navneet Garg, Directeur de l’entreprise danoise Versteergard Frandsen, a déclaré que « l’Objectif du Millénaire pour le développement (OMD) consistant à enrayer la propagation du VIH d’ici à 2015 ne [pouvait] être atteint qu’en ayant recours à des approches novatrices facilitant un élargissement rapide de l’accès à tous. Les partenaires tant publics que privés devraient utiliser leurs atouts respectifs et améliorer leur partenariat en fonction de ceux-ci. Relever pareil défi ne peut se faire que si les partenaires intensifient leurs actions en vue de réaliser les OMD. »
Partenariats public-privé dans la riposte au sida
Related
 Empowering youth to lead Togo’s HIV response
Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024
 Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire
Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

09 septembre 2024
 Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic
Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

03 septembre 2024

Feature Story
ICASA 2008 : Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et VIH en Afrique
07 décembre 2008
07 décembre 2008 07 décembre 2008Du Cap à Lagos, beaucoup de nouvelles études commencent à permettre de mieux comprendre la situation des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) dans le contexte du VIH en Afrique.
« L’homosexualité est non seulement trop peu étudiée en Afrique de l’Ouest mais, au Nigéria, elle est aussi considérée comme un crime, ce qui rend difficile d’atteindre les HSH », a déclaré Sylvia Adebajo, chercheuse à l’Université de Lagos (Nigéria). « Par conséquent, les vies des HSH sont marquées par le déni, la violence et la stigmatisation. »
Mme Adebajo s’exprimait hier à une séance de l’ICASA sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et sur l’infection à VIH en Afrique. Elle a affirmé que l’un des obstacles majeurs à l’établissement de contact avec les HSH en Afrique, et en particulier en Afrique de l’Ouest, était la criminalisation ; peu de HSH se font connaître de peur de la stigmatisation, de la discrimination et des conséquences juridiques.
Au cours de cette séance, des chercheurs ont exposé plusieurs résultats de travaux, parfois préliminaires, qui aboutissaient aux mêmes conclusions : la prévalence du VIH chez les HSH est beaucoup plus élevée qu’au sein de la « population de base » ; peu d’hommes s’identifiant comme HSH recherchent un soutien médical ou s’affirment en tant que tels dans leur communauté ; un nombre saisissant d’entre eux n’utilise pas de préservatif lorsqu’ils ont des rapports sexuels ; beaucoup ont des comportements bisexuels ; et peu se font dépister pour connaître leur statut VIH.
« On constate que, lorsque les HSH se font dépister et qu’ils apprennent leur séropositivité, beaucoup ignoraient leur séropositivité et avaient continué à avoir des comportements à haut risque pendant une certaine période », a déclaré Earl Ryan Burrell, chercheur de la Fondation Desmond Tutu contre le VIH. « En Afrique du Sud, les programmes de lutte contre le VIH sont essentiellement axés sur les hétérosexuels et les femmes… il faut que les HSH soient davantage reconnus comme étant un groupe à risque », a-t-il ajouté. L’étude qu’il mène actuellement au Cap et dans les townships alentours montre que beaucoup de HSH ignorent les risques liés à certains actes sexuels, bien qu’ils s’identifient comme HSH et qu’ils disposent de divers niveaux d’accès aux informations de prévention du VIH.
Une étude menée en 2006 au Nigéria a révélé que l’on ne savait que très peu de choses sur le lien entre la prévalence du VIH et les HSH dans le pays. Cependant, parmi les personnes interrogées, presque toutes ont indiqué qu’elles avaient eu des partenaires multiples et parallèles, aussi bien hommes que femmes, et qu’elles utilisaient rarement des préservatifs. Lorsque cela était le cas, beaucoup d’hommes utilisaient leur salive, du savon ou des lubrifiants à base d’huile, telle que l’huile de cuisine, qui peuvent endommager la surface du préservatif.
Les chercheurs ont conclu la séance en encourageant les gouvernements africains à investir davantage de ressources dans le soutien à la prévention du VIH et, plus important encore, à reconnaître les HSH comme étant un groupe nécessitant des programmes sur mesure. « Il reste beaucoup à apprendre. Chacune de ces communautés a des besoins uniques en matière de prévention et de traitement », a déclaré Mme Adebajo.
ICASA 2008 : Hommes ayant des rapports sexuels av
Liens externes:
Publications:
Hommes, sexualité et santé dans le contexte du VIH et du sida (étude au Nigéria) (en anglais)
Prévalence du VIH parmi les HSH au Cap et nouvelles stratégies de prévention (en anglais)
Related
 Empowering youth to lead Togo’s HIV response
Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024
 Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire
Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

09 septembre 2024
 Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic
Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

03 septembre 2024

Feature Story
L’ICASA 2008 se termine sur un appel à une meilleure prise en compte des jeunes
07 décembre 2008
07 décembre 2008 07 décembre 2008
Ms Souadou N'Doye
L’ICASA 2008 s’est terminée le 7 décembre sur un message fort : les jeunes, en particulier ceux qui vivent avec le VIH, sont indispensables à la riposte au sida en Afrique. La cérémonie de clôture a débuté par une allocution d’une jeune sénégalaise, Mme Souadou N’Doye. Elle a parlé au nom de tous les jeunes Africains et a instamment prié l’assistance de veiller à ce que les jeunes soient associés à l’élaboration des programmes de lutte contre le VIH.
Elle a demandé aux gouvernements et aux partenaires de recourir aux talents des jeunes de chaque pays. Elle a souligné que, sans les jeunes, la riposte au sida était incomplète. « Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, agit contre nous », a-t-elle déclaré.
Le Professeur Souleymane M’Boup, président du Comité d’organisation de l’ICASA 2008, a exprimé toute sa gratitude aux organisateurs et aux participants venus du monde entier assister à la conférence sur le sida en Afrique. Il a manifesté sa profonde satisfaction de savoir que toutes les personnes touchées par le VIH étaient présentes à la conférence et disposaient d’une plate-forme pour exposer leurs préoccupations, aussi bien les femmes vulnérables que les professionnel(le)s du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ou les migrants. Il a déclaré que la mosaïque formée par les participants était la preuve de la réussite de la 15ème édition de l’ICASA. Plus important encore, le Professeur M’Boup a déclaré qu’il s’était rendu compte, ces cinq derniers jours, que « l’Afrique [avançait] et que l’énergie et l’espoir [étaient] partout ». Il a conclu en demandant aux participants de rentrer chez eux avec le message suivant : la riposte de l’Afrique au sida doit avancer.
Mettre l’accent sur les minorités sexuelles, davantage associer les jeunes ainsi que les chefs religieux et militaires et améliorer de toute urgence les programmes de prévention du VIH étaient des thèmes récurrents dans l’ensemble des séances de la Conférence. L’une des questions transversales était le besoin de financement à long terme, défini comme un aspect crucial du développement humain en Afrique, en particulier pour une riposte efficace et durable au sida.

The closing ceremony of ICASA 2008, Dakar, 7 December 2008
A l’occasion de la cérémonie de clôture, les organisateurs de l’ICASA ont décerné des prix à des leaders actifs dans la lutte contre le sida. Le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, le Dr Michel Kazatchkine, Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et le Dr Meskerem Grunitzky-Bekele, Directeur de l’Equipe ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, font partie des personnes auxquelles le Dr Safiatou Thiam, ministre sénégalais de la Santé et de la Prévention, a remis ces prix.
L’ICASA 2008 se termine sur un appel à une meille
Liens externes:
Related

Feature Story
ICASA 2008 : le VIH dans les lieux de détention
06 décembre 2008
06 décembre 2008 06 décembre 2008
(from left) Sylvie Bertrand, UNODC Regional Programme Coordinator HIV and AIDS in Prison Settings - Southern Africa; Dr Johnson Byabashaija, Commissioner General Uganda Prisons Service
Credit: UNAIDS/Mamadou Gomis
M. Diop s’exprimait vendredi 5 décembre à une séance de l’ICASA organisée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et intitulée « Prévention, soins, traitement et soutien en matière de VIH/sida dans les lieux de détention ».
Il a mis l’accent sur le fait que les allées et venues de personnes entre les prisons et l’extérieur contribuaient aussi à la propagation du virus parmi les personnes en liberté.
Les participants à cette séance ont analysé l’impact du VIH dans les prisons africaines et un consensus s’est dégagé autour de l’idée que la lutte contre le VIH dans les prisons constituait un élément clé de l’efficacité des ripostes au sida.
D’après les participants, la surpopulation carcérale, le manque d’infrastructures, les mauvaises conditions sanitaires des prisons et une absence de services de prévention du VIH, de soins de santé et d’une nourriture adaptée contribuent à une propagation du virus. Ils ont reconnu que davantage de données et de recherches étaient nécessaires pour identifier la nature et les schémas des comportements à risque.

Brian Tkachuk, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Advisor for HIV and AIDS in prisons - Africa
Credit: UNAIDS/Mamadou Gomis
« On a encore du mal à comprendre l’ampleur de l’épidémie dans les prisons africaines et son effet multiplicateur sur les personnes libres de la région », a déclaré Brian Tkachuk, Conseiller régional pour l’Afrique sur le VIH/sida dans les prisons pour l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), au cours de son exposé.
Afin d’atténuer l’impact du VIH dans les prisons, M. Tkachuk a souligné qu’il était nécessaire de sensibiliser les prisonniers au VIH, d’encourager l’éducation par les pairs et de fournir un accès aux interventions préventives, telles que la mise à disposition de préservatifs et de matériel de tatouage et d’injection sûrs, et la possibilité de recevoir son partenaire dans le cadre de visites privées. Il a aussi insisté sur la nécessité de fournir un accès aux traitements contre le VIH et une alimentation appropriée aux prisonniers vivant avec le VIH.
M. Tkachuk a noté que « la situation en matière de VIH dans les prisons [demeurait] un domaine fortement négligé requérant une attention immédiate » et a demandé que la question du VIH dans les prisons soit incluse dans les ripostes nationales au sida.
« Il est impossible de gagner la lutte contre le sida dans les prisons sans compter avec un engagement politique total » a déclaré le Dr Johnson Byabashaija, Commissaire général du service des prisons en Ouganda. Il a aussi souligné qu’il était également nécessaire de créer de solides systèmes de gestion de l’information permettant de recueillir des données qualitatives en vue d’élaborer des programmes de plaidoyer et de prévention du VIH ciblés pour les lieux de détention.